Création-recherche : moins de blabla et plus d’œuvrage
Comme la hiérarchisation de son appellation l’indique, dans la méthodologie de la création-recherche introduite par Pierre Baqué (1971), la création initie la recherche ; pour l’esthéticien Pierre-Damien Huyghe (2017), c’est « tout l’enjeu de la recherche en art que de délaisser le champ aujourd’hui dominant de la déclaration pour rejoindre celui du travail » (p. 136). Cette méthodologie permet de produire des savoirs scientifiques sans que la poïétique2 soit délaissée. Aussi, dans les féminismes de la fin des années 1980, l’encorporation méthodologique des « savoirs situés » (Haraway, 2007) se dresse contre l’objectivité scientifique désincarnée et annonce le « marécage du présent » (Muñoz, 2021) de la queerité3. Suivant cette méthode, les productions artistiques orientent lectures et théorisations en entrant dans une temporalité altérée, mais sans jamais les illustrer. Avec cette méthode, la formulation d’une démarche artistique est possible tout en s’articulant autour d’un large corpus qui peut aller de la philosophie à la psychanalyse en passant par la sociologie et, dans le cas précis de cet article, les théories queer, pour être encore recoupée par des œuvres artistiques de toutes époques et lieux confondus.
Même si les associations et les références peuvent sembler libres et céder parfois à la folie, de mon point de vue elles suivent une chronologie d’anticipation. La vision queer peut parfois être pessimiste : les références seraient de toute façon sans futur à cause d’un présent déjà en ruine. Peut-être que sortir de l’emprise des « temps hétéros » sur le présent pourrait défiger les utopies du passé et permettre d’espérer un autre futur ? Parce que la queerité n’est pas encore là, elle n’est pas soumise à l’injonctif d’apporter des preuves pour fonctionner. Grâce à l’anti-méthode queer, la création-recherche ne dépend pas des méthodologies rationalistes qui font « leur sélection dans le passé tout en adoptant une posture d’entreprise positiviste ou de quête de savoir empirique [qui] néantisent souvent l’imagination politique » (Muñoz, 2021, p. 60). L’imagination fait plier la méthode.
Après des errances dans l’histoire foucaldienne — pas assez féministe — de la sexualité (Foucault, 1976, 1984a, 1984b), mes recherches ont fini par atterrir sur les surfaces mouvantes et instables des théories queer qui opèrent un « brouillage des lignes » des « deux espaces théoriques » que sont les poststructuralismes et les matérialismes féministes français (Cervulle et Clair, 2017). Sur ces surfaces mues par des violences matérielles et discursives, d’autres étendues se sont révélées indicibles et pulsionnelles, rendant plus difficile la reconnaissance des spécificités poïétiques de certaines pratiques artistiques : c’est là que la psychanalyse et les sciences des arts entrent en contact.
Avec la très mauvaise réputation de la psychanalyse dans le milieu populaire dans lequel je suis né, et même après la constitution d’un capital culturel et philosophique, j’étais initialement très réfractaire à une théorie psychanalytique qui m’apparaissait bourgeoise, blanche avec un regard phallocentré symptomatique d’une discipline patriarcale auto-régénérante. De mon point de vue, la psychanalyse semblait mépriser et racketter4 beaucoup de personnes — en particulier celles issues de ma classe sociale. Je me suis d’abord plongé dans les lignes théoriques antipsychiatriques tracées dans les années 1970 par Michel Foucault et en 1980 par Monique Wittig (2019), tout en évitant scrupuleusement les littératures du « placard analytique » au jargon classiste (Bourcier, 2018). Malgré tous mes efforts, force fut de constater qu’on ne peut en esquiver le passage obligé défriché par Butler (2005) à la fin du xxe siècle.
Ainsi, la question posée par Éric Fassin (2008), l’essai de Teresa de Lauretis (2010), et plus récemment l’intervention de Paul B. Preciado (2020) auprès d’une armée de psychanalystes m’ont fait entr’apercevoir le milieu du nœud des prétendues oppositions irréconciliables des poststructuralismes et des matérialismes féministes. La suite de l’épopée s’est poursuivie avec les disciples d’Eve Kosofsky Sedgwick (2008) qui prônent un retour à la relationalité post-SIDA (Muñoz, 2021), en absorbant les thèses radicales anti-relationnelles de Lee Edelman (2016) desquelles je me suis beaucoup inspiré pour la rédaction de cet article.
Dans cet article, j’essaierai de répondre à ces questions : comment relationner après un long processus historique de défiguration, de résurrection et de stérilisation des corps ? Quelles esthétiques sont mobilisées par ces processus ? Et enfin, quel rôle y joue la clinique psychanalytique ?
Ces questions permettront de faire ressortir les trois axes de cet article. Ils s’organisent autour de différents binarismes bizarrement complémentaires qui se répètent en boucle. D’abord j’expliquerai comment l’invisibilisation et l’hypervisibilisation des corps non-normés sont esthétisés et encagés par le processus de placardisation, puis dans un deuxième temps comment, dès le xvie siècle, la désinfection des figures sur les tables de dissection fit naître une véritable zombi-figuration, et enfin comment la résurrection de cette figure putréfiée par les normes est rejouée sans cesse par le jeu de la suture psychanalytique.
Je me servirai de la méthode création-recherche pour faire le lien entre ces trois axes, en retraçant la poïétique de La suture, titre de la gravure à l’eau-forte5 dont j’ai récemment obtenu un essai (Fig. 1). La genèse de cette gravure est la suivante : il y a deux ans j’ai fait un cauchemar où je ne pouvais plus utiliser mes bras, tout ensanglantés par des morsures à répétitions de ce que j’ai su, en me réveillant en sursaut, être un serpent. Le lendemain, j’ai gribouillé un dessin (Fig. 2) des impressions inexactes qui me restaient et qui s’étaient déjà mélangées à tout un tas de déchets psychiques.
Fig. 1 — C. Fleury Turcas (2023). La suture.
Essai, eau-forte sur cuivre, fil rouge.
Fig. 2 — C. Fleury Turcas. Croquis préparatoire de La suture.
Placardisation : sublime en cage
Dans un premier temps j’aimerai dégager les implications esthétiques du phénomène de placardisation et leur relation avec les qualités plastiques de la cage. Cette analyse amènera vers une réflexion politique de la galerie d’art white cube et de la défiguration qui s’opère entre ses murs.
-
Je commencerai par définir le sublime en utilisant l’image de la boursoufflure, qui est en relation avec les esthétiques camp.
-
Après avoir révélé le secret de polichinelle qui entoure ces esthétiques, je tenterai de crocheter la serrure du placard pour en dévoiler la structure et surtout la texture.
-
Je montrerai ensuite comment le placard de verre est l’échafaudage panoptique idéal pour enfermer les esthétiques queer dans des cages.
-
Enfin, je terminerai par la paradoxale hypervisibilisation sacrificielle du sublime entre les barreaux peints en blanc des white cube, sortes de galeries typiquement occidentales qui monnayent inlassablement son visage défiguré.
J’ai résumé ce cheminement par l’expression « sublime en cage », qui est selon moi indissociable du phénomène à la fois de placardisation et d’exposition des esthétiques queer, phénomène prenant la forme d’un freak show institutionnalisé.
Une boursouflure du sublime
Le sublime dérive d’une définition kantienne à trois entrées : la satisfaction répulsive ou « plaisir négatif », la distance réfléchissante et l’impuissance de l’imagination (Kant, 1995). Ces trois spectres sensitifs découleraient d’une « violence qui déséquilibre » selon la définition grecque antique de Longin (1991). Les jeux de tension et de pression exercés par le sublime sur le beau sont exprimés dans l’étymologie même du mot, qui travaille la limite « par le haut comme par le bas en fonction du sens attribué au sub latin » (Mees, 2016, p. 400). Pour les esthéticien.nes contemporain.es, le sublime postmoderne s’appréhenderait « comme événement, fracture, instant de déstabilisation » qui dériverait « logiquement de l’opposition systémique entre discours et figure » (Bernard, 2000, p. 30). La place du sublime se trouverait donc « au départ d’une esthétique de l’évènement » (Mees, 2016, p. 409), et serait le résultat particulier d’une expérience du temps distendu, en plus de celle de formes fascinantes.
En condensant et mélangeant les temporalités dans des sens antichronologiques, le sublime abolit la distance qui sépare le.a regardeur.euse de sa propre vacuité. Cet espace-temps confus fait résonner le silence discursif autour de l’objet sublime en le rendant paradoxalement plus visible. En signifiant ce qui est insaisissable, les esthétiques « laides » du sublime isolent violemment les regardeur.euses du côté du chaos mortifère. De l’autre côté du sublime, les « belles » esthétiques sont partagées et contemplées par celleux qui sont rassuré.es par ses organisations géométriquement orchestrées par les lois de l’harmonieux.
Le joli terme de « boursouflure » employé par Marc Amfreville (2004) propose une dialectique du sublime entre mouvement et forme en excès. La bouffonnerie6 latente qui sommeille sous la peau de la boursouflure est au plus proche des esthétiques queer. Ces esthétiques du bizarre sont toutes tordues par les pulsions qu’elles contiennent avec (des)espoir7 en leur sein. Elles suppurent et sont prêtes à exploser. Dans la beauté fascinante de l’horrible, la « force toujours explosive de l’ironie » relevée par Edelman (2016) travaille sans cesse le sublime et nourrit « sa pesanteur » (Amfreville, 2004) en la rendant sympathique et soutenable.
C’est dans un jeu circulaire de proximité ou d’éloignement (Saint-Girons, 1993) que le sublime fait évènement dans les belles esthétiques. Le sublime trouble l’esthétique. En fonctionnant comme une véritable échappatoire esthétique, le sublime contourne les émotions-limites comme la surprise et l’insoutenable en leur permettant d’entrer dans la fascination et le comique grâce à des figures rhétoriques comme l’ironie, le sarcasme ou le cynisme. Les esthétiques du sublime problématisent l’esthétique du sacro-saint beau en en questionnant les normes et l’universalisation. Dans le cas des ironies camp (Plana, 2015) et des bizarreries queer, elles éclosent bel et bien depuis les tréfonds des caveaux de la culture du beau pour en percer la surface comme une sublime boursoufflure.
Le secret partagé du camp et les lèche-vitrines du placard de verre
Pour Frédérique Villemur le « ratage » constant de l’esthétique camp proviendrait d’une recherche de « la fausseté dans l’exagération », ainsi
ce qui rapprocherait le bizarre du queer de l’artifice du camp ouvrirait sur une déconstruction du sujet et sur sa dérive exponentielle : le camp rejette l’esthétique de la différence et de la différenciation au profit d’un devenir, d’un entre-deux en perpétuel écart, d’un infra qui se glisse à l’interface des opposés, et de tous les dualismes. (Villemur, 2015, p. 114)
Selon cette définition, le camp rentre dans les esthétiques du sublime par le mouvement même de la boursoufflure, qui se rit de l’homogénéité du beau dans un mouvement d’exagération pour pouvoir mieux la parodier. Dans l’art contemporain, le meilleur exemple du camp se retrouve dans l’esthétique pop-maniériste (Briand, 2018) développée par le couple d’artiste Pierre et Gilles.
Pour Eve Kosofsky Sedgwick (2008), parmi les binarismes définitionnels qui saturent la culture occidentale moderne, l’opposition entre le sentimentalisme et l’anti-sentimentalisme fait éclore le kitsch et le camp au milieu d’une culture misogyne et homophobe. Le kitsch et le camp sont aux premiers rangs d’une résistance esthétique et politique dans la culture populaire et d’élite. Cependant, là où le kitsch s’attribue, le camp lui se reconnaît ; si le camp mobilise des identifications politiques spécifiques pour être reconnu8, le kitsch fonctionne plutôt sur des excès référencés de façon plus formelle et plus universelle. Les « fantasmes projectifs » permis par les esthétiques camp permettent un secret partagé entre artistes et spectateur.ices ; le décèlement du camp est subversif parce que l’éclat de son style filtre depuis la serrure du placard.
Le placard est une pièce honteuse, étroite et vile de la maisonnée, c’est un débarras qui contient balais et produits ménagers. Le placard se retrouve dans bien des expressions populaires : « mettre quelque chose au placard » c’est cacher aux autres des choses culturellement définies comme honteuses sans pouvoir s’en débarrasser complètement. La mise au placard permet de cacher tout en conservant ; le phénomène de « placardisation » fonctionne comme une prison psychique, à la fois secrète mais toujours présente. La clé du placard est bien souvent entre les mains de celleux qui sont coincé.es dedans, mais la pression exercée par les normes extérieures les force à s’enfermer dedans. Le placard devient alors un espace de repli sécurisé mais étouffant, qui protège des pressions culturelles. Sortir de ce placard se traduit en anglais par le coming out9. Cette structure particulière du placard, qui allie les remous d’un secret avec l’auto-cloisonnement, est formulée dans cette chanson interprétée par Louis Armstrong en 1936, intitulée Le Squelette Dans Le Placard :
Boy, don’t you go in there
Come outta there, boy
Don’t you know that house is haunted ? […]
When the skeleton in the closet started to dance
All the witches were in stitches while his steps made rhythmic thumps
And they nearly dropped their broomsticks when he tried to do the bumps
You never heard such unearthly laughter, such hilarious groans
When the skeleton in the closet rattled his bones10 (Johnston et Burke, 1936)
Le paradoxe de la « structure paranoïaque » du placard, dont Eve K. Sedgwick fait l’épistémologie (2008), réside dans une « panique définitionnelle homo/hétérosexuelle » d’un « déni cultivé de l’inconnaissable ». Le placard serait au cœur d’une maison hantée, on entendrait un squelette cloîtré à l’intérieur qui secoue ses os pour faire danser et rire toutes les créatures morbides de la culture populaire qui peuplent ce cabaret de l’effroi. Si tout le monde s’éclate en dansant autour du placard, pourquoi avoir peur et s’en éloigner ? Comment sait-on ce qu’il s’y passe si personne ne doit s’en approcher ? C’est un « secret de polichinelle », un « secret vide » qui rend les parois du placard translucides. Le placard est en verre. C’est une vitrine qui scénographie le « solipsisme paranoïaque » homophobe. Ce spectacle hypocrite génère des rumeurs qui permettent d’identifier la texture du placard pour pouvoir mieux s’en méfier. Ces deux derniers siècles, l’« espace performatif de contradiction » du placard a paradoxalement terrorisé la définition hétéro/homosexuelle tout en la façonnant.
Dans La suture (Fig. 1), le spectacle du placard est gravé dans un « monumental édifice straight » (Bourlez, 2018). Cet amphithéâtre en forme de camée11 est à la fois un théâtre anatomique marqué par la présence d’une colonne ionique12 à gauche. J’ai dessiné les drapés tombant dans des replis suggérant des parties fragmentées du corps humains ; les plis du tissu sont autant d’alibis pour dissimuler l’organicité parfois génitale des muqueuses secrètement exposées sur les parois du placard. Les figures au centre sont enfermées dans le cercle de la camée, les stries de la colonne ionique sont les barreaux d’une prison. Ces lignes straight (Wittig, 2019) emprisonnent les « drôles d’oiseaux »13 queer dans une cage. Sur l’essai (Fig. 1), les barreaux ne sont pas bien imprimés parce que la morsure n’était pas assez profonde sur la matrice en cuivre. Il est difficile de faire des traits droits puisque je ne lève pas le poignet quand je dessine ou je grave : mon geste pour écrire ou dessiner est le même (Fig. 3a-3b).
Fig. 3a — C. Fleury Turcas (2023). Poïétique en gravure.
Montage.
Fig. 3b — C. Fleury Turcas (2023). Poïétique en gravure.
Montage.
Panoptique de la cage queer
Sous la forme de la cage queer, l’esthétique du placard suit l’architecture panoptique analysée par Foucault (1975) dans Surveiller et punir, et qui rassemble
autant de cages, autant de petits théâtres, où chaque acteur est seul, parfaitement individualisé et constamment visible. Le dispositif panoptique aménage des unités spatiales qui permettent de voir sans arrêt et de reconnaître aussitôt. En somme, on inverse le principe du cachot ; ou plutôt de ses trois fonctions — enfermer, priver de lumière et cacher — on ne garde que la première et on supprime les deux autres. La pleine lumière et le regard d’un surveillant captent mieux que l’ombre, qui finalement protégeait. La visibilité est un piège. (p. 202)
Dans un article écrit par Marie-Dominique Gil (2021) sur « la cage queer », on peut lire que l’esthétique de la cage « fonctionne sur une double dynamique puisque tout en restreignant les mouvements du prisonnier, elle crée les conditions de sa survisibilisation et donc de sa réification » (p. 49). L’hypervisibilisation-surveillance qui en résulte ressemble en tout point au spectacle du placard de verre qui « matérialise un rapport de pouvoir particulièrement signifiant pour les artistes queer tout à la fois socialement rejetés, menacés de violence et scrutés avec insistance » (p. 50). Cet article prend pour exemple l’installation Piège pour un voyeur de Michel Journiac (1969)14. La frugalité de la cage queer de Journiac fait écho à « l’art minimal, antinarratif et antifiguratif » en vogue dans les années 1960-1970, mais le kitsch de ses néons rappelle le style de vie de « la marge travaillant de son côté à se libérer de tout dogmatisme » (p. 55).
Un autre binarisme analysé par Eve K. Sedgwick (2008) à la suite de celui sentimental/anti-sentimental était celui de l’abstraction/figuration. Elle émet alors l’hypothèse qu’une « part incalculable de l’énergie qui poussa le modernisme vers l’abstraction provient précisément de la panique définitionnelle homo/hétérosexuelle du tournant du siècle » (p. 178). La figuration « qu’a rendue abjecte l’abstraction moderniste autoréflexive » (p. 178) se serait vue incarnée dans un corps masculin désiré et désirable, dans une absolue « anti-figuralité », un « anti-représentationnisme » voire même une « iconophobie » (p. 173). Dans l’accélération de son rejet esthétique du sentimental15, l’esthétique moderne aurait posé la figuration comme « challenger déchu » à la « vulgarité lubrique » purifié par la montée de l’abstraction. Pour Sedgwick, la défiguration des arts serait d’origine homophobe. J’ajouterai que la défiguration des arts est aussi misogyne, puisque « l’anti-figuralité » du corps masculin désiré et désirable s’est fait sur le dos d’une « hyper-figurabilité » du corps féminin désiré et désirable dont l’écriture dans l’histoire occidentale est plusieurs fois centenaire.
Défiguration des arts à l’intérieur du monochrome blanc du white cube
J’appelle « défiguration des arts » la montée de l’art abstrait dans les mouvements artistiques tout au long du xxe siècle. La défiguration des arts se serait opérée au sein de l’espace immaculé des galeries d’art. L’hétérotopie (Foucault, 2001) de la galerie white cube est l’héritage direct des institutions muséales, qui, dans leur adoration et leur promotion de l’abstraction, ont repeint tous leurs murs dans une série angoissante de monochromes blancs.
Alors qu’elle analysait la structure patriarcale et taxidermique de l’American Museum of Natural History, situé à New-York entre 1908 et 1936, Donna Haraway (2007) écrit :
Trois types d’activités publiques étaient consacrés à la préservation d’une virilité menacée : exposition, eugénisme et conservation. L’exposition était une pratique qui devait produire de la permanence, arrêter la détérioration. L’eugénisme était un mouvement de préservation des souches héréditaires, il devait assurer la pureté raciale, prémunir contre le suicide de la race. La conservation était une politique de préservation des ressources, non seulement pour l’industrie mais aussi pour la formation morale, pour l’accomplissement de la virilité. Ces trois activités étaient des prescriptions pour lutter contre la décadence, maladie redoutée de la culture blanche, capitaliste et impérialiste. Formes d’éducation et de science, elles étaient aussi très proche des pratiques religieuses et médicales. Ces trois activités touchaient à la transcendance de la mort, individuelle et collective. Elles tentaient d’assurer la préservation sans rien fixer ni paralyser, face au changement extraordinaire qui survenait dans les relations de sexes, de races et de classes. (p. 200, je souligne)
Plus loin, la philosophe parle du musée comme d’un « œilleton à travers lequel on peut espionner les riches dans leur incarnation idéale ». En analysant cet espace d’exposition particulier, Haraway décrypte plus largement des biais idéologiques que l’on peut retrouver partiellement ou totalement dans d’autres structures muséales occidentales.
Dans La suture (Fig. 1), l’œilleton se retrouve dans la forme de la camée qui trace les contours du placard de verre. L’espace blanc derrière le squelette est celui du white cube, charpenté comme une véritable chapelle de l’art contemporain aux allures de couloirs d’hôpital vides et suréclairés. Dans cette perspective, les white cubes conjuguent espace religieux et médical pour devenir un lieu de réception artistique « neutre ». L’utilisation systématique de la couleur blanche sur les murs des white cubes est le symbole d’un eugénisme et d’un hygiénisme culturel qui se cache derrière l’alibi du contraste.
Le blanc est la couleur paradigmatique du malaise dans la culture (Freud, 1930/2010). Ce malaise a été décrit en 2017 dans une chanson du rappeur Vald :
Blanc de soupçon comme un crime inavoué
Je suis blanc comme celui qui tient l’fouet
Soupçon de blanc pour ne pas qu’on s’effraie […]
Blanc comme pas un mot
Blanc comme malade, blanc comme à la morgue
Blanc, c’est blanc, l’Histoire est accablante, blanc (blanc)
Blanc comme le vrai méchant, blanc comme le père du Sheitan
Blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc comme Dieu
Blanc comme tueur en série
Blanc comme pédophile, blanco,
Blanc comme linge dans ton pif, blanc comme neige,
Depuis tantôt blanc comme fantôme [...]
Blanc comme gentil,
Blanc comme petit,
Blanc comme bourgeois,
Blanc comme gentil petit bourgeois
L’idéologie bourgeoise, coloniale et religieuse violemment exposée dans cette chanson, Roland Barthes (2014) l’avait décrite comme « anonyme » par l’effet de la « défection du nom bourgeois ». Les bourgeois ne revendiquant ni identité ni classe sociale, tout ce qui constituerait la bourgeoisie se diluerait alors dans une immensité universelle blanche immaculée. Le blanc des murs des galeries et musées rappelle cette neutralisation par le biais d’une couleur estimée la plus universelle possible, qui donne l’impression que tout le monde peut écrire son identité et afficher son portrait sur ses murs, sans cependant jamais détenir la clé des lieux. Aujourd’hui, l’assimilation néo-libérale semble fonctionner grâce à cette ex-nomination bourgeoise multi-propriétaire. C’est sur ce mouvement typiquement bourgeois à la fois d’accaparement et de dilution, que les politiques queer font résistance (Bourcier, 2019).
Pour Brian O’Doherty (2020) le white cube est un espace
sans ombre, blanc, propre, artificiel, […] dédié à la technologie de l’esthétique. Les œuvres d’art y sont montées, accrochées, distribuées pour étude. Leurs surfaces irréprochables ne sont pas affectées par le temps et ses vicissitudes. L’art y vit dans l’espace d’éternité de l’exposition et bien qu’on y distingue une multitude de « périodes » (le modernisme tardif), le temps n’a pas de prise sur lui. Cette éternité confère à la galerie un statut comparable à celui des limbes ; pour se trouver là, il faut être déjà mort. De fait, la présence de ce meuble bizarre, votre corps, apparaît superflue, c’est une intrusion. (p. 37)
Le phénomène de placardisation n’est pas étranger à ces espaces nus, élitistes et blancs, qui dissèquent les corps artistiques sous une lumière artificielle aveuglante. Pour moi, la placardisation consiste en une opération de musellement culturel qui s’exécuterait entre les quatre murs du white cube. Dans la plus pure tradition chrétienne, l’espace muséal blanc martyrise le sublime qu’il met à mort en le clouant sur ses murs, en attendant son (in)espérée résurrection16. Les artistes dépendent de ces espaces pour survivre ; j’ai soulevé cet angoissant paradoxe dans la gravure Le café de la discorde (Fig. 4) qui confronte deux espaces d’exposition : à gauche celui muséal et à droite celui de l’atelier d’artiste, avec au centre une agression sexuelle du conservateur d’art sur l’artiste.
En m’inspirant de la question de Fabrice Bourlez (2018) : « Le cabinet de l’analyste serait-il un placard ? » Je pose cette autre question : « L’espace de la galerie serait-il un placard ? ». Dans les deux cas la réponse est positive ; des pressions institutionnelles classistes, racistes et sexistes cloisonnent ses contributeur.ices dans des placards disciplinaires anti-relationnels sectorisés et segmentarisés comme autant de petites cages blanches suréclairées, formant le panoptique d’une culture occidentale hautement surveillée et capitalisable.
Fig. 4 — C. Fleury Turcas (2020). Le café de la discorde entre le gardien d’un art millénaire et la gardienne du sien.
Eau-forte sur cuivre.
Zombi-figuration : putréfaction des corps sur la table de dissection
Après avoir déterminé la structure du placard, dans cette deuxième partie je vais analyser plus précisément les processus de défiguration et de stérilisation des corps. Le fil conducteur de cette partie se tracera en filigrane depuis les gravures anatomiques du xvie siècle jusqu’à mon travail en gravure.
-
J’analyserai d’abord l’espace dans lequel les corps ont été défigurés : les théâtres anatomiques où Xavier Bichat a théorisé une rupture du regard clinique et une révolution du rapport occidental à la mort.
-
Je définirai ensuite quels corps sont les plus exposés aux défigurations et j’évoquerai les stratégies de résistance queer contre les pratiques médicales mortifères normalisantes, à travers l’exemple de la figure du sinthomosexuel.
-
Je proposerai ensuite une étude de cas sur l’interaction entre mon travail et le cabinet psychanalytique.
-
Enfin, je ferai le lien entre gravures, normes médicales et réassignations utopiques grâce à une archéologie des œuvres du passé.
Le spectacle de la désinfection esthétique dans les théâtres anatomiques
Dans son ouvrage sur La Naissance de la clinique, Michel Foucault (2012) définit le regard clinique comme « cette paradoxale propriété d’entendre un langage au moment où il perçoit un spectacle » (p. 154) comme dans un véritable tableau. Féru des corps aux exhalaisons mortifères, Xavier Bichat opéra au xviiie siècle une rupture fondamentale du regard clinique en passant d’une clinique des symptômes qui « cherche le corps vivant de la maladie » à une anatomie qui « ne lui en offre que le cadavre » (p. 188). C’est tout un rapport à la mort qui se trouve multiplié et dispersé dans le temps et l’espace du corps. Le regard « anatomo-clinique » de Bichat scrute les cadavres, comme si les surfaces de leurs différentes enveloppes se réfléchissaient dans un miroir qui verrait par-dessus la mort. À l’ouïe et au toucher déjà mobilisés par les pratiques cliniques sensorielles, s’ajoute la vue grâce au « triomphe du regard que sera l’autopsie » (p. 229). La mort est devenue vivante et parlante à travers les couches anatomiques des cadavres.
Les autopsies publiques organisées dans les théâtres anatomiques ont été les structures où un « espace discursif du cadavre » s’est développé autour du dévoilement des intérieurs du corps humain. Les corps des femmes, des anormaux et des invalides s’étalaient sur les tables de dissection (Federici, 2014), entourés de multiples yeux aux paupières blanches opérant une « dissection souveraine du langage et du regard » (Foucault, 2012, p. 271). Le regard clinique s’est affairé à traduire les corps selon des normes anatomiques dictées par une sélection de fragments de corps considérés comme valides et esthétisables. Toutes ces normes engendrent des implications politiques, juridiques, économiques etc., qui positionnent le corps des anormaux.ales, momentanément hypervisibilisés sur la table de dissection, dans une posture culturelle paradoxalement invisible. Le théâtre anatomique immortalise la « découverte » de quelque chose de bizarre [queer] en l’immortalisant quasi immédiatement dans un placard de verre. Cela peut prendre la forme d’un répertoire de dessins anatomiques, mais aussi plus littéralement de bocaux remplis de vitriol qui conservent le bizarre à la manière des Bocaux anatomiques de Stéphane Belzère (Fig. 5).
Fig. 5 — Stéphane Belzère (2001). Bocaux Anatomiques n° 32.
Peinture vinylique sur toile, 50 x 100 cm.
Les représentations anatomiques sont au service d’un invraisemblable carno-phallogocentrisme (Derrida, 1992) qui dépasse la condition humaine et attaque tout son environnement. Pour Thomas Laqueur (1992), de nombreux anatomistes depuis l’antiquité comprenaient la « matrice » « comme un pénis intérieur » (Fig. 6). À mesure que le regard clinique s’aiguisait, les anatomistes ont adapté leurs esthétiques pour inclure « certaines structures [et] pour en exclure d’autres » en éliminant » le trop-plein de fatras qui emplit le corps — graisse, tissu conjonctif et “variations insignifiantes” qui n’ont pas la dignité de posséder un nom ou une identité individuelle » (p. 226). Une véritable désinfection esthétique a eu lieu en s’abattant sur les excédents du corps.
Les souillures produites par des zombi-figurations en décomposition sont époussetées par les esthétiques anatomiques. Sur les tables de dissection, ces esthétiques hygiénistes décortiquent les corps putréfiés et disloqués en les rassemblant afin de les faire rentrer dans les normes de lisibilité du regard clinique. Les normalisations anatomiques opérées du xvie jusqu’au xviiie siècle sont à mettre en perspective avec, par exemple, le traitement des corps transgenres dans l’institution médicale occidentale du xixe siècle jusqu’à aujourd’hui (Serano, 2020).
Fig. 6 — De humani corporis fabrica (1555).
Cette gravure illustrant le livre d’anatomie d'André Vésale représente une vulve et son intériorité qui ressemble à un pénis retourné.
Auto-sublimation stérile du sinthomosexuel
Pour résister aux esthétiques hygiénistes des cubes blancs et des tables de dissection, les esthétiques queer résonnent dans une violence sourde ou retentissante. Elles peuvent se résorber avec le temps, mais rien n’est moins sûr : plus l’évènement esthétique de leur éclatement est violent, plus il fait fracture, plus les formes et les temporalités sont contrariées, plus le sublime risque de percer la contemplation avec fracas. Cette violence, c’est le « retour du grand refoulé » (Lontrade, 2001), c’est le bruit tonitruant des pulsions de mort contre les parois du placard. La psychanalyse s’est spécialisée dans l’analyse de ces sons et les écoute souvent dans un silence de mort (Bourlez, 2018). Au début du xxe siècle, pour Freud (1930/2010) la « sublimation des pulsions » était un moyen de défense contre la souffrance qui protègerait de la « frustration culturelle ». Au milieu du xxe siècle, Marcuse (1963) prônait une « sublimation non-répressive » qui s’accomplirait dans l’érotisation de la vie elle-même et l’abolition du travail et libérerait ainsi l’individu de toutes ses pulsions. Ce remède pulsionnel ça serait l’« auto-sublimation » (Lontrade, 2001).
Or, se sublimer continuellement est justement toute l’affaire du « sainthomosexuel »17 d’Edelman (2016). Le sinthomosexuel serait un « sujet de pulsion », qui incarne la persécution de sa stérilité en acceptant tout simplement sa condamnation à mort dans une jouissance débridée. Il est « toujours un symptôme de lui-même » en perpétuelle quête d’une défiguration du futurisme reproductif. Pour Edelman, la stérilité du sinthomosexuel est
le fardeau éthique auquel la queerité doit adhérer, dans un ordre social résolu à méconnaître son propre investissement dans la morbidité, la fétichisation et la répétition : se placer au lieu même de l’hors sens du sinthome hors sens ; représenter une sexualité non régénérée et non régénérante dont l’insistance singulière sur la jouissance, rejetant toute contrainte imposée par un futurisme sentimental, dénonce la culture esthétique — la culture des formes et de leur reproduction, la culture des appâts imaginaires — comme toujours d’emblée une « culture de mort » qui cherche à rendre abjecte la force de la pulsion de mort quand elle fait trembler la tombe que nous appelons la vie. La pulsion de mort que symbolise le queer refuse donc la calcification de la forme qu’est le futurisme reproductif. (2016, p. 66)
Le sinthomosexuel comme sujet pulsionnel ontologiquement inhumain retentit avec les théorisations de Žižek (2007), qui désigne la pulsion de mort comme « la dimension de ce que la fiction d’horreur appelle le “non-mort”, une vie étrange, immortelle, indestructible qui persiste par-delà la mort » (p. 396). Si la pulsion de mort anime les zombies, elle n’est donc pas si stérile que ça. La pulsion de mort ne biologise pas la création dans une mécanisation avilissante mais rassurante du corps procréateur ; la pulsion de mort réanime la mort dans un mouvement étrange qui terrifie le vivant.
Défiguration dans le cabinet de l’analyste18
En 2020, j’ai gravé Puisque je vous dis que tout va bien (Fig. 7) dans un échec cuisant19. En demandant un retour critique sur mes gravures, on m’a dit : « Les corps ça va, ce sont les visages le problème. » Les visages gâchent mes gravures et ça m’ennuie de les dessiner, alors j’ai arrêté de graver. Pourquoi je n’aime pas dessiner les visages ?
Fig. 7 — C. Fleury Turcas (2020). Puisque je vous dis que tout va bien !
Eau-forte et pointe sèche sur cuivre.
J’ai consulté un·e psychanalyste pour discuter de mes blocages créatifs. Quand j’ai étalé toutes les gravures sur le sol de son cabinet, iel a pointé du doigt la dernière gravure que j’avais faite en me disant : « C’est ça ! » C’était L’impossible vulnérabilité du bâteleur (Fig. 8), dessus on peut voir une figure suspendue par un bondage qui pleure en coupant un oignon. « Ça » semble être le constat ironique de l’anti-sentimentalisme figural coincé dans son placard en forme d’œuf : si le haut de la coquille tombe, la figuration se casse littéralement la gueule dans ses larmes et « ça » lui donne alors une vraie raison de pleurer.
Fig. 8 — C. Fleury Turcas (2021). L’impossible vulnérabilité du bâteleur.
Eau-forte et pointe sèche sur cuivre.
J’ai tout remballé, l’analyste m’a remercié de les lui avoir montrées et ce fut notre dernière rencontre. Les figurations volontairement ratées sont le signe d’un désintérêt pour l’identification. J’ai continué ce processus jusqu’à faire glisser la peau de mes figures pour atteindre les os (Fig. 9). Les fissures de l’œuf du bâteleur (Fig. 8) ouvrent sur La suture (Fig. 1) que j’ai gravé après un an passé loin de ma presse taille-douce. La corde s’est transformée en fil chirurgical et les visages des figures ont perdu leurs yeux, leurs masques ; leur peau s’est décomposée pour devenir des squelettes en cours de calcification. J’ai zombifié les figures.
Cette expérience dans le cabinet-placard analytique a permis la mise en mot d’une défiguration que j’avais déjà écrite dans le langage de la gravure. Mettre des mots sur ses créations se montre utile dans le cadre de cet article par exemple, mais ce n’est pas une thérapie qui remet au travail, puisque, comme je l’ai expliqué dans l’introduction de cet article, la création précède tout. Si c’est la pulsion de mort qui est le moteur de la création, le placard analytique n’aura de cesse de vouloir l’enfermer ou la guérir, là où elle doit s’épandre jusqu’à se résorber elle-même et apparaître inlassablement sous une autre forme.
Fig. 9 — C. Fleury Turcas (2022). Énergie (re)productive.
Dessin préparatoire à l’encre de Chine.
Pacte du sang entre le serpent et l’écorché.e
Les zombies sont perpétuellement assommés par la quête du liquide qui fera palpiter leur chair un peu plus longtemps ; le sang est le liquide de la pulsion de mort. La chair pelée par la défiguration de l’écorché.e vif.ve forme une collerette autour de son cou qui rappelle les gravures tailles-douces de Casseri (Fig. 10). La scène proposée dans Puisque je vous dis que tout va bien (Fig. 7) trouve sa suite logique dans La suture (Fig. 1), dans ces deux gravures le sang coule depuis l’anus ou le long des bras. Le serpent responsable de ces saignées désorganise les organes, les expose à l’extérieur du corps jusqu’à ce qu’ils se décomposent et disparaissent. Le serpent fait allusion au caducée, il s’enroule autour du corps pour transpercer les figures. Ce processus de zombi-figuration est aussi visible dans La suture avec la représentation de l’écorché.e que le serpent vide de son sang en mordant son corps à répétition. Le serpent n’est pas assoiffé de sang, son but est de transpercer les corps ; il laisse le sang couler mais ne s’en nourrit pas.
Fig. 10 — G. Casseri (1627), De humani corporis fabrica libri decem.
Gravure à l’eau-forte illustrant Adriaan van den Spiegel.
Pour Frédérique Villemur (2007) la ligne serpentine définit « un équilibre instable et fragile » lorsqu’elle s’allie avec la « nonchalance » de la sprezzatura, particularité esthétique de la Renaissance italienne qui consiste à rendre invisible quelque chose « qui travaille pourtant les formes ». Les esthétiques queer seraient ainsi fondées sur « la surdétermination anachronique des représentations » inviteraient « à prêter son regard de queeriosité aux œuvres dites “du passé” » (p. 166). Pour l’archéologue Marija Gimbutas (2005), qui a relevé de nombreux motifs (Fig. 11) présents sur les vases et figurines funéraires de la vieille Europe, les enroulements de serpents, spirales, tourbillons, croissants, triangles, lignes triples, et lignes serpentines véhiculaient « un message en rapport avec la force de vie régénératrice ou la transformation cyclique entre la vie et la mort » (p. 231). J’ai gravé quelques-uns de ces motifs à la pointe sèche sur des eaux-fortes ; ce sont des tatouages sur les corps pulsionnels que je représente mais aussi des marques qui estampillent les décors. Sur la table du bâteleur (Fig. 8) j’ai gravé les crosses que j’avais vues gravées dans la pierre de la Table des marchands sur le site mégalithique de Locmariaquer (Fig. 12). Avec la zombie-figuration, les figures perdent leurs identités et se fragmentent, se décomposent et se mélangent dans l’espace et le temps. Elles sont animées par une étrange pulsion de mort à la fois stérile et immortelle.
Fig. 11 — Statuette néolithique. 5300 avant notre ère.
Terre cuite. Passo di Corvo, Italie Sud. Signes et symboles répertoriés sur des figurines de la culture Vinča. 5200-4000 ans avant notre ère.
Fig. 12 — An Daol Varchant [La table des marchands]. 3500-3000 avant notre ère.
Pierre. Locmariaquer, Morbihan, France.
Suture psychanalytique : tentative de résurrection
Une fois les corps défigurés sur la table de dissection, leur stérilité s’est condensée dans la figure du sinthomosexuel : grâce à la suture, la zombi-figuration pourrait permettre de réassembler les corps estropiés par les découpes normalisantes du scalpel. Dans cette dernière partie, je caractériserai les esthétiques mobilisées dans le processus psychanalytique de la suture.
-
J’approfondirai d’abord la définition de la pulsion de mort à partir des conceptualisations freudiennes jusqu’à celles de Teresa de Lauretis. Ces définitions seront entrelacées avec une critique de l’esthétique inorganique selon Mario Perniola.
-
Je reviendrai ensuite sur une définition de la pulsion de mort comme une figure de passage à travers un Corps sans Organes qui révèlerait les esthétiques du Difforme et de l’Informe.
-
Je proposerai une analyse plastique de La Suture que j’intercalerai avec la définition psychanalytique de la suture proposée par Jacques-Alain Miller.
-
Enfin, j’analyserai une œuvre d’Omar Mismar et conjuguerai sa navigation relationnelle homoérotique avec les binarismes présence/absence et relationalité/anti-relationalité du « même » dans l’art, remarqués par Léo Bersani.
Nécrophilie esthétique : entrer en relation avec la matière inorganique
La nécrophilie esthétique commence avec les conceptualisations du Todestrieb de Freud qu’il oppose aux instincts de vie (Éros) :
les instincts de vie présentent des rapports d’autant plus étroits avec nos sensations internes qu’ils se présentent toujours en trouble-paix, qu’ils sont une source inépuisable de tensions incessantes dont la résolution est accompagnée d’une sensation de plaisir, tandis que les instincts de mort semblent travailler en silence, accomplir une œuvre souterraine, inaperçue. (1920/2004, p. 57)
Teresa de Lauretis (2010) propose une traduction du Todestrieb non comme instinct mais comme pulsion de mort qui serait une « présence dans l’organisme humain d’une force antithétique à la vie » (p. 97) et
une tendance de la vie psychique à revenir à un état de quiétude pulsionnelle qui n’est pas seulement la mort de l’organisme physique, comme lorsqu’un corps devient cadavre, mais un état dans lequel le niveau d’excitation présent dans l’appareil psychique est réduit à zéro. Autrement dit, la pulsion de mort est une force psychique qui travaille à délier l’énergie psychique, à la détacher à la fois du moi et des objets (les autres), et à abaisser son niveau en dessous du seuil fixé par le principe de plaisir jusqu’à l’état inerte. (p. 128)
Le degré zéro d’excitation dans l’appareil psychique ressemble à « l’absence de l’esprit » dans les derniers instants orgasmiques de la pléthore misogyne de Georges Bataille (2011), qu’il nommait « petite mort ».
L’état inerte des pulsions de mort ne rentre pas dans la définition de ce que l’esthéticien Mario Perniola (2001) appelait le « sex appeal de l’inorganique ». L’après-désir chez Perniola conserve des tensions, mais son étonnement est posthumaniste : la « chose sentante » est désaliénée de toute organicité et de toute intériorité. La réactivation de l’inorganique chez Perniola se produit grâce à l’extrême disponibilité requise par « la sexualité neutre » qui trace des contours de l’universel, en prenant bien soin d’éviter les incarnations politiques qui pourraient dire « non » et contrarier la pleine disponibilité sadienne (Barthes, 2002).
Avec la théorie du charme inorganique, Perniola esquive la dimension relationnelle dans l’esthétique permise par le consentement par exemple. Perniola ne questionne pas suffisamment les fluctuations relationnelles ; pourtant il parle bien d’une « excitation » qu’il pose d’emblée comme « assouvie », mais qui « implique une réciprocité » et « un sentir commun entre les partenaires qui s’y engagent », mais les échanges s’arrêtent là. Le trouble dans les relations n’est pas questionné : la relation esthétique est d’ores et déjà acquise et s’appuie sur le partage d’un « enthousiasme intellectuel » qui dérive de la « philosophie ». Cet axiome sapiosexuel (Robles, 2022) du « vêtement sentant » n’offre pas la possibilité du trouble d’une boursoufflure.
Les réflexions de Perniola s’inspirent de celles de Benjamin (1989), pour qui la mode entrait « en conflit avec l’organique » et défendait « les droits du cadavre ». Il n’y a pas de cadavres dans le charme inorganique qui séduit Perniola. L’esthéticien préfère la désincarnation immortelle d’un futurisme esthétique anti-relationnel avec sa parure métallique de poupée-cyborg, plutôt que les pulsions de mort qui font bouger les vêtements en lambeaux sur la chair en compost des zombies terreux. C’est parce que l’inertie de la matière inorganique exerce une attraction sur la matière vivante (de Lauretis, 2010) que le compost20 fertilise à nouveau les surfaces stériles dans un mouvement bizarre et dérangeant, à la fois parasite et vitaliste.
Des informités du corps sans organes, aux difformités de la peau des morts-vivants jusqu’à la pulsion de mort qui les anime
Les morts-vivants transhistoriques trouvent leur philosophie dans la désarticulation intrinsèque du « corps sans organes » théorisé par Deleuze et Guattari (1980). Pour les philosophes, les strates du Corps sans Organes fonctionnent comme des liens, il y aurait trois grandes strates qui ligotent :
La surface d’organisme, l’angle de signifiance et d’interprétation, le point de subjectivation ou d’assujettissement. Tu seras organisé, tu seras un organisme, tu articuleras ton corps – sinon tu ne seras qu’un dépravé. Tu seras signifiant et signifié, interprète et interprété – sinon tu ne seras qu’un déviant. Tu seras sujet, et fixé comme tel, sujet d’énonciation rabattu sur un sujet d’énoncé – sinon tu ne seras qu’un vagabond. À l’ensemble des strates, le CsO [Corps sans Organes] oppose la désarticulation (ou les n articulations) comme propriété du plan de consistance, l’expérimentation comme opération sur ce plan […], le nomadisme comme mouvement. (Deleuze et Guattari, 1980, pp. 197-198, je souligne)
Être désarticulé ce serait donc cesser d’être un organisme. Les conclusions que tirent Deleuze et Guattari trouvent leurs sources dans les esthétiques de l’Informe du poète Antonin Artaud (Plana, 2015). Dans le cas d’un corps figuré, la désarticulation ne peut pas s’opérer sans déformer ou fendre la peau dont la porosité en fait un véritable organe-limite. La boursouflure queer forme un excès sur « la peau du moi » (Anzieu, 2006) et rejoint les esthétiques du Difforme (Plana, 2015). Sur cet arrière-plan philosophique deleuzien, l’anticipation queer anti-prophétisée par Muriel Plana (2021) propose l’expérimentation des esthétiques de l’Informe et du Difforme comme pratiques d’émancipations politiques perturbatrices et transcendantales qui permettraient de « voir l’avenir et penser le temps ».
Le principe régénérant de la peau offre sans doute assez de résistance et d’élasticité aux pulsions de mort pour qu’elles se répètent, silencieusement ou avec fracas, en mettant sans cesse son organicité à l’épreuve. Ces pulsions font pressentir aux corps qu’elles martèlent « le cadavre implicite ou présent dans l’organisme, la matière sans vie que deviendra la matière vivante en tant que “mémorial sans archives du temps” » (de Lauretis, 2010, p. 111). Pour Deleuze et Guattari, le Corps sans Organes est, avec ses plateaux, « une composante de passage » ; pour de Lauretis la pulsion de mort est une « figure de passage », voire même « l’espace d’une transition ». Par rapport à la définition de la pulsion de mort d’Edelman, de Lauretis préfère laisser tomber la jouissance permise par l’identification figurale queer à la pulsion de mort au profit des « figures étranges [queer] de transition dans l’espace inhabité entre l’esprit et la matière » que permettent ces pulsions.
Suturation morte-vivante : geste ironique d’un squelette qui tente de soigner un zombie
Pour Deleuze et Guattari (1980), le Corps sans Organes est un corps masochiste dont les orifices, les trous et les béances sont cousues. Mais avec quel fil ? Le fil rouge utilisé dans La suture (Fig. 1) est le même utilisé pour façonner cette petite statuette en argile (Fig. 13). C’est un liant plastique : le squelette tend un fil rouge avec lequel il tente de recoudre les deux bouts de chairs séparés du zombie. Sa tête ouvre grand la mâchoire pour couper l’excédent du fil qui pend entre ses doigts. Un nœud de rosette ferme les points de suture encore béants. Ce procédé plastique je l’ai appelé le filament, sa couleur incarnate s’enfonce dans la chair. C’est le signe du pacte, du choix. Il permet des mobilités et des transitions relationnelles internes et externes.
Fig. 13 — C. Fleury Turcas (2021). Sans titre.
Argile, acrylique, fil, aiguille et tissu imprimé avec la gravure Le café de la discorde (voir Fig. 4).
Il y a deux figures : un squelette et un zombie penché vers l’avant, les bras ballants, dans une posture transhistorique et transculturelle, quelque part entre Orochimaru (Fig. 14) et les écorché.es de Vésale (Fig. 15).
Fig. 14 — Masashi Kishimoto (2002). Naruto.
Shōnen Jump.
Fig. 15 — De humani corporis fabrica (1555).
Gravure sur bois illustrant André Vésale
Un serpent s’enroule autour de sa jambe droite. Il tient un comprimé de morphine sur le bout de sa queue, sa formule chimique est tatouée sur l’autre jambe. Je voulais appeler cette gravure « consentement sous morphine », comme on peut le voir sur le croquis préparatoire (Fig. 16). J’ai changé en lisant cette phrase d’Edelman (2016) :
Là où le futurisme anticipe toujours, sous la forme d’un passé imaginaire, une réalisation de sens qui suturera l’identité en fermant cette faille, la queerité défait les identités par lesquelles nous faisons l’expérience de nous-mêmes en tant que sujets, insistant ainsi sur le réel d’une jouissance que la réalité sociale et le futurisme dont elle dépend ont déjà forclos. (p. 37)
Fig. 16 — C. Fleury Turcas (2020-2022). Crayonné de La suture.
La suture ça marchait mieux et c’était moins long. À gauche du rideau, une mouche vole : c’est un rappel à l’ordre du cadavre encore debout, en voie de décomposition, c’est elle qui met les premiers vers dans la pulsion de mort.
Pratiquer la couture sur du papier se rapproche de la pratique de la suture en psychanalyse : elle est condamnée à un échec systématique. Dans les Cahiers pour l’analyse, Jacques-Alain Miller (1966) reprend un exposé prononcé par Lacan à un séminaire de février 196521, pour lui, la méconnaissance serait au départ de la production, pas comme un oubli, mais comme un refoulement. L’ensemble de ce processus est la suture, elle « nomme le rapport du sujet à la chaîne de son discours » (p. 39). La suture « y figure comme l’élément qui manque » (p. 39). Plus loin Miller ajoute que « percer la suture demande qu’on traverse ce qu’un discours explicite de lui-même — qu’on distingue, de son sens, sa lettre » (p. 40). La suture psychanalytique essayerait de faire vivre une « lettre-morte ». Miller prévient : « qu’on ne s’étonne pas que le sens en meure » (p. 40). La suture est une pratique de morts-vivants : elle veut empêcher le corps du zombie de se décomposer. La psychanalyse pratique la suture résurrective : avec son fil brodé de non-sens, la suture essaye de gommer les traces des autopsies et des blessures. La suturation serait alors le geste du·de la médecin-soignant·e qui se confronte aux impossibilités de soigner complètement.
Edelman (2016) affirme qu’en refusant la promesse du futurisme reproductif qui « reprisera la robe de la réalité en recousant les trous, aussi gros soient-ils, avec des fils de sens » (p. 49) la sinthomosexualité offrirait alors « un fantasme mis sens dessus dessous ». Pour Fabrice Bourlez (2018) « si la psychanalyse se met en chemin face à l’énigme d’un symptôme qui se refuse à l’explication logique, c’est pour, en fin de parcours, atteindre ce point non suturable d’où émerge notre singularité : la faille réelle qui nous anime » (pp. 228-229). La suturation pour Bourlez serait les « tentatives de colmater une brèche inobturable », c’est un geste vain.
Dans son œuvre Strange fruit (Fig. 17), Zoe Leonard pratique la suture sur des peaux de fruits pour en reconstituer les corps vidés et consommés. Quand on a demandé à l’artiste de conserver ces fruits qui pourrissaient et disparaissaient des galeries, l’artiste a répondu que « la lente disparition de l’œuvre faisait partie intégrante de sa nature » (Lorenz, 2018). Ces fruits suturés font suite à l’épidémie du SIDA et à la disparition de David Wojnarowicz22 en 1992. Elle présente ses sculptures comme travaillant « sur les relations et les émotions », qui renvoient « à la tentative, aussi attentionnée et aimante que futile et foncièrement insuffisante peut-être, de prendre soin et d’apporter son soutien ».
Fig. 17 — Zoe Leonard (1992-1997). Strange fruit.
Sculpture. Deux-cent-quatre-vingt-quinze peaux de bananes, oranges, citrons, raison et avocat, fils, fermetures éclair, boutons, plastique, câbles autocollants, tissus, garniture, cire. Dimensions variables. Dietrich Foundation.
Relations stériles : la drague des morts-vivant.es
The path of love retrace les balades de dragues (Lopez, 2022) d’Omar Mismar à travers la ville de San Francisco. Pour naviguer dans les rues, l’artiste utilisait l’application de géolocalisation et de rencontres Grindr qui lui indiquait la présence d’hommes à proximité ; durant trente jour l’artiste choisira un homme qu’il désire et essaiera d’être le plus proche de lui en utilisant l’application. Mismar a enregistré les chemins qu’il a parcouru et les a cartographiés. Le tracé de certains chemins a été retranscrit puis installés sous forme de néons (Fig. 18). Pour lui, le désir semble exister quelque part sur le chemin relationnel qu’il trace entre les moments d’absence et de réunion.
Fig. 18 — Omar Mismar (2013-2014). The path of love.
Installation néons. San Francisco.
En affirmant que « tout amour est homoérotique », Léo Bersani (2011) pousse l’« extensibilité du même » aux frontières de la relationnalité et de l’anti-relationnalité. Cet « apprentissage d’une relationnalité fondée sur le même plutôt que sur la différence » (p. 71) permettrait
la perception des correspondances formelles qui relient dans une seule « famille » tous les objets, tous les êtres de l’univers. Ceci pourrait même aller jusqu’à ce qui semble être une véritable trahison, une antirelationnalité absolue qui serait peut-être l’étape négative préliminaire à la création d’une communauté anti-identitaire. (Bersani, 2011, p. 71)
L’art serait ainsi le site privilégié « d’une vision de l’être comme devenir relationnel ». La conjugaison des arts plastiques, de l’esthétique et de la psychanalyse, pourrait peut-être esquisser une esthétique queer des relations. Dans l’espace clinique, cette esthétique relationnelle se retrouve dans la position de l’analyste comme « celle du mort » (Lacan, 1966) qui pourrait se traduire par celle du squelette que j’ai dessiné dans La suture (Fig. 1).
Lorsque Fabrice Bourlez (2018) invite les analystes à « sortir les squelettes du placard », il signe la possibilité d’un devenir homo-analyste et la consécration d’une clinique « mineure ». De nouveaux types de relation seraient en jeu dans l’espace clinique. Là où les horizons futurs semblaient fermés, la méthodologie des « affects critiques » développée par Muñoz (2021) répondrait à la demande queer de nouvelles expériences sensibles de pensées alternatives, « anti-essentialistes et artificialistes » de la relation (Plana, 2021). Les esthétiques queer des relations faciliteraient le dialogue entre l’humain et l’inhumain, entre le normal et le monstrueux, entre l’organique et l’inorganique, le mort et le vivant etc. Léo Bersani (2011) remarque que « si l’art célèbre la capacité d’extensibilité dans l’espace qu’ont tout objet et toute créature […] il le fait en inscrivant aussi dans la relationnalité la possibilité qu’elle n’ait pas lieu » (p. 132), et comme « le relationnel est lui-même lié à sa propre absence » (p. 132) les psychanalystes ont de beaux jours devant eux pour jouer les mort.es et accumuler les transferts.
* * *
Tandis que les corps difformes et informes sont mis au placard, les normes sont dessinées par des lames de scalpels qui exhalent une véritable anatomie du zombie. C’est la pulsion de mort qui vient leur redonner vie. C’est en répétant inlassablement les vides et les pleins dragués par la suture psychanalytique que la clinique ressuscite des corps voués à la décomposition. Les clinicien.nes retracent les parcours de la pulsion de mort au sein des discours-aveux des analysant.es. Il semblerait pourtant que cette pulsion existe et survive essentiellement grâce au langage, comme une souffrance ontologique que la clinique entretiendrait autant qu’elle soulagerait.
Dans La suture, un squelette drague un zombie en « pen/ansant » (Bourlez, 2018) ses plaies insuturables. Leur relation est esthétique et asexuelle. Depuis le placard, iels font l’amour sans jamais se toucher : le transfert est figuré par le geste qui coud le filament rouge incarnat de la suture. Ces figures bizarres sont sans cesse traversées par des pulsions de mort qui « s’acharnent à élargir l’inhumain » (Edelman, 2016) en se plongeant dans le Difforme et l’Informe de troublantes boursoufflures.
Conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêt déclaré.
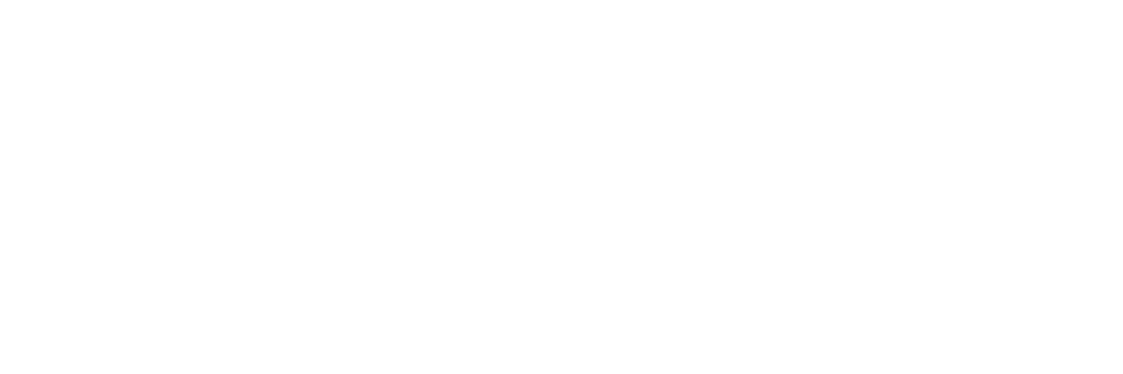













![Fig. 12 — An Daol Varchant [La table des marchands]. 3500-3000 avant notre ère.](docannexe/image/230/img-14-small800.jpg)





