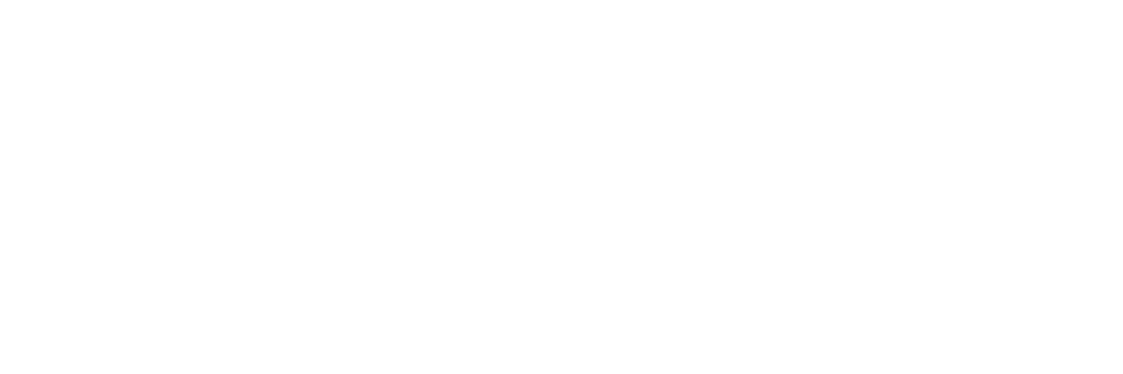Introduction
Accrochés aux murs de l’appartement, un ukulélé, un bonnet, un sabre et le symbole d’une fleur de Lys ; au centre de la pièce, un homme blanc, blond, et corpulent se fouette le dos avec une ceinture, en hurlant et sanglotant : « Sorry I’m male, sorry I’m white, sorry I’m male, sorry I’m white. Why ? Why am I a monster ? ». Sous la vidéo, une légende : « How I feel when I read about feminism », exprimant une opinion répandue selon laquelle les luttes et discours féministes produiraient, chez les hommes blancs, culpabilité et auto-flagellation. Certains des commentaires sous la vidéo pointent cependant un oubli : « Forgot “Sorry I’m heterosexual” », ou bien « He didn’t apologize for being straight ». Ainsi, non seulement le féminisme se voit accusé de produire de la culpabilité à l’endroit du masculin comme position de genre dominante (« Sorry I’m male »), mais également à l’endroit de la blanchité comme position de domination sur l’axe de la race (« Sorry I’m white »), et vis-à-vis du désir des hommes pour les femmes (« Sorry I’m heterosexual »). Ces discours se présentant comme politiques (en visant, par exemple, la transformation des institutions et de la société) seraient de l’ordre d’une nouvelle morale tyrannisant les individus et leurs désirs. Parce que le rapport entre culpabilité et désir fait l’objet d’une attention au sein de la théorie psychanalytique, nous voudrions nous pencher plus particulièrement sur ce dernier point, car il est un exemple des discours qui voient, dans la diffusion des idées féministes et dans le progrès des luttes sociales, la source d’une nouvelle « moralisation » du désir, moralisation à tendance religieuse qui produirait un sentiment de culpabilité à l’endroit du désir des hommes pour les femmes.
Notre propos est double. D’abord, il s’agit de reconnaître l’existence d’une forme de culpabilité chez certains hommes cisgenre désirant exclusivement ou partiellement les femmes et recevant les discours féministes. Ces discours, et notamment ceux que nous appellerons ici les critiques politiques du désir, semblent produire une remise en question de la part de ces hommes, ainsi que, dans certains cas, un affect de culpabilité à l’endroit de leur désir. Nous entendons des hommes sensibilisés aux questions féministes exprimer ce type de culpabilité : les uns s’accusent de regarder du porno hardcore et d’avoir des fantasmes de domination, les autres craignent d’être des mecs toxiques, d’autres encore jugent leurs désirs unsafe. La sensibilité aux critiques et aux théories féministes semble parfois aller de pair avec un sentiment de culpabilité, une crainte d’exercer un effet de domination par le fait même de désirer. Notre thèse consiste à affirmer que l’existence de cette culpabilité ne doit pas être niée, au risque de laisser aux seules pensées réactionnaires le champ de l’analyse de cette culpabilité. Cependant — et c’est là que nous souhaitons intervenir —, elle ne saurait être attribuée aux luttes et aux discours féministes. La culpabilité des hommes vis-à-vis de leurs désirs pour les femmes ne résulte pas des analyses féministes sur le désir, mais plutôt d’une mauvaise réception de celles-ci, déterminée par une articulation étroite entre désir et culpabilité. Il s’agit de se défaire de l’idée selon laquelle cette culpabilité résulterait des discours féministes, afin de montrer que sa source réside dans le passage entre la critique politique et le rapport de ces hommes à leur propre désir, c’est-à-dire dans l’embranchement entre le politique et la singularité psychique.
Nous proposons d’aborder cette problématique à partir de trois axes de questions :
-
Premièrement, un ensemble de questions concernant la nature et l’objet de cette culpabilité : de quoi ces hommes se sentent-ils coupables ? Quel est l’objet de cette culpabilité éprouvée à l’endroit du désir pour les femmes ? Comment les discours féministes ont-ils pu permettre aux hommes de s’approcher d’une ambivalence propre à leur désir, et comment cela a-t-il pu conduire à une culpabilité ?
-
Deuxièmement, un autre ensemble de questions portant sur les effets délétères de cette culpabilité. Si les discours féministes sont d’abord des discours politiques, sur quel mode certains hommes reçoivent et intériorisent-ils ces discours, de manière à en épuiser le caractère politique ? Que produit cette culpabilité, à la fois sur le plan de la singularité psychique, et sur le plan socio-politique ?
-
Un troisième ensemble de questions qui concerne les voies possibles de dépassement de cette approche moralisante et culpabilisante de la critique. Loin de vouloir nier l’importance du questionnement des hommes sur leurs désirs, il s’agit de chercher à définir la manière dont il est possible d’intérioriser les questionnements politiques du désir, sans pour autant s’enfermer dans une culpabilité qui dépolitise le propos. Face au problème, comment construire les conditions d’une responsabilité singulière relative à son désir qui puisse s’articuler à l’action politique ?
Nous progresserons alors en trois étapes, lesquelles scanderont un glissement progressif d’une « morale du désir » à une approche « éthique » du désir, un glissement qui est celui de la culpabilité vers celui de la responsabilité. Dans la première partie, nous ferons retour à l’histoire de la critique féministe du désir des hommes envers les femmes, d’abord pour en montrer la puissance et l’intérêt, mais également pour montrer le risque d’une interprétation moralisante ou culpabilisante. Dans un second temps, il s’agira de comprendre, à travers le concept d’interpellation, comment la critique politique se traduit psychiquement en moralisation, et comment cette traduction conduit à une dépolitisation et se confronte à la résistance du désir. Enfin, en travaillant l’articulation entre désir et culpabilité sur le plan psychique, nous aborderons la possibilité d’une sortie de la culpabilité à partir d’une position de « responsabilité » par rapport au désir. C’est notre conviction que la reconnaissance, par les hommes qui désirent les femmes, d’une ambivalence de leur désir, permet de déconnecter intention et exécution, et produit ainsi des effets politiques positifs.
Les critiques politiques du désir contre l’érotologie de la domination patriarcale1
Dans la mesure où notre objet concerne moins la culpabilité d’être un homme que la culpabilité liée au fait de désirer des femmes en tant qu’homme, il s’agit d’aborder le problème non pas à partir de la dimension du genre en général (masculinité, virilité, etc.), mais en prenant directement en compte l’articulation entre genre et désir. Or, cette articulation, ainsi que l’idée que le désir jouerait un rôle dans l’existence et la reproduction d’un système politique patriarcal, n’a pas toujours été une évidence. D’où nous vient alors cette idée que le désir des hommes pour les femmes jouerait un rôle essentiel dans la reproduction des rapports de pouvoir patriarcaux ? Les discours féministes qui ont vu naître la critique politique du désir portaient-ils un agenda moralisateur ou l’appel à une discipline du désir ? Cette première partie nous permettra à la fois de montrer la force de l’impulsion qui a fait naître les critiques politiques du désir, tout en soulignant que, dès le début, le problème de la moralisation s’est trouvé être un enjeu de ces discours.
Genre et désir : féminisme et psychanalyse
La mise au centre du désir dans l’approche des mécaniques patriarcales s’est faite au moment où l’articulation entre féminisme et psychanalyse a été rendue possible, notamment grâce à la relecture lacanienne de la théorie freudienne2. L’année 1974 marque, en Angleterre comme en France, une effervescence particulière à ce sujet puisque sont publiés Psychoanalysis and Feminism de Juliet Mitchell (1974) et Speculum de l’Autre femme de Luce Irigaray (1974). L’année suivante, en 1975, Laura Mulvey publie « Visual Pleasure and Narrative Cinema », mobilisant la théorie lacanienne pour comprendre le rôle du désir dans l’objectification cinématographique du corps féminin. Nous nous focaliserons sur le travail de Mulvey, lequel a eu un impact non seulement sur la théorie, mais également sur les discours populaires, notamment car elle y invente le concept de male gaze. Les analyses proposées par Mulvey vont être structurantes d’une approche critique du désir masculin à partir des représentations culturelles du corps féminin.
Avec Laura Mulvey, la théorie psychanalytique est à penser « comme une arme politique » (1975/2017, p. 33), dans la mesure où elle permet l’analyse de l’inconscient patriarcal. En parlant d’inconscient patriarcal, Mulvey fait alors du désir un élément central dans le fonctionnement de la domination patriarcale, l’inconscient étant avant tout composé de représentations de pulsions, et donc de désirs (Freud, 1915/2005a, 1915/2005). Elle accorde à la théorie psychanalytique de l’époque le pouvoir de « nous faire avancer dans la compréhension du statu quo et de l’ordre patriarcal dans lequel nous sommes enfermés » (Mulvey, 1975/2017, p. 35) et se réfère à Jacques Lacan, dont les théories du stade du miroir3 et du regard comme objet a4 lui permettent d’analyser la construction cinématographique du désir. Le cinéma narratif classique serait alors à comprendre à partir de la pulsion scopique et du regard. La thématique de la pulsion scopique permet d’articuler théorie psychanalytique et analyse féministe, dans la mesure où « dans un monde gouverné par l’inégalité entre les sexes, le plaisir éprouvé à regarder s’est trouvé divisé entre l’actif/masculin et le passif/féminin. Le regard masculin, déterminant, projette ses fantasmes sur la figure féminine, laquelle est façonnée en conséquence. » (Mulvey, 1975/2017, pp. 40-41) Le cinéma reflète la construction de la pulsion scopique comme prérogative masculine et renforce le fonctionnement fétichiste de cette tendance : le corps féminin est, par la pulsion scopique, nié en tant que porteur d’une subjectivité et transformé en objet fétichisé.
Pour Mulvey, c’est l’angoisse de castration5 qui motive l’ambivalence du désir masculin envers le corps féminin, une ambivalence entre recherche du plaisir et destruction du corps. La subjectivité masculine — celle que porte et soutient le cinéma mainstream — voit dans le corps féminin un rempart à l’angoisse lié à la possibilité d’un état meurtri et impuissant du corps, tout en appréhendant le corps féminin comme symbole de castration et de privation. Le corps féminin est alors à la fois objet de plaisir et instance menaçante. Selon Mulvey, le cinéma propose deux solutions à ce conflit : la solution sadique, qui consiste à punir la femme d’être un symbole de castration, et la solution fétichiste, qui consiste à aplatir l’image de la femme en une idole non-menaçante et rassurante (Mulvey, 1975) Dans les deux cas, le désir masculin s’appuie sur la négation du corps féminin en tant que corps vivant : il s’agit de le détruire ou bien d’en faire une image sans profondeur.
Mulvey propose ici une manière nouvelle de lire les objets culturels à la lumière de leur construction érotique. Cette critique articule les outils psychanalytiques et les perspectives politiques féministes, et situe la construction du désir masculin envers les femmes au cœur de la reproduction du système de domination patriarcal.
Représentations et violences
C’est dans les années 1970 et 1980 que se développent en Angleterre et aux États-Unis les approches critiques des objets culturels à partir du désir des hommes envers les femmes et de sa construction comme désir de violence et de destruction. Certains développements théoriques iront plus loin que l’hypothèse d’un inconscient patriarcal reflété et renforcé par les représentations culturelles. Pour quelques féministes radicales comme Catharine MacKinnon, certaines représentations du corps féminin — pornographiques notamment — constituent en elles-mêmes une violence faite aux femmes, et le désir qui soutient le visionnage de ces représentations n’est pas la source psychique d’une violence, mais une partie de la violence elle-même.
Le cas des représentations pornographiques nous intéresse tout particulièrement, puisque la culpabilité exprimée par les hommes qui désirent les femmes concerne souvent le visionnage de contenus pornographiques jugés « hardcore », ainsi que le fait d’y prendre du plaisir. Derrière cette culpabilité semble se cacher la crainte, voire la reconnaissance coupable d’une influence de la pornographie « hardcore » sur leur désir et leur manière de jouir, comme si le désir suscité par le visionnage constituait, d’emblée, une faute ou une violence (Vörös, 2020).
Chez MacKinnon, l’idée selon laquelle le désir des hommes pour les femmes constitue une violence en soi, et non le contenu d’un inconscient qui motiverait la violence, est centrale. Pour elle, la théorie féministe a alors pour tâche d’analyser la manière dont « l’érotisation de la domination et de la soumission crée le genre, la femme et l’homme, sous les formes sociales que nous connaissons » (MacKinnon, 1983a/2005, p. 73). Dans ce cadre, le désir des hommes pour les femmes, parce qu’il fonctionne par « objectification » (ibid., p. 74) et notamment « chosification visuelle » (ibid., p. 79) constitue en soi un faire, un acte par lequel le corps des femmes est transformé en objet.
C’est cette dimension performative qui est au cœur de la condamnation de la pornographie par MacKinnon. Pour elle, la pornographie n’est pas seulement la représentation d’une violence, mais bien une violence en soi, exercée contre les subjectivités corporelles féminines :
La pornographie n’enseigne pas uniquement la réalité de la domination masculine, elle est l’un des moyens employés pour l’exercer et l’imposer. C’est une façon de voir et d’utiliser les femmes. Le pouvoir masculin donne autorité à cette vision, à cette manière de traiter les femmes, de sorte que quand un homme voit une image pornographique […] son regard est un acte, un acte de domination […]. (MacKinnon, 1982/2005, pp. 174-175)
MacKinnon refuse alors la distinction entre la violence de la domination matérielle et celle des représentations porteuses d’une idéologie qui soutiendrait un système de domination. Ainsi formulé, le féminisme radical de MacKinnon semble faire de certaines formes du désir des hommes envers les femmes l’objet d’une condamnation morale.
La critique politique du désir conduit-elle à une morale du désir ?
La prise de position abolitionniste de MacKinnon au sujet de la pornographie peut en effet laisser penser que son approche relève de la morale. Pourtant, c’est précisément l’inverse : la condamnation de la pornographie par MacKinnon est une condamnation politique, et c’est en situant la lutte et l’analyse à un niveau politique que MacKinnon entend justement refuser une approche en termes moraux. Dans son article « Ce n’est pas un problème de morale » (1983b/2005), elle critique l’approche moralisante qui écrase la dimension politique au profit d’une responsabilité individuelle :
Cette conception individualisée, atomisée, linéaire, isolée, délictueuse — en un mot positiviste — du préjudice ne correspond pas à la manière dont la pornographie cible et définit les femmes pour les soumettre à des actes d’abus et de discrimination. Si elle atteint les individus, ce n’est pas sur une base individuelle, mais en tant que membres du groupe « femmes ». […] Sa causalité est essentiellement collective, globale, référentielle. (MacKinnon, 1983b/2005, p. 219)
Bien consciente qu’une approche morale et individuelle conduirait à oublier la dimension globale et politique du phénomène, la véhémence de MacKinnon par rapport à la pornographie n’implique alors pas une posture qui moralise le phénomène. Bien que nous puissions être en désaccord avec la proposition de MacKinnon (Rubin, 1992/2010), la solution de l’abolition de la pornographie reste une proposition politique plutôt que morale. En effet, il ne s’agit pas de susciter la culpabilité des hommes qui désirent les femmes, mais d’en appeler, ici, à une interdiction juridique.
Ainsi, qu’il s’agisse de Mulvey ou bien de MacKinnon, les critiques évoquées ne proposent pas une approche moralisante et disciplinaire du désir, mais bien une approche théorico-politique. Mulvey propose un projet d’analyse soutenu par un projet de transformation culturelle. MacKinnon, quant à elle, propose une théorie de la représentation comme acte dans la perspective d’une interdiction de la pornographie. Or, si le contenu des discours féministes ne constitue pas une moralisation ou une culpabilisation du désir des hommes, alors la source de ce phénomène n’est-elle pas à aller chercher du côté de certains modes de réception de ces discours ?
La réception du discours féministe comme interpellation et l’exigence d’un espace psychique safe
Avant d’aborder le sentiment de culpabilité d’un point de vue psychique, il s’agit, dans un premier temps, de chercher à comprendre la façon dont sont reçus et intériorisés les discours féministes. Si ces discours sont d’abord des discours politiques, sur quel mode les hommes qui se sentent coupables de désirer les femmes reçoivent et intériorisent-ils ces discours ? Comment désigner conceptuellement un type de réception qui convertit une revendication sociale en une culpabilisation individuelle ? Par quel processus le discours social est-il ici converti en récit individuel, et comment ce processus de conversion épuise-t-il le caractère politique de la critique ?
La traduction psychique de la critique politique comme interpellation
Nous arrivons ici au cœur de notre problème, qui est celui de la production de la culpabilité par le biais — et non à cause — du discours féministe. Il s’agit de proposer une hypothèse pour comprendre l’émergence de cette « mauvaise conscience » afin de mieux saisir le retournement singulier par lequel la parole politique des femmes circulant dans l’espace public se trouve ici convertie en culpabilité individuelle. Comment comprendre ce pli par lequel un discours politique se trouve transformé et enfermé en une vérité intérieure ? Comment comprendre cette subjectivation singulière du discours critique, et pourquoi pose-t-elle problème du point de vue d’une politique féministe ?
Pour éclairer ce retournement, nous pouvons nous appuyer sur la lecture du concept d’interpellation proposé par Louis Althusser et relu par Judith Butler (2022) dans La vie psychique du pouvoir. En effet, si Butler critique le concept althussérien, nous verrons qu’il nous fournit cependant une manière de concevoir l’intériorisation culpabilisante du discours féministe. Dans les pages les plus fameuses de « Idéologies et Appareils idéologiques d’État », Althusser comprend la production du sujet par l’idéologie — l’assujettissement —, à partir de la scène d’une interpellation policière dans la rue :
Nous suggérons alors que l’idéologie « agit » ou « fonctionne » de telle sorte qu’elle « recrute » des sujets parmi les individus [...] ou « transforme » les individus en sujets [...] par cette opération très précise que nous appelons l’interpellation, qu’on peut se représenter sur le type même de la plus banale interpellation policière (ou non) de tous les jours : « hé, vous, là-bas ! ». Si [...] nous supposons que la scène théorique imaginée se passe dans la rue, l’individu interpellé se retourne. Par cette simple conversion physique de 180 degrés, il devient sujet. Pourquoi ? Parce qu’il a reconnu que l’interpellation s’adressait « bien » à lui, et que « c’était bien lui qui était interpellé » (et pas un autre). [...] C’est tout de même un phénomène étrange, et qui ne s’explique pas seulement, malgré le grand nombre de ceux qui « ont quelque chose à se reprocher », par le sentiment de culpabilité - à moins que tout le monde ait effectivement quelque chose à se reprocher sans arrêt, donc que tout le monde ressente confusément qu’il a au moins, et à tout instant, des comptes à rendre [...]. (Althusser, 1970/2011, p. 226)
L’interpellation nous fournit donc une manière de saisir conceptuellement la pliure assujettissante des exigences sociales et la façon dont certains discours et certaines normes produisent les sujets : il s’agit d’une performance langagière qui produit le sujet comme coupable, dans la mesure où il se reconnaît dans l’appel par l’autorité.
Comme le suggère Butler dans sa lecture, la culpabilité joue ici un rôle double et ambigu. Le retournement de l’individu face à l’interpellation produit le sujet comme sujet coupable, tout en lui supposant une prédisposition à la culpabilité : si l’individu se retourne, c’est qu’il se sent déjà coupable, comme s’il s’attendait à cet appel (Butler, 2022). Ce qui est interprété comme acte de langage culpabilisant venu de l’extérieur suppose alors une vulnérabilité de l’individu interpelé. Plutôt que d’avancer l’idée que le discours féministe interpelle et culpabilise les hommes de leur désir, nous pourrions alors dire que les hommes se sentent interpelés à l’endroit de leur désir dans la mesure où ils sont prédisposés à le faire. Cela permettrait alors de renverser la conception réactionnaire selon laquelle les discours féministes, et notamment les critiques politiques du désir, viseraient à culpabiliser les hommes.
L’interpellation est d’abord une figure corporelle du retournement : l’individu se retourne lorsqu’il est interpelé, mais c’est également une figure du retournement psychique : l’individu se retourne sur lui-même par le biais d’un mouvement réflexif par lequel il se met en cause. Pour Butler, ce retournement est la production d’un espace psychique intérieur à partir d’une certaine pliure de l’espace social extérieur. L’intériorité psychique est alors créée à partir du retournement sur soi, et ce retournement est ici dans un rapport étroit à la culpabilité. En me retournant, je suis produit comme sujet coupable ; dans le même temps, le retournement suppose une « aptitude originaire à se retourner », une « vulnérabilité à la loi » :
Ce retournement est un acte qui, pour ainsi dire, est conditionné à la fois par la “voix” de la loi et par la capacité de réaction de celui qui est hélé par la loi. Ce “retournement” est un étrange intermédiaire [...] déterminé à la fois par la loi et par le destinataire sans qu’aucun des deux n’agisse de manière unilatérale ni exhaustive. Il ne saurait y avoir de retournement sans qu’il y ait d’abord eu appel, mais il n’y aurait pas non plus de retournement sans quelque aptitude originaire à se retourner. (Butler, 2022, p. 134)
Cette idée selon laquelle « se sentir interpelé·e » n’est pas simplement le fait d’un acte de langage ou de discours, mais dépend également d’une précondition qui concerne le sujet interpelé, nous importe. Cela suggère en effet que la culpabilité produite par les critiques féministes n’est pas le résultat du seul contenu de ces discours, mais bien le produit de leur réception par une subjectivité vulnérable à la culpabilité, encline à condamner son propre désir. Si le discours féministe fonctionne pour certains comme interpellation à l’endroit du désir, ce n’est alors pas le fait du contenu de ces discours, mais du rapport que les sujets entretiennent avec leur désir. Du fait de la rencontre entre un discours et une certaine vulnérabilité à la culpabilité, les hommes qui désirent des femmes et reçoivent les discours féministes seraient alors produits comme sujets d’une culpabilité, non pas vis-à-vis de quelque chose qu’ils auraient commis, mais désiré.
Le concept d’interpellation est-il cependant adéquat ? En effet, pour Althusser (1970/2011), l’interpellation rend compte de l’assujettissement par une idéologie étatique. Or, il semble difficile de comparer la force de l’État, sa capacité à reproduire les rapports sociaux de domination à travers une idéologie, et la force des discours féministes. Cette limite pointe quelque chose de très important concernant la réception des discours féministes. Dans sa lecture d’Althusser, Butler critique le fait de considérer « la force performative de la voix de l’autorité religieuse [comme] le paradigme de la théorie de l’interpellation » (Butler, 2022, p. 142). Autrement dit, la théorie du pouvoir sous-jacente à l’interpellation chez Althusser prendrait pour modèle le pouvoir de l’Église. Ne trouve-t-on pas quelque chose de cet ordre dans la réception du discours féministe lorsqu’il est reçu comme discours culpabilisant ? Si certains hommes qui désirent les femmes reçoivent le discours féministe comme interpellation individuelle, peut-être considèrent-ils ces discours comme des injonctions religieuses. Le féminisme serait alors reçu comme un dogme moral et religieux, et non plus comme un ensemble de luttes politiques.
L’interpellation comme dépolitisation de la critique féministe du désir
Recevoir le discours féministe sur le mode de l’interpellation replace le sujet en question dans une structure oppositionnelle entre culpabilité et innocence (Butler, 2022, p. 146) : soit le sujet est « innocent » et constitue donc une exception qui falsifie le discours féministe — c’est la solution « not all men » —, soit le sujet est coupable de son désir face à un discours prétendument unifié, évacuant par là toute possibilité d’appréhender le féminisme comme un champ conflictuel de luttes et de contestations politiques (Butler, 2005, pp. 80-82). Dès lors, le discours féministe est soit contesté, soit dépolitisé.
La réception du discours sur le mode de l’interpellation individuelle vide alors le discours de son caractère politique. Cette dépolitisation est pourtant paradoxale puisque c’est justement le pouvoir prêté au féminisme qui devient la cause même de sa dépolitisation : recevoir le discours féministe comme discours de pouvoir ou dogme religieux revient à lui prêter un pouvoir qu’il n’a pourtant pas, le privant ainsi d’avancer dans le champ des luttes sociales et politiques. Cette pliure individualisante conduit alors à une psychologisation qui enferme la question politique dans la moiteur d’une psyché fermée sur elle-même : croyant que l’appel s’adresse à lui en tant qu’individu, le sujet se retourne sans chercher à entraîner avec lui la structure dans laquelle il s’inscrit.
Nous retrouvons ici Butler (2022) lorsqu’elle voit dans l’interpellation un modèle pour comprendre comment, depuis le social, un espace psychique interne est produit. L’interpellation fonctionne moins comme une intériorisation que comme la production d’un intérieur à partir d’une torsion du social. Les exigences féministes concernant l’espace social, les objets culturels et les relations entre les personnes, sont alors converties en exigences concernant l’espace interne de l’individu et de sa psyché6.
Désirer safe ?
Pour mieux saisir le problème de cette intériorisation, nous pouvons nous référer à la notion de safe. La critique féministe du désir peut être comprise à partir de l’idée que des transformations culturelles et institutionnelles sont nécessaires afin de rendre les espaces sociaux safe pour les femmes vis-à-vis, notamment, des violences sexuelles. Or, il apparaît que l’interprétation du discours féministe sur le mode de l’interpellation conduit à une volonté de rendre safe les espaces psychiques de chacun·e. Pourtant, la constitution d’espaces sociaux safe ne suppose pas de produire des espaces psychiques safe. Au contraire, poursuivre l’objectif de faire de sa propre psyché un espace safe semble être une tâche infinie qui, si elle est conçue comme la première étape nécessaire à un engagement politique, finit par faire s’effondrer toute action politique dans une moralisation infiniment fatigante de son propre désir.
Issus des mouvements des droits civiques et de libération des femmes, les safe spaces, littéralement espaces sûrs/sécurisés, apparaissent aux Etats-Unis dans les années 1960 et visent les lieux fréquentés par les personnes LGBT puis le mouvement des femmes (Dorlin, 2017 ; Hanhardt, 2013). Il s’agit d’espaces où les violences, les discours de haine et le harcèlement à l’encontre des personnes minorisé·e·s sont combattus, et ce, dans la perspective de permettre à leur parole et aux forces collectives générant des stratégies de résistance de se déployer. On observe cependant un déplacement du signifiant safe dans les discours (Dorlin, 2017 ; Halberstam, 2015), au point où l’accusation d’être unsafe porte sur les pensées, les désirs, et se convertit en auto-accusation. C’est ainsi qu’en parlant de son couple, une jeune femme exprime qu’elle ressent de la jalousie et que ce sentiment n’est « pas safe », ou bien encore qu’un homme se plaint de désirer une collègue de travail, désir qu’il juge « violent » et « unsafe ». On voit la notion de safe être ici rattachée à un désir ou un affect vis-à-vis desquels le sujet se place en défaut. L’opposition safe/unsafe se trouve alors convertie en thermomètre moral de singularités affectives et désirantes. Que doit-on comprendre de ce souhait de produire des espaces psychiques et des désirs safe ?
Dans le cas présent, désirer safe reviendrait à désirer en féministe, à savoir aligner son désir sur ce qu’on juge « bien de désirer » à partir des critiques du désir rappelées ci-dessus, et ce, dans une logique de lutte contre des oppressions supposément produites par le fantasme ou le désir lui-même. La réception et l’interprétation du discours féministe viseraient alors à condamner son désir ou bien à en nier les aspérités. Le sujet est alors pris dans une nouvelle alternative qui oppose culpabilité et innocence : soit le sujet se découvre dans l’incapacité à produire un espace psychique safe — motivant ainsi la plainte rattachée au sentiment de culpabilité —, soit il se pense en mesure de choisir les modalités et les causes de son désir, en mesure de désirer « en conscience féministe ».
Désirer « en conscience » pose cependant un problème fondamental dans le cadre d’une acception psychanalytique du désir qui entend prendre en compte ce qui, dans le désir, échappe et résiste à la conscience et à sa maîtrise. Là où les espaces safe relèvent de constructions collectives, conscientes et volontaires, qui établissent des normes au sein de groupes spécifiques, le désir, quant à lui, divise le sujet et l’oriente à son insu. Prenons l’exemple de l’interdit, et de l’idée de s’interdire certains désirs. Face à l’interdit que la volonté oppose au désir, on se rend compte que l’interdit génère et façonne le désir. Désir et interdit sont alors deux faces d’une même pièce, et le désir, soumis à l’interdit et au refoulement, persiste à aiguiller le sujet à son insu tout en se nourrissant de l’interdit. La sévérité de la conscience morale, y compris si en résulte le sentiment de s’être débarrassé du désir malvenu, ne permet pas de supprimer ce qui fait conflit, bien au contraire (Freud, 1930/2015, p. 485).
Interroger son désir, s’atteler à la tâche d’en comprendre les déterminations socio-politiques et culturelles est un premier pas courageux vers une compréhension de ce qui le norme. C’est d’ailleurs là tout l’enjeu d’une partie de la théorie féministe que de mettre en exergue, dans une perspective de genre, les conditions politiques, historiques et discursives des processus de normalisation fantasmatique du désir (Srinivasan, 2022). Qu’en est-il cependant de ce qu’il reste d’inconscient dans les mécaniques du désir, de sa singularité, de ce contre quoi il bute et de ce à quoi il résiste ? Comment cette prise en compte de la dimension inconsciente du désir nous donne-t-elle à repenser la problématique du sentiment de culpabilité, présente dans certains discours d’hommes se déclarant « déconstruits » ? Que nous apprend-elle sur la plainte énoncée par des hommes se sentant coupables de désirer des femmes ?
Du désir à l’angoisse : une traversée de la culpabilité
Cette subjectivation singulière des critiques féministes du désir nous montre alors que, de la critique à la morale, il n’y a qu’un pas. Pour autant, il s’agit de prendre au sérieux les hommes qui expriment un tel sentiment de culpabilité à l’égard de leur désir pour les femmes. Quels que soient les effets politiques de ce phénomène, il reste néanmoins l’expression d’une souffrance psychique et, si de l’interprétation moralisante découle une plainte, il s’agit peut-être d’entendre ce que cette plainte a à nous dire.
Ce que l’énoncé « je me sens coupable de désirer des femmes en tant qu’homme » nous indique, c’est d’abord que la plainte relève d’une souffrance, d’un affect négatif, d’une douleur causée par une « mauvaise conscience » » (Freud, 1930/2015 p. 484). Or, à l’heure où les féministes œuvrent à proposer un regard nouveau sur les violences sexistes et sexuelles et où émergent de nouveaux signifiants pour en rendre compte, nous serions tenté·e·s de répondre aux hommes qui se plaignent que leur plainte est déplacée : qui sont-ils pour se plaindre ? Nous pouvons cependant entendre ce déplacé au sens strict, comme l’œuvre d’un dé-placement. Ainsi, nous nous montrons sensibles au caractère déplacé de la plainte — en comparaison aux violences faites aux femmes —, tout en suivant la trace de ce déplacement pour mieux comprendre l’affect qu’elle exprime.
Le sentiment de culpabilité et ses rapports au fantasme
Là où le caractère déplacé de cette plainte de culpabilité nous interroge, c’est qu’elle advient dans certains discours d’hommes n’ayant été ni accusés ni punis pour des violences. Ce sentiment de culpabilité est alors à distinguer du fait d’être effectivement coupable d’avoir commis un acte répréhensible. Ce n’est pas l’acte, mais le désir, lorsqu’il se manifeste sous la forme du fantasme, qui fait l’objet de la culpabilité. Paradoxalement, les hommes se sentent davantage coupables de la violence fantasmée plutôt que des violences qu’ils peuvent effectivement commettre (Palain, 2023).
C’est à partir des outils de la psychanalyse que nous pouvons penser le sentiment de culpabilité dans ses rapports au fantasme et au désir. Le terme de conscience de culpabilité apparaît chez Freud dès 1894 à propos d’une jeune fille souffrant de reproches de contrainte. Cette dernière s’adresse des reproches, allant jusqu’à s’accuser de graves méfaits qu’elle n’a pourtant pas commis, du fait de l’influence qu’exerce sur elle sa culpabilité (Freud, 1894/2005). Mais c’est dans la névrose obsessionnelle7 que la question de la culpabilité apparaît de manière prégnante à travers la symptomatologie de l’autopunition et ses liens avec les fantasmes et désirs inconscients qui animent le sujet (Freud, 1909/1998). Dans Deuil et mélancolie, Freud poursuivra son étude de la culpabilité en avançant que l’affect résulte d’un clivage du moi divisé entre l’accusateur (le sur-moi) et l’accusé : les auto-reproches et autopunitions contre un objet d’amour se trouvent retournés contre le moi propre, pouvant mener le sujet au suicide (Freud, 1917/2005).
Dans les différents cas, le sentiment de culpabilité est à entendre comme sentiment d’indignité personnelle sans rapport avec un acte précis, et comme malaise produit vis-à-vis d’une position subjective par rapport à un fantasme, à une pulsion, à une plainte portée contre. Le sur-moi comme instance punitive induit le sentiment de culpabilité ; il s’agit d’une relation au sur-moi qui se traduit par des effets subjectifs, comme le besoin de punition. Ce que Freud nous permet de mieux saisir, c’est le lien étroit entre sentiment de culpabilité et fantasme, y compris dans les cas où le sentiment de culpabilité semble être sans objet, déplacé, voire inconscient.
Dans Totem et tabou, Freud (1913/2009) avance que le sentiment de culpabilité résulte de la violation d’un interdit moral. il affirme que la conscience morale est avant tout conscience de culpabilité, une culpabilité qui scelle le lien social et organise les interdits. Si désir et culpabilité sont liés, c’est que le désir n’est pas sans rapport à la loi. C’est ici que le fantasme apparaît comme manière de contourner les effets de division et d’interdit du désir, comme manière de satisfaire fantasmatiquement une tendance au mal, à l’interdit. De fait, « le mal n’est pas du tout ce qui est pour le moi le nuisible ou le dangereux, au contraire il est même quelque chose qui est souhaité par lui, qui lui procure du contentement » (Freud, 1930/2015, p. 483). La figuration du désir inconscient dans le scénario imaginaire révèle alors l’étroit rapport qu’entretiennent désir et fantasme, et c’est au cœur de cette articulation que l’interdit se manifeste et fait conflit.
Dès lors, le désir qui s’exprime dans le fantasme est étroitement lié à la culpabilité et à l’angoisse. Dans Le malaise dans la culture, Freud affirme la tyrannie du sur-moi : « rien ne peut se cacher du sur-moi, pas même les pensées. [...] Le sur-moi tourmente le moi pécheur avec les mêmes sensations d’angoisse et guette les occasions de se faire punir par le monde extérieur » (1930/2015, p. 485). Ainsi, si le sentiment de culpabilité a à voir avec le fantasme et le désir auquel ce dernier s’articule, rappelons qu’il est également « l’expression du conflit d’ambivalence, du combat éternel entre l’Éros et la pulsion de destruction ou de mort » (ibid., p. 492). Partant de l’idée d’un malaise dans la culture patriarcale, c’est cette hypothèse de l’ambivalence du désir qui doit nous éclairer sur la question du retournement face à l’interpellation. Quelle est la nature de cette prédisposition à la culpabilité dont parle Butler ? Comment entendre et ajuster au cas qui nous intéresse l’hypothèse freudienne du lien entre sentiment de culpabilité, désir et conflit d’ambivalence ?
La question de l’ambivalence : la pulsion de destruction à l’origine de la culpabilité
Dans son article « Plaisir visuel et cinéma narratif », Laura Mulvey expliquait l’ambivalence manifestée dans le cinéma classique concernant le corps féminin : si dans le cinéma, l’image de « la femme » est, soit sadisée, soit faite icône, c’est que le corps de la femme représente à la fois un plaisir et une menace (Mulvey, 1975/2017). Cette ambivalence est attribuée, par Mulvey, non pas à une structure symbolique universelle, mais à un inconscient patriarcal (ibid.). Or, il semble qu’à l’origine de la culpabilité de certains hommes se trouve une forme d’ambivalence sensiblement identique, un conflit où co-existent amour et destruction de l’objet : désir/amour pour les femmes et attrait pour la pornographie dite « hardcore », désir/amour pour les femmes et destruction du désir de l’Autre par chosification.
Dans le cas de la culpabilité obsessionnelle, on retrouve, chez Freud, l’idée de destruction par chosification, notamment dans le cas de l’homme aux rats lorsque ce dernier raconte avoir lancé à son père : « Toi lampe ! Toi serviette ! Toi assiette ! », réduisant par-là l’autre au statut d’objet (Freud, 1909/1998, p. 47). Cette haine refoulée, devenue inconsciente, met alors en exergue la tentative de destruction à l’origine du sentiment de culpabilité. L’homme aux rats se défend pourtant de sa haine et de son souhait de faire mourir le père ; il clame son amour pour ce dernier, ce à quoi Freud lui rétorque que l’amour est la condition du refoulement de la haine. Amour et haine cohabitent, et c’est la pulsion hostile révélée par le fantasme qui fait l’objet du refoulement et cause ici le besoin de punition, donc le sentiment de culpabilité. Dans le cas de la culpabilité obsessionnelle, la culpabilité est ce qui de la haine, dans l’amour, a été refoulé8.
Cette ambivalence entre amour et haine est également ce qui fait l’articulation entre la culpabilité et l’angoisse. Pour Freud, en effet, « le sentiment de culpabilité n’est au fond rien d’autre qu’une variante topique de l’angoisse » (Freud, 1930/2015, p. 495), angoisse se manifestant devant ce par quoi on est menacé de perte d’amour : en haïssant l’autre, je me risque à le perdre. S’il y a sentiment de culpabilité, c’est qu’amour et haine sont ici les deux faces d’une même pièce. En effet, le sentiment de culpabilité qui résulte du refoulement de la haine intervient comme tentative pour apporter une solution au conflit psychique, et c’est en tant que formation réactionnelle qu’un tel sentiment souligne la dynamique pulsionnelle dans laquelle s’ancre le conflit défensif. « La conscience morale apparaît au début par la répression d’une agression » (ibid., p. 489), mais cette pulsion de destruction, refoulée, continue de suivre son propre destin et se retourne contre le moi : « l’effet du renoncement pulsionnel sur la conscience morale se produit alors de façon telle que toute part d’agression que nous nous abstenons de satisfaire est reprise par le sur-moi et accroît l’agression de ce dernier (contre le Moi) » (ibid., p. 488).
Dans l’hypothèse d’un inconscient patriarcal, on pourrait donc situer l’origine de la culpabilité éprouvée par ces hommes dans le retournement contre eux-mêmes d’une haine dirigée à l’endroit des femmes. Cette haine, si elle est le résultat d’une angoisse de perte (dite « angoisse de castration » par Mulvey), peut être interprétée comme haine devant la liberté croissante acquise par les femmes à travers les luttes féministes : plus ces dernières progressent, moins le sujet masculin a de prise sur la subjectivité et le corps des femmes, plus il hait. Cette haine inconsciente, inacceptable parce qu’elle entre en conflit avec l’amour — qui peut s’exprimer dans le fait d’avoir la prétention à être « un homme déconstruit » — est retournée contre le moi propre.
La plainte est alors à entendre sur le plan de la souffrance affective, certes, mais il s’agit de rester attentif·ves à la manière dont elle fait lien social pour le sujet. Le phénomène d’être un homme « déconstruit », qui s’énonce coupable d’appartenir à un groupe social faisant l’objet d’une critique politique, nous amène à questionner le bénéfice de l’énonciation d’un tel sentiment de culpabilité dans une époque donnée, celle suivant #MeToo, où les cartes des rapports de désir et de séduction sont rebattues. Quels bénéfices ces hommes tirent-ils du fait de s’énoncer comme sujet à ce sentiment de culpabilité ?
Partant de cela, et compte tenu du rapport étroit qu’entretiennent désir et culpabilité, nous postulons ici qu’une réassurance à l’endroit de la plainte liée au sentiment de culpabilité ne serait d’aucune utilité pour apaiser le conflit psychique. D’une part, l’expression du sentiment de culpabilité n’indique pas pour autant que le sujet soit conscient des désirs pour lesquels il se tient pour coupable ; ainsi, l’inviter à ne plus se sentir coupable serait contre-productif. D’autre part, si le sentiment de culpabilité n’est, au fond, qu’une variante topique de l’angoisse, alors c’est le sujet du déplacement de l’affect en jeu qui doit faire l’objet d’une analyse. La solution est donc moins de rassurer le sujet que de l’accompagner sur la voie d’une responsabilisation de son désir.
La responsabilité, entre psychanalyse et politique
L’idée qu’il s’agit de construire une position de responsabilité par rapport au désir permet de proposer une voie éthique alternative à la réception morale des discours féministes que nous avons critiquée. Tandis que la voie morale produit de la culpabilité et dépolitise la problématique de la construction du désir envers les femmes, la voie éthique cherche à produire une position de responsabilité vis-à-vis du désir, qui puisse maintenir la dimension politique de la réflexion. Pour tracer cette voie éthique, nous pouvons repartir de l’idée, déjà évoquée, selon laquelle le sentiment de culpabilité tend à confondre l’intention et l’exécution, le désir et l’acte. Si le sujet se sent coupable, c’est qu’il pense qu’il a commis quelque chose de mal. Or, dans le cas des hommes qui désirent les femmes, il n’est pas question d’un fait commis mais de désir. Comment se fait-il alors que l’intention soit « considérée comme équivalente à l’exécution » ? C’est précisément la question que pose Freud à propos du sentiment de culpabilité :
On se sent coupable (les gens pieux disent : pécheur) quand on a fait quelque chose que l’on reconnaît comme être « mal ». Puis on remarque que cette réponse n’apporte pas grand-chose. Peut-être ajoutera-t-on après quelque hésitation : même celui qui n’a pas fait ce mal, mais reconnaît chez lui la simple intention de le faire, peut se tenir pour coupable, et alors on soulèvera la question de savoir pourquoi l’intention est ici considérée comme équivalente à l’exécution. [...] Ainsi donc il importe peu que l’on ait déjà fait le mal ou qu’on veuille seulement le faire ; dans les deux cas, le danger ne survient que lorsque l’autorité découvre la chose et dans les deux cas elle se comporterait de la même façon. (Freud, 1930/2015, pp. 483-484)
Ici, cette confusion entre intention et exécution va de pair avec le caractère étrange ou étranger de l’intention : le désir sexuel qui peut prendre la forme d’un désir de violence ou de domination me semble étranger à moi-même ; moi qui suis féministe, comment puis-je désirer cela9 ? Quel est cet Autre qui, en moi, par lequel je désire ? En effet, le désir inconscient qui trouve une formulation par la voie du fantasme s’agite à l’insu du sujet, et le sentiment de culpabilité semble alors se glisser dans l’interstice d’une passivité éprouvée à l’égard d’un désir. La culpabilité intervient alors comme recours à l’angoisse suscitée par le désir : n’étant pas sujet de ce désir ambivalent qui m’anime à mon insu, j’en suis alors paradoxalement coupable, qu’importe que j’aie agi ou désiré le faire. Si la culpabilité s’appuie sur cette confusion entre intention et exécution, par quels moyens alors les séparer ? Et en quoi cette distinction implique-t-elle une position éthique vis-à-vis du désir ?
Cette déconnexion peut, notamment, être le fruit d’un travail analytique. En effet, l’analysant·e, en parvenant à s’énoncer, petit à petit, séance après séance, comme sujet d’un désir, sujet qui fantasme, ne devient-il pas, dans le même temps, capable de déconnecter le désir de l’acte ? En reconnaissant son désir, le sujet ne devient-il pas sujet de son désir, responsable du fait de l’assouvir, ou non ? En œuvrant à séparer intention et exécution, je me reconnais d’abord sujet de mon désir ; si j’agis, c’est en tant que sujet responsable de mon acte et non en tant que sujet coupable d’un acte que je n’ai pas commis, autrement dit, sujet coupable de désirer.
Plutôt que de refouler ses fantasmes10, il s’agit de solliciter leur exploration, leur traversée. Plutôt que de les rejeter — parce que trop inacceptables pour y toucher —, le sujet est alors invité à s’émanciper du jugement moral qu’il porte sur son désir. Cette émancipation, permise notamment par l’écoute de l’analyste, permet aux sujets d’explorer les dédales de la logique de leur désir. Cette double position consiste à construire la distance entre fantasme et acte et, partant de là, à explorer ses propres fantasmes, dans leurs logiques complexes et dans ce que ces logiques doivent aux structures sociales de domination. Cette position, nous l’appelons position éthique de responsabilité.
Mais si le travail analytique ouvre un espace de désintrication entre acte et fantasme, un espace d’analyse et d’exploration du désir, il ne s’agit pas pour autant d’avancer qu’il amène une réponse suffisante à un problème posé par le social, ni qu’il se substitue aux luttes politiques. Nous ne soutenons pas ici l’idée qu’entamer une démarche analytique puisse remplacer l’action politique, mais bien plutôt qu’elle s’y articule et qu’elles s’enrichissent mutuellement. Là où l’analyse permet d’aller à la rencontre de son désir et d’interroger sa relation à l’autre, les espaces politiques offrent, quant à eux, les outils théoriques et formateurs pour questionner le désir et la manière dont nous construisons nos rapports aux autres. Il nous semble essentiel que chacun·e puisse trouver les ressources lui permettant de ne pas céder sur son désir (Lacan, 1986), mais il faut également rappeler l’importance, pour les luttes politiques, de ne pas céder sur la question du désir. Cette articulation entre le singulier et le collectif doit pousser à reconnaitre la dimension politique de l’acte analytique, mais également l’importance de ne pas faire fi de la question de l’inconscient et du désir dans le champ de l’action politique.
Conclusion
Ainsi, nous pouvons maintenant répondre à celleux qui voient dans le sentiment de culpabilité de certains hommes à l’endroit de leur désir pour les femmes l’occasion d’accuser le féminisme d’être une idéologie moralisante ou un nouveau dogme religieux culpabilisant. Les discours féministes sont d’abord des critiques politiques qui visent à la transformation — radicale ou progressive — des structures sociales, dans la perspective de mettre fin aux rapports sociaux de domination fondés sur le système sexe/genre. Les critiques féministes du désir des hommes envers les femmes visent à montrer le rôle que joue le désir et sa mise en forme sociale dans la reproduction des rapports sociaux de domination. La réception de ces discours en termes de culpabilité, qu’elle conduise à leur rejet ou bien à des phénomènes de culpabilisation individuelle, constitue une privatisation par laquelle un discours concernant l’espace public et les rapports sociaux est écrasé sur l’espace intérieur subjectif masculin. Ce détournement individualisant constitue une dépolitisation opposée aux buts socio-politiques des mouvements féministes, et s’explique par une certaine vulnérabilité à la culpabilité, en lien avec le désir.
Ainsi, bien qu’il faille reconnaître le problème que pose la culpabilisation du désir, notamment car elle dépolitise le discours féministe et qu’elle produit des souffrances psychiques, il faut considérer que la solution ne réside pas dans l’amendement des discours féministes ou dans leur silenciation, mais dans un travail analytico-politique autour des rapports qu’entretiennent désir et pouvoir. Une position de responsabilité et non de moralisation vis-à-vis du fait que nos désirs sont informés par des structures de domination consisterait, non pas à refouler nos désirs ou à les tyranniser, mais à les analyser, les parcourir, donc à en assumer l’existence. C’est à la condition de reconnaître, en nous, l’existence érotique des structures de domination qu’il est possible d’acquérir une position éthique où, tout en ne cédant pas sur ses désirs, on acquière la capacité de ne pas laisser nos actes être déterminés par ces structures de domination.
Conflits d’intérêt
Aucun conflit d’intérêt déclaré.