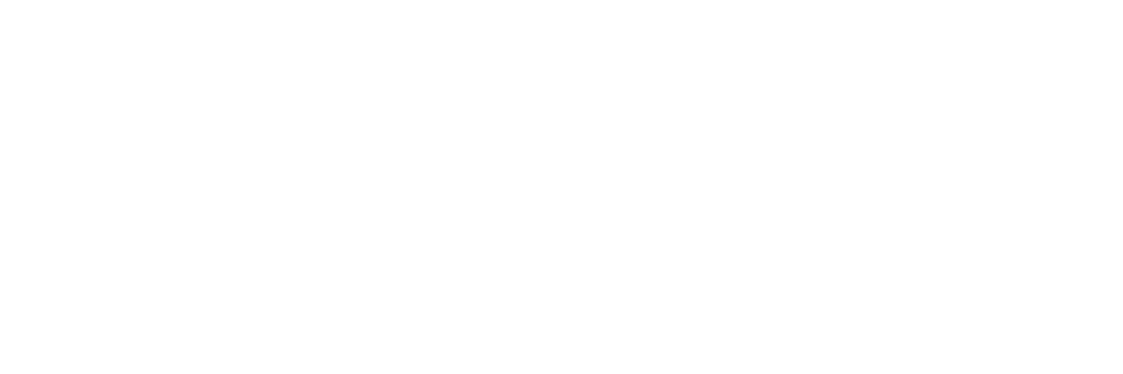« Parce que la femme en effet n’a pas le droit à la parole, elle peut seulement avoir des “secrets” », des secrets d’amour qui la rendent malade : et c’est cela l’hystérie. »
Sarah Kofman (1994, pp. 45-46)
« Nous, des femmes, allons réussir, là où l’hystérique a échoué1. »
Cet article présente une lecture féministe des théorisations psychanalytiques sur l’hystérie. Il argumente ainsi en faveur de l’utilité épistémologique et politique de la notion, en proposant une analyse de l’hystérique en tant que figure à la croisée de la psychanalyse et des études féministes. L’expression « figure de l’hystérique » désigne l’hystérique comme personnage qui se dessine au travers des discours, théorisations et conceptualisations de la tradition psychanalytique.
Lacan (1953) a très tôt repéré chez le névrosé « une “parole bâillonnée” où s’exprime un certain nombre […] de “transgressions à un certain ordre” ». L’hystérique, névrosée par excellence, exprimerait alors la transgression de l’ordre que nous pouvons qualifier de « patriarcal2 ». Cet article vise à en faire la démonstration. Il s’intéresse ainsi moins à l’hystérie comme catégorie psychopathologique — la notion a disparu du DSM en 1980 — qu’à l’hystérique comme personnage d’une rencontre3 : celle de la clinique et du politique, du psychique et du social, du champ psychanalytique et de celui des féminismes.
« L’invention » de l’hystérie comme objet médical remonte au XVIIe siècle et accompagne la construction du savoir médical moderne occidental (Arnaud, 2014). L’histoire de la notion révèle ainsi son rapport au savoir sur la sexualité en tant qu’il prend pour objet le « corps des femmes » (Foucault, 1976/1997 ; Ayouch, 2018). Nous pouvons situer le paroxysme d’une telle démarche à la fin du XIXe siècle autour du projet de systématisation de l’hystérie porté par le neuropsychiatre Martin Charcot, projet dont l’échec ouvrira un espace pour l’invention par Freud de la discipline psychanalytique (Foucault, 2003). Là où le « pouvoir psychiatrique » faisait de l’hystérique un objet de savoir, la singularité de l’invention freudienne repose sur un déplacement majeur : le passage de l’observation à l’écoute, de l’hystérique comme objet à l’hystérique comme sujet de parole (et de désir). L’intérêt pour l’approche psychanalytique s’explique ainsi par le processus de dépathologisation de l’hystérie inauguré par le geste freudien, poursuivi par Lacan et radicalisé enfin par les commentaires et relectures critiques des théoriciennes féministes, telles que Luce Irigaray, Gayle Rubin, Sarah Kofman ou encore Judith Butler. Le passage par la critique féministe s’avère alors indispensable afin de proposer une lecture de la psychanalyse qui fait honneur à la radicalité politique de ses thèses. En ce sens, une relecture féministe de la figure de l’hystérique nous permettrait d’envisager la psychanalyse comme un outil critique fondamental pour penser la complexité des rapports entre genre et désir, psychique et politique. Il serait ainsi possible — c’est une des visées de cet article — de réinscrire certaines théorisations psychanalytiques à l’intérieur du champ critique des féminismes occidentaux.
Une « névrose féminine » ?
« L’hystérie, est-ce une névrose féminine ? » se demande Luce Irigaray. « N’est-ce pas — aujourd’hui par privilège —, une “souffrance” du “féminin” ? […] Est-ce une pathologie ? Je crois qu’il faut répondre : oui et non. La culture, en tout cas occidentale, la constitue en pathologie » (1977, p. 135).
La névrose déclinée au féminin
Les premières recherches de Freud (1956/1991, 1973/1992 ; Freud et Breuer, 1895/2016) sur l’hystérie coïncident avec la naissance de la psychanalyse, et sont donc indissociables du problème épistémologique qui accompagne le processus d’édification d’une discipline. En enquêtant sur l’hystérie, Freud cherche ainsi également à asseoir un champ scientifique nouveau, reposant sur des concepts, des règles et une méthodologie propres. Il ne faut donc pas s’étonner de le voir opérer en véritable nosographe, dont l’enjeu semble avant tout de parvenir à délimiter les contours de la catégorie : son étiologie, le mécanisme de formation des symptômes, les modalités de guérison. Reprenant l’hypothèse de Charcot sur le rôle du traumatisme dans le développement de l’hystérie, Freud soutient en 1896 que « c’est de réminiscences surtout que souffre l’hystérique » (1895/2016, p. 5). Par là-même, il s’oppose à la thèse de l’hérédité de l’hystérie. Il s’appuie ainsi sur les récits de ses patientes, récits qui semblent le renvoyer vers une origine traumatique sexuelle dans « la prime enfance » (Freud, 1973/1992). La technique développée dès les Études sur l’hystérie consiste alors à interroger le symptôme afin de remonter jusqu’au souvenir traumatique4.
En parallèle des recherches sur l’étiologie de la maladie, Freud interroge le mécanisme de formation des symptômes hystériques, dont les recherches aboutissent à l’introduction du concept de « conversion ». Dès l’année suivant la publication des Études, le traumatisme sexuel est reconnu comme étant le principal facteur étiologique de l’hystérie et la conversion érigée comme modèle de formation des symptômes, écartant ainsi définitivement le facteur héréditaire. La nature du traumatisme sexuel est, ainsi, progressivement élucidée : « Toute relation enfantine postule une séduction préalable d’un des enfants par un adulte » (Freud, 1973/1992, p. 106). La même année, une autre publication portant sur l’étiologie des névroses propose d’analyser ensemble hystérie et névrose obsessionnelle. Dans « L’hérédité et l’étiologie des névroses » (1973/1992), Freud précise la nature du traumatisme hystérique en le différenciant, voire en l’opposant, à celui de l’obsessionnel. En effet, il semble suggérer que la disposition à développer l’une ou l’autre de ces psychonévroses dépend entièrement de la place occupée par le sujet dans la scène sexuelle traumatique. Ainsi, la prédisposition à l’hystérie s’expliquerait par la position passive du sujet5, par opposition à la névrose obsessionnelle qui semblerait résulter d’une expérience sexuelle précoce où le sujet a occupé une place active : « Expérience de passivité sexuelle avant la puberté : telle est donc l’étiologie spécifique de l’hystérie » ; « Dans la névrose des obsessions, il s’agit au contraire d’un évènement qui a fait plaisir, d’une agression sexuelle inspirée par le désir […] » (Freud, 1973, respectivement p. 55 et 58)6. De cette distinction, Freud tire une conséquence : « c’est pourquoi l’on rencontre les obsessions plus fréquemment chez les hommes que chez les femmes, et, chez les hommes, plus fréquemment que l’hystérie » (1973/1992, p. 111), l’activité étant ici associée à la position masculine, et la passivité à la position féminine7.
L’importance de l’élément actif dans la vie sexuelle pour la cause des obsessions comme la passivité sexuelle pour la pathogénèse de l’hystérie semble même dévoiler la raison de la connexion la plus intime de l’hystérie avec le sexe féminin et de la préférence des hommes pour la névrose d’obsessions. (Freud, 1973/1992, pp. 58-59)
Au regard de la névrose obsessionnelle, l’hystérie apparait d’autant plus comme une névrose « spécifiquement féminine », mettant en jeu la passivité des femmes8. Drôle de « couple », qu’Irigaray décrira de manière ironique en ces termes :
entre l’obsessionnel qui veut […] maitriser pour s’ériger, enfin comme tout puissant, et l’hystérique en dérive qui ne veut plus rien, ne sait plus ce qu’elle désire, fait comme si c’était ou comme lui voudrait […] la partie semble mal engagée […]. Le plaisir s’annonce morose. (Irigaray, 1974, p. 71)
Dans cette première conception, l’hystérique est identifiée, non seulement à la femme, mais à la femme en tant que victime, « maîtrisée » par l’obsessionnel (représentant l’idéal de l’agressivité masculine) ne pouvant que céder (sans consentir9) en faisant « comme lui voudrait ». L’hystérique n’est ici donc pas envisagée comme possible sujet de désir.
Cette première approche de l’hystérie sera néanmoins rapidement écartée. Dès l’année 1897, Freud annonce à son ami Fliess qu’il abandonne sa neurotica tant l’inconscient, de par « son hybridité propre » (Ayouch, 2018), rend impossible la distinction entre la réalité factuelle et le fantasme. Parmi les explications qu’il énumère on trouve « la conviction qu’il n’existe dans l’inconscient aucun indice de réalité de telle sorte qu’il est impossible de distinguer l’une de l’autre la vérité et la fiction investie d’affect […] ». (Freud, 1956/1991, p. 191). Ce geste a été interprété comme un désaveu de la part de Freud de la réalité des violences sexuelles subies par ses patientes, et il est vrai que, dans d’autres écrits, le glissement entre séduction et agression est saisissant, témoignant de sa difficulté à penser la différence. Il est à cet égard intéressant de revenir sur l’interprétation qu’il propose de la scène du baiser de M.K à Dora.
Elle avait alors quatorze ans. Monsieur K. avait convenu avec elle et sa femme que ces dames se rendraient l’après-midi à son magasin sur la grande place de B. pour assister à une festivité religieuse. Mais il persuada sa femme de rester à la maison et congédia les commis si bien qu’il était seul lorsque la jeune fille entra dans le magasin. […] Il revint ensuite et, au lieu de sortir par la porte ouverte, il serra soudain la jeune fille contre lui et l’embrassa de force sur les lèvres. C’était là une situation capable de susciter une véritable sensation d’excitation sexuelle chez cette jeune fille de quatorze ans encore intacte. Dora ressentit pourtant à cet instant un fort sentiment de dégoût, elle s’arracha à son emprise et se précipita dans la cage d’escalier et franchit de là le portail de l’immeuble qui donnait sur la rue. (Freud, 1905/2010, pp. 75-77 ; c’est moi qui souligne)
Freud reconnait ici que le baiser était « de force ». Pourtant, sa conclusion reste la même : c’est « l’hystérie » de Dora qui explique son incapacité à céder. Ainsi, il déclare : « Toute personne chez qui l’occasion d’une excitation sexuelle provoque essentiellement ou exclusivement un sentiment de déplaisir peut être d’après moi considérée, sans la moindre hésitation, comme une hystérique » (Freud, 1905/2010, pp. 75-77).
Pourtant, une prise en compte de la dimension fantasmatique du sexuel ne devrait pas impliquer un déni de reconnaissance des violences commises et subies. Il est donc à la fois possible et important de se montrer critique à l’égard des propos de Freud lorsqu’il est incapable d’entendre les récits de violence amenés par ses patientes (cette erreur éthique et clinique est déterminante pour comprendre le départ de sa patiente Dora) tout en reconnaissant l’intérêt d’un élargissement de la question du sexuel à la vie fantasmatique10. Ce deuxième temps des recherches sur l’hystérie (Cabrol et Parat, 2000) inaugure une compréhension de l’hystérique comme sujet de désir, sur laquelle nous reviendrons plus loin, qui valorise sa capacité d’agir.
Pour l’heure, regardons comment l’hystérie résulte du développement complexe et contraignant du « devenir-femme », question qui occupe Freud du début des années 1920 jusqu’à sa mort.
On ne nait pas hystérique, on le devient
Si l’hystérie semble moins intéresser Freud à partir des années 1910, c’est sous une autre problématique que la question de l’hystérique est subsumée. Dès les années 1920, il se penche sur le problème du développement psychosexuel de la petite fille, centré sur la question de l’Œdipe féminin. Nombreux articles, allant de la publication de « Psychogène d’un cas d’homosexualité féminine » (Freud, 1932/2016) à « Analyse avec fin, analyse sans fin » (Freud, 1926/1998) viendront interroger, expliquer et décrire les devenir homme et femme dans un mouvement de différenciation qui prend appui sur la « découverte de la castration » par les deux sexes (Freud, 1932/2016). Rappelons brièvement en quoi consiste la scène paradigmatique qui signe le passage de l’enfant « polymorphe » (Freud, 1905/2014) à la consécration de la différence entre la fille et le garçon. Si la petite fille avait jusqu’ici vécu « comme un petit garçon », considérant son clitoris comme l’analogue du pénis, une « découverte lourde de conséquences » vient perturber le cours des choses : « Elle l’a vu, elle sait qu’elle ne l’a pas et elle veut l’avoir » (Freud, 1932/2016, p. 96). Cette scène — mythologie nécessaire à Freud pour pouvoir justifier son « idée fixe » (Kofman, 1994) — inaugure ainsi un long et pénible trajet vers « la féminité ». Ce trajet repose sur un double renoncement : d’abord, renoncement à l’amour pour la mère (rendue coupable de l’avoir fait naître fille, soit dépourvue de pénis) et transfert de cet amour vers le père (qui, lui, est reconnu comme pourvu du pénis), puis, renoncement à un fragment de plaisir érotique, la masturbation clitoridienne, au profit du vagin comme nouvelle zone érogène privilégiée. Ainsi, la réussite ou l’échec de ces transferts érotiques marqueront les trois issues possibles du devenir-femme esquissées par Freud. Ces trois « orientations » sont explicitées dès 1931 (Freud, 1932/2016) comme suit :
-
La suspension de toute vie sexuelle, s’exprimant comme inhibition sexuelle ou sous forme de névrose ;
-
l’accentuation excessive et rétive ou affirmation obstinée de sa masculinité qui peut déboucher sur un choix d’objet manifestement homosexuel ;
-
la forme féminine du complexe d’Œdipe, qui se traduit par un désir d’enfant comme traitement de l’envie de pénis (dans une équivalence enfant/pénis).
Si l’hystérie n’apparait pas explicitement comme un des destins de l’Œdipe féminin, elle se situe quelque part entre le rejet de la sexualité (option a) et la masculinité (option b). Rejoignant les critiques féministes de Luce Irigaray (1974) et de Sarah Kofman (1994), je tenterai de montrer par la suite que l’hystérique est celle qui a échappé, par une série de stratégies, à la mélancolie de la féminité dite « normale ». Examinons alors ces trois issues de manière plus détaillée.
Le refus de la sexualité résulte pour Freud d’une pratique masturbatoire trop intense durant l’enfance (Freud, 1932/2016). C’est ainsi qu’au moment où elle est sommée d’abandonner la sexualité phallique au profit d’un investissement érotique du vagin, la petite fille renonce à la totalité de sa vie sexuelle, devenant sexuellement inhibée ou frigide. Or, l’inhibition ou frigidité, telles que Freud les conçoit, semblent plutôt concerner exclusivement la sexualité vaginale, de sorte que la première orientation possible se traduit comme le refus du déplacement de zone érogène qu’exige le chemin vers la féminité normale. Notons également que dans d’autres textes la frigidité apparait comme une caractéristique de l’hystérie. Songeons à Dora, profil de la petite fille trop encline à l’onanisme, dont le rejet de M. K est impensable pour Freud en dehors de la matrice explicative de l’inhibition sexuelle :
en effet, si Dora se sent incapable de céder à son amour pour cet homme, si elle en vient à refouler cet amour plutôt qu’à s’y livrer, cette décision ne dépend en profondeur d’aucun autre facteur que de sa jouissance sexuelle précoce et de ses conséquences (Freud, 1905/2010, pp. 170-171).
On serait alors en droit d’identifier la jeune fille sexuellement inhibée à l’hystérique. Seulement, « l’affirmation obstinée de la masculinité », deuxième voie du complexe d’Œdipe féminin, semble également caractériser les hystériques (supposées ou avérées). Songeons à la description que Freud rapporte d’Elizabeth von R qu’il qualifie d’« impertinente et ergoteuse », « mécontente de sa féminité » et insurgée « contre l’idée de devoir sacrifier dans quelque mariage » sa liberté (Freud, 1932/2016, p. 110) ; à l’ironie avec laquelle ladite « jeune homosexuelle », réagit aux interprétations de Freud ; ou encore aux fameux « taisez-vous » et « laissez-moi raconter » d’Emmy von N11. À cela s’ajoute le choix paradoxal de Freud qui, tout en reconnaissant l’absence d’une sémiologie clinique chez sa patiente homosexuelle, analyse le cas comme s’il s’agissait d’une hystérie (Laufer, 2022 ; Molinier, 2016)12. Le deuxième destin de la féminité semble ainsi également se rapprocher de l’hystérie.
Qu’en est-il alors de la troisième issue, celle de la féminité dite « normale » ? Dans les termes de Kofman, je dirais qu’elle fonctionne comme « une pure idée limite au sens kantien » (1994, p. 165)13. Pas d’issue satisfaisante pour la femme, donc ; la fin de la conférence sur la féminité laisse un goût amer : là où « un homme d’une trentaine d’années » est décrit comme « juvénile » et « énergique », « une femme arrivée à la même période de la vie, nous effraie par sa rigidité et son immuabilités psychiques » (Freud, 1932/2016, p. 181). Et Freud de conclure, quelques lignes plus loin : « on ne voit pas s’ouvrir d’autres voies pour la suite […] comme si cette évolution difficile menant à la féminité avait épuisé les possibilités de la personne », ce qui conduira Irigaray (1974) à parler avec ironie de « solution mélancolique » (p. 78). On pourrait alors se demander si ce n’est finalement pas la féminité dite « normale » qui représente le destin le plus pathologique des trois — au sens fort de pathos, la souffrance. Si tel était le cas, devenir « hystérique » serait alors une manière d’échapper au destin mélancolique de la « féminité normale » telle que Freud la décrit. Mais en quoi cette féminité normale consiste-t-elle ? De quelle normalité s’agit-il ? Comment l’hystérique se débrouille-t-elle alors pour se jouer de la norme14 ?
L’hystérique : de la tragédie à la comédie
La féminité normale, telle que Freud la conçoit, fonctionne donc comme un point idéal conduisant la petite fille vers son destin mélancolique15, ce qui donne à ses écrits une teinte tragique16. La petite fille serait-elle alors fatalement destinée à suivre la voie de la mélancolie ? Pas tout à fait, deux autres voies s’offrent à elle que nous avons proposé de rapprocher de la position hystérique. Nous tenterons alors par la suite d´établir en quoi l’hystérique doit être considérée comme un personnage de la tragédie œdipienne. Ce premier éclairage nous permettra ensuite de montrer que l’hystérie fonctionne comme une stratégie comique permettant de contourner le destin tragique de la femme tel qu’il apparait dans les écrits freudiens. Contre la fatalité de la féminité normale, l’hystérique se masque et parodie son destin pour tenter de s’en émanciper.
L’hystérique contre Œdipe
C’est la reformulation du complexe d’Œdipe par Lacan qui nous met ici sur la voie d’une compréhension nouvelle de l’hystérie17. En effet, Lacan s’empare très tôt dans son séminaire de la figure de l’hystérique pour se démarquer partiellement de la position de Freud dont il dénonce le « forçage » (Lacan, 1966, 1998). Il radicalise ainsi le processus de dépathologisation de l’hystérie, notamment en articulant la position hystérique à la place spécifique réservée aux femmes dans le système d’alliance et de parenté (Lévi-Strauss, 1949/2002) où il repère la structure de la trame inconsciente du mythe œdipien (Lacan, 1966). Dans une perspective critique féministe, nous pouvons dès lors soutenir, en suivant Butler (2012) et Rubin (2010), que la relecture lacanienne du complexe d’Œdipe et du complexe de castration fournit une explication du rapport du sujet à la Loi, et permet d’éclairer comment cette dernière produit un ordre sexué18.
Afin de saisir l’articulation entre la tragédie œdipienne et la position hystérique, il convient alors de faire un détour par la manière dont Lacan relit l’Œdipe à partir de l’œuvre de Lévi-Strauss comme la rencontre du sujet avec la Loi (du père/homme), Loi qui assigne au sujet une place dans l’économie des échanges.
Dans Les Structures élémentaires de la parenté, Lévi-Strauss (1949/2002) soutient que l’interdit de l’inceste constitue le dénominateur commun à toute société, en tant qu’il symbolise le passage de l’état de nature à la culture. C’est par sa structure formelle (et non pas par son contenu) que le tabou de l’inceste joue un rôle décisif dans l’organisation de la division sexuée du social. En effet, l’interdiction de certaines alliances institue l’échange des objets sur lesquels pèse l’interdit. Ces objets prohibés et donc ouverts à l’échange sont systématiquement des femmes. Lévi-Strauss conclut alors que la femme fonctionne en société comme un signe que les hommes s’échangent produisant ainsi du lien social. L’homme se constitue par là en sujet social, position dont la femme sera par définition exclue, comme le souligne Gayle Rubin (2010) dans sa critique de Lévi-Strauss. En tant qu’il considère la structure de l’alliance et de la parenté comme « identique à un ordre du langage », Lacan découvre dans les descriptions de Lévi-Strauss la forme même des règles qui organisent l’inconscient freudien : « N’est-il pas sensible qu’un Lévi-Strauss en suggérant l’implication des structures du langage et de ce pan des lois sociales qui règle l’alliance et la parenté conquiert déjà le terrain même où Freud assoit l’inconscient » (1966, p. 285). Le complexe d’Œdipe est redéfini ainsi comme un « mythe », révélant une identité de structure entre les règles de l’inconscient, du langage et du système de l’alliance et de la parenté :
C’est bien en quoi le complexe d’Œdipe […], sera dit, dans notre propos, marquer les limites que notre discipline assigne à la subjectivité : à savoir, ce que le sujet peut connaître de sa participation inconsciente au mouvement des structures complexes de l’alliance, en vérifiant les effets symboliques en son existence particulière du mouvement tangentiel vers l’inceste qui se manifeste depuis l’avènement d’une communauté universelle. (Lacan, 1966, p. 277)
Le sujet apparait ainsi comme étant tragiquement soumis à la Loi qui le précède et donc le « produit » (Rubin, 2010 ; Butler, 2012). Les principales critiques féministes de cette lecture « anthropologique » de l’inconscient, parmi lesquelles on peut citer celle de Gayle Rubin dans son célèbre article de 1975, mettent l’accent sur la manière dont l’Œdipe fonctionne comme un « dispositif de production de la personnalité sexuelle » (Rubin, 2010 p. 59) contingent, qui institue une certaine organisation sociale. Lu avec un regard féministe, le drame œdipien apparait donc moins comme une nécessité incontournable que comme une fatalité obligeant chacun·e à s’inscrire dans un système qui distribue des places hiérarchisées : le sujet échangeur, d’un côté, possédant le phallus, et l’objet échangé, castré, de l’autre19. L’Œdipe transforme ainsi une partie des petits enfants « androgynes » (Rubin, 2010) en femmes castrées, dont le destin consiste à fonctionner comme objets de l’échange :
Ce qui structure à la base la relation œdipienne, […] est que la femme doit se proposer, ou, plus exactement, s’accepter elle-même comme un élément du cycle des échanges. […] elle a à s’inscrire dans le cycle des échanges de l’alliance et de la parenté au titre d’y devenir elle-même un objet d’échange. (Lacan, 1998, p. 284)
Ainsi, Rubin et Butler s’emparent de ce « constat » lacanien et proposent une lecture de la psychanalyse éminemment politique. Nulle nécessité incontournable dans cet état des choses : la division sexuée du social (et sa traduction « psychique » dans les termes du complexe d’Œdipe) est un problème politique dont les féminismes doivent se saisir.
Revenons à l’hystérique. On peut ainsi comprendre sa révolte comme une réponse au destin tragique réservé aux femmes par la loi œdipienne. La figure de Dora en est l’illustration parfaite. Dans un écrit de 1953, Lacan (1966) décrit l’hystérique comme celle qui refuse d’occuper cette place d’objet échangé dans un drame20 dont l’intrigue n’a rien à envier aux règles lévi-straussiennes de l’alliance et la parenté. L’analyse proposée par Lacan donne ainsi à voir un « quadrille » de personnages, chacun occupant sa place : les hommes, nommément M. K et le père de Dora, s’échangent les femmes, Dora et Mme K, qui jouent le rôle d’« ambassadrices » (Lacan, 1966), participant ainsi d’un véritable jeu d’alliances21. Voici le récit que fait Lacan de l’intrigue en question :
Mme K... et son père sont amants depuis tant et tant d’années et le dissimulent sous des fictions parfois ridicules. Mais le comble est qu’elle est ainsi offerte sans défense aux assiduités de M. K ... sur lesquelles son père ferme les yeux, la faisant ainsi l’objet d’un odieux échange. (Lacan, 1966, p. 218)
Dans un premier temps, nous dit Lacan reprenant fidèlement les descriptions et analyses de Freud, Dora semble accepter sa place, voire même y participer de manière active puisque « c’est non seulement sur le silence, mais par la complicité de Dora elle-même, bien plus sous sa protection vigilante, que la fiction a pu durer qui a permis à la relation des deux amants de se poursuivre. » (ibid., p. 219).
Le déroulement de cette « cure » est bien connu ainsi que l’erreur de Freud qui signe le départ de sa patiente. Freud pousse avec insistance Dora dans les bras de M. K, ratant ainsi l’objet véritable de son intérêt, Mme K. Comment comprendre l’intérêt voire la « fascination » (Lacan, 1966, p. 220) que Dora voue à Mme K ? L’hypothèse de Lacan est particulièrement intéressante. En effet, il met l’accent sur le « mystère de la féminité », dont Mme K semble détenir la clé. Lacan se réfère au « mystère de la féminité corporelle ». Or, loin de faire référence à la transcendance du « continent noir » (Freud, 1998), les précédents développements éclairent d’un jour nouveau « l’énigme » de l’hystérie. Le mystère de la féminité que convoite l’hystérique devient ainsi une question, celle de savoir comment s’inscrire dans la dialectique du désir sans abdiquer la position de sujet.
Mais cet hommage dont Freud entrevoit la puissance salutaire pour Dora, ne pourrait être reçu par elle comme manifestation du désir que si elle s’acceptait elle-même comme objet du désir. […] Aussi bien que pour toute femme et pour des raisons qui sont au fondement même des échanges sociaux les plus élémentaires (ceux-là mêmes que Dora formule dans les griefs de sa révolte), le problème de sa condition est au fond de s’accepter comme objet du désir de l’homme, et c’est là pour Dora le mystère qui motive son idolâtrie pour Mme K. (Lacan, 1966, p. 222)
De l’économie des échanges décrite par Lévi-Strauss, Lacan déduit la structure de l’économie désirante. Or, peut-on s’inscrire dans cette scène du désir en tant qu’objet sans renoncer au statut de sujet ? Peut-on consentir — et non pas céder — à devenir objet22 ? Rien n’est moins sûr. Ainsi, si Dora ne consent pas docilement à entrer dans la dialectique du désir c’est qu’elle refuse de devenir objet dans une économie érotique qui repose sur l’échange des femmes. Et on peut faire l’hypothèse que là réside le ressentiment de Dora à l’égard de Mme K : elle la déçoit lorsqu’elle découvre qu’elle a cédé23.
Cette analyse fournit une lecture possible de la gifle de Dora envers M. K lorsque ce dernier affirme que « [sa] femme n’est rien pour [lui] »24 (Freud, 1954/2005, p. 73) : par un jeu d’équivalences, Dora se voit réduite à un « rien », soit rien d’autre qu’un objet échangeable25. Pour Lacan, convoquant encore une fois la fatalité de la position féminine, le cas de Dora est révélateur de la réalité de « toute femme ». Or une lecture féministe de ce propos à la connotation si misogyne nous permettrait de tirer une autre conclusion sur l’hystérie. En effet, si Dora exprime la condition de « toute femme », alors l’hystérie en général fonctionne, non seulement comme une révolte, mais aussi comme une résistance (Kofman, 1994 ; Mitchell, 1974/2000), voire une stratégie (Butler, 2012). Les symptômes jouent ainsi un rôle central, permettant d’un côté au sujet de se rendre « inéchangeable » — une femme frigide, aphone, paralysée d’une jambe, serait ainsi sans valeur —, de l’autre, fonctionnent comme un langage (David-Ménard, 2014), le seul autorisé aux femmes-signes dans un système où seuls les hommes accèdent à la parole. L’hystérique tenterait-elle, finalement, par tous les moyens de sortir de la « condition de marchandise » (Irigaray, 1974) à laquelle semblent être destinées les femmes ?
La comédie des sexes et les masques de l’hystérique
Nous l’avons montré avec Freud puis avec Lacan : les destins imposés à la femme sont tragiques. Cependant, là où la tragédie présente un caractère de nécessité, le sujet désireux de rester en vie — ou de vivre une vie « vivable » (Butler, 2022) — trouve les moyens de sa survie. Pour l’hystérique, la comédie devient ainsi un terrain stratégique pour se frayer un chemin en évitant le destin mélancolique. La comédie, nous dit Lacan (1998, p. 262), « se présente comme le moment où le sujet […] [tente] de prendre un autre rapport à la parole que dans la tragédie ». Considérée comme mise en scène dramatique, la comédie fournit alors un moyen de se jouer du destin tragique imposé par Œdipe. On le verra, l’hystérique trouve dans la comédie des sexes, « théâtre du genre » et « scène du désir » (Berger, 2013), un lieu pour se faire entendre.
Arrêtons-nous un instant sur ce que j’appelle « comédie des sexes » afin de voir plus précisément comment l’hystérique s’y rapporte dans une modalité qui lui est propre. La comédie des sexes telle que Lacan la présente dans un écrit de 1958 (Lacan, 1966) représente le lieu de mise en scène des « rapports entre les sexes ». En effet, si la Loi de la castration structure le réel au moyen d’une séparation des sujets entre phalliques et castrés, hommes et femmes, sujets de l’échange et objets de l’échange, elle coordonne également, telle un « marionnettiste » (Berger, 2013), la scène sur laquelle se déploie la dialectique du désir. Ainsi, la comédie des sexes est le théâtre où viennent se produire et se jouer les rôles correspondant aux places instaurées par la Loi de la castration, soit le type de « rapport entre les sexes » (Lacan, 1966) qui surgit de ceci que certains sont supposés « avoir le phallus », tandis que d’autres sont supposés « l’être ». Lacan décrit ainsi ces rapports :
Disons [qu’ils] tourneront autour d’un être et d’un avoir qui, de se rapporter à un signifiant, le phallus, ont l’effet contrarié de donner d’une part réalité au sujet dans ce signifiant, d’autre part d’irréaliser les relations à signifier. Ceci par l’intervention d’un paraître qui se substitue à l’avoir, pour le protéger d’un côté, pour en masquer le manque dans l’autre, et qui a pour effet de projeter entièrement les manifestations idéales ou typiques du comportement de chacun des sexes, jusqu’à la limite de l’acte de la copulation, dans la comédie. (Lacan, 1966, p. 694)
En accord avec la binarité des places qu’instaure la Loi, la comédie des sexes met en scène hommes et femmes comme deux personnages. L’un interprète l’homme, « en paraissant » avoir le phallus, l’autre, interprète la femme en « paraissant » l’être : « c’est pour être le phallus, c’est-à-dire le signifiant du désir de l’Autre, que la femme va rejeter une part essentielle de la féminité, nommément tous ses attributs dans la mascarade » (ibid., p. 694). Avant de revenir sur les particularités de la mascarade féminine, soulignons le caractère fondamentalement paradoxal de cette comédie des sexes. En effet, les semblants sexuels donnent aux sujets une consistance (symbolique et imaginaire), tout en réaffirmant l’impossibilité du rapport et l’échec inhérent à toute tentative d’incarner ces idéaux. Butler (2012), lectrice critique de Lacan, parlera très justement de « positions impossibles », en tant qu’elles visent des idéaux normatifs, celui de la virilité — réduite par Lacan au statut de parade — et celui de la féminité — fonctionnant comme une mascarade (déguisement).
Poursuivons du côté de la fonction du masque dans la féminité afin de retrouver nos hystériques. L’année de la rédaction de son écrit sur la signification du phallus, Lacan (1998) trouve dans un cas clinique de Joan Riviere, « Womanliness as Masquerade », une illustration de la position spécifique des femmes dans la comédie des sexes. La patiente du cas se caractérise par ceci qu’elle occupe une double place : d’un côté, elle s’identifie, dans le champ professionnel, à une position masculine, tandis que dans sa vie intime, elle se réjouit de vivre une relation de couple satisfaisante où le rapport à son partenaire correspond à celui du « type idéal de son sexe » (Lacan, 1966), soit la docilité et la passivité féminines. Cette stabilité est néanmoins perturbée par des angoisses qui surgissent de manière répétée à la suite de chaque intervention publique dans le cadre professionnel, qui se redoublent par ce que l’analyste repère comme étant une « exacerbation » de ses attributs féminins. Riviere interprète ces réactions comme le moyen de se préserver des représailles paternelles pour avoir défié la Loi du père/homme (l’utilisation des signes étant réservée aux hommes). La mascarade remplit alors pour la psychanalyste une fonction : elle est un mécanisme de défense contre l’angoisse, une manière pour la patiente de (se) rappeler qu’elle n’a pas le phallus.
Lacan déplace la conclusion de Riviere et érige la mascarade en modalité même de la position féminine, qui consisterait alors à montrer qu’elle n’a pas le phallus, condition indispensable pour pouvoir « l’être », et devenir ainsi objet de désir. Nous voyons ici réapparaitre les conclusions de Freud consacrées aux fantasmes bisexuels de l’hystérique. Freud décrivait en effet la crise hystérique comme une mise en scène du « coït », paroxysme de la comédie sexuelle (Lacan, 1966), où le corps de la patiente fonctionnait comme une scène : « Ce qui rend l’attaque impénétrable c’est que la malade entreprend d’exécuter les faits et les gestes des deux personnes intervenant dans le fantasme » ; « [elle] tient d’une main sa robe serrée contre son corps (en tant que femme) tandis que de l’autre main elle s’efforce de l’arracher (en tant qu’homme) » (Freud, 1973/1992, p. 155). C’est ainsi que pour Kofman relisant Freud en féministe :
la crise hystérique, qui à la fois exhibe et dissimule la bisexualité, notamment la virilité de la femme, est la seule manière qu’a la femme, à cause des interdits auxquels elle a succombé de façon excessive, de jouir simultanément d’une double manière. (Kofman, 1994, p. 138)
Dans la crise, dont la formation répond à celle des symptômes (Freud, 1973/1992), l’hystérique conserve de manière détournée un fragment érotique qui lui avait été refusé (le fragment actif considéré comme masculin). « Exhiber et dissimuler », montrer et cacher, voilà un vocabulaire qui nous replace du côté de la mascarade. Le masque apparait ainsi comme un « refuge » (Lacan, 1966, p. 695) : à la fois un endroit qui protège et qui permet au sujet de (se) cacher/protéger (de) quelque chose. Or, si la mascarade consiste à « jouer la femme » en dissimulant la virilité, l’essence de la féminité devient insaisissable : elle est dérobade constante, dissimulation, tromperie.
Un peu plus tard dans le séminaire, Lacan revient sur la métaphore du masque en référence cette fois-ci à l’hystérique. En parlant d’Elizabeth von R, il affirme que « l’identification de l’hystérique peut parfaitement subsister d’une façon corrélative dans plusieurs directions. Elle est ici double » (1998, p. 326). Comme avec Dora, Freud butte sur le véritable objet qui intéresserait Elizabeth. S’agit-il du beau-frère ou de la sœur ? Proche de la mascarade, qui consiste à jouer des positions « être » et « avoir le phallus », nous pouvons établir que l’hystérique ne s’identifie pleinement ni à l’un ni à l’autre des personnages de ce petit théâtre, pas plus qu’elle ne les prend comme objets de son désir. De cette duplicité de l’identification, Lacan va tirer des conclusions concernant le désir de l’hystérique :
Disons que le sujet s’intéresse, qu’il est impliqué dans la situation de désir, [...]. La notion de masque veut dire que le désir se présente sous une forme ambiguë qui ne nous permet justement pas d’orienter le sujet par rapport à tel ou tel objet de la situation. (Lacan, 1998, p. 326)
Le masque vient illustrer ici l’opacité de l’hystérique, en particulier de son désir, de son intérêt, de son dessein. Que veut-elle ? Si l’intérêt du sujet hystérique est ailleurs que dans l’objet, où peut-on situer cet ailleurs ? Nous ferons l’hypothèse suivante : c’est la comédie des sexes sur laquelle se déploie la scène du désir, entre parade virile et mascarade féminine, qui intéresse l’hystérique. Cette scène du désir, nous l’avons vu, est aussi un « théâtre du genre », de sorte que l’hystérique interroge le sens de la masculinité et la féminité, et des modalités désirantes qui lui sont corrélatives.
« Ce que nous pouvons caractériser comme étant la position hystérique, […] et que pose par tout son être l’hystérique : comment peut-on être mâle ou être femelle ? Ce qui implique bien qu’il en a quand même la référence » (Lacan, 1981a, p. 283). La position hystérique, qui s’incarne dans une » question », doit dès lors être considérée comme une parole adressée.
« Taisez-vous et laissez-moi raconter »26 : discours hystérique/discours féministes
Dans Trouble dans le genre, Butler (2012) reprend la distinction proposée par Torok et Abraham entre l’incorporation, mécanisme en jeu dans la mélancolie, et l’introjection qui, au contraire, offre la possibilité d’une élaboration à travers la métaphore comme opération symbolique, caractéristique du travail du deuil. A l’endroit douloureux où, pour Butler, le genre se construit sur un mode mélancolique, c’est le processus d’incorporation qui prédomine. Or, se concentrant sur l’incorporation afin de montrer qu’elle est au cœur de la construction du genre, iel laisse de côté le mécanisme d’introjection et le potentiel qu’il renferme en tant qu’il permet la symbolisation métaphorique pour dire, sans nier, cette perte. L’introjection serait-elle alors le mécanisme au cœur de l’hystérie faisant surgir un corps-langage (David-Ménard, 2014) contre le corps-mort de la mélancolique ? Il s’agirait ainsi d’une autre lecture possible des formations inconscientes hystériques en tant qu’elles disent cette perte dans et par le corps, à travers le symptôme ou l’attaque hystérique. Encore une fois, l’hystérique évite la mélancolie.
Ce corps-langage, celui des « parleuses » (Laufer, 2022), a donné naissance à la psychanalyse autour d’une demande : celle du droit à parler et à être entendues. En cela, les féministes sont aussi des parleuses, le droit de parler et la demande d’être entendue étant au cœur de la dénonciation des violences sexistes et sexuelles, point de ralliement des discours féministes contemporains. Nous consacrerons donc cette dernière partie à rapprocher le discours de l’hystérique, son geste et son contenu, et les discours féministes.
Le maître, l’hystérique et le psychanalyste
L’expression « discours de l’hystérique » recèle une équivocité conceptuelle et sémantique que nous devons désormais prendre en charge. Jusqu’ici, je l’ai employée dans un sens faible : à partir des écrits de Butler (2012), Irigaray (1974, 1977) et Kofman (1998), j’ai tenté de dégager le geste par lequel l’hystérique contourne son destin de femme-morte. Désormais, je vais employer l’expression « discours de l’hystérique » dans le sens quelque peu différent qu’elle acquiert dans la théorie des discours de Lacan. C’est en poursuivant le geste de dépathologisation de l’hystérie que Lacan (1991) introduit l’idée que la position hystérique est fondamentalement une position discursive. Nous pouvons définir de manière générale les discours comme des structures qui sous-tendent le « dire » du sujet, lui permettant ainsi d’adopter une position d’énonciation — une adresse — où s’engage un rapport singulier au désir et à la jouissance. Or, pour Lacan, les discours opèrent en tant que structures formelles : ce qui compte ce n’est pas le contenu du discours (l’énoncé) mais la structure de son énonciation et le sens de son adresse. Ainsi, nous porterons une attention particulière aux rapports privilégiés qu’entretient le discours de l’hystérique avec celui du psychanalyste, ce qui nous permettra de mettre en valeur une double fonction. Une fonction clinique, d’abord, qui découle de ceci que l’hystérique s’adresse à la fois au maître et au psychanalyste. Or, un rapprochement du discours de l’hystérique avec les discours féministes implique un pas supplémentaire : il nous faudra, en effet, dépasser la dimension énonciative du discours pour élucider son contenu, son sens : ce sera ainsi sa fonction politique.
Commençons d’abord par éclairer son sens clinique. La théorie de Lacan nous intéresse d’abord dans la mesure où il envisage les discours comme des structures sociales — et non pas des structures psychiques27. En ce sens, l’articulation entre les discours est au cœur de l’analyse de Lacan. Il note ainsi un lien privilégié entre le discours de l’hystérique et le discours du maître — qui rappelle le récit que fera Foucault (2003) des rapports entre hystériques et médecins dans l’institution psychiatrique au XIXe siècle — mais aussi entre le discours de l’hystérique et celui du psychanalyste. En ce sens, l’hystérique semble occuper une place particulièrement intéressante dans l’ordre social. D’un côté, elle reste attachée au maître, en tant qu’elle remet en question sa position de maîtrise (Lacan, 1991). De l’autre, elle est, à proprement parler, à l’origine du discours du psychanalyste, dans la mesure où la formule de ce dernier s’obtient en déplaçant d’un quart de tour les mathèmes du discours de l’hystérique (Lacan, 1991). En ce sens, tels qu’ils sont modélisés par Lacan au moyen de la formalisation mathématique, les discours écrivent le rapport de fondement qui existe entre l’hystérique et le psychanalyste : pas de psychanalyse sans hystérie, et pas d’analyste sans l’adresse et l’énonciation de l’hystérique (Lacan, 1981b). Seulement, le lien hystérique/analyste risque de se briser si ce dernier « redérape dans le discours de la maîtrise » (Lacan, 1991, p. 79). L’hystérique rend ainsi explicite la proximité entre la figure du psychanalyste et celle du maître, qui représente son « envers » (Lacan, 1991). En ce sens, elle place le psychanalyste face à la question éthique et politique de son rapport au savoir et à la maîtrise.
L’hystérique serait-elle alors un opérateur — sorte de boussole — clinique permettant à l’analyste d’opérer un retour réflexif sur sa propre position afin d’éviter de se placer en « maître » face à ses analysant·es. Cette écoute aurait la particularité d’être sensible à la dimension hybride de l’inconscient (Ayouch, 2018), à la contamination entre « dedans » et « dehors » qui s’exprime dans toute parole inconsciente. Comme nous l’avons montré, les cas d’hystérie de Freud révèlent que la psychanalyse a toujours déjà eu affaire au social dans sa clinique. Pourtant, si les normes, les discours culturels et sociétaux impactent les sujets, la manière dont chacun est affecté demeure intrinsèquement singulière, de sorte que l’analyse est irréductible à une logique universelle (Alemán, 2012). Telle semble être la singularité de la clinique psychanalytique, qui, selon les mots de Fabrice Bourlez, consiste à « aller voir de quoi retourne le marquage de l’Autre (social, familial, langagier) sur son corps et en saisir l’irréductibilité » (2018, p. 142). Il convient dès lors de se montrer attentif à cette altération du « soi » — si tant est que cela existe — par l’Autre, à l’altérité qui habite toujours le « propre ».
Si l’utilité de la figure de l’hystérique semble alors justifiée d’un point de vue interne à la psychanalyse, quel intérêt auraient les féminismes à faire appel à l’hystérique, et à convoquer ainsi l’ensemble de la boîte à outil psychanalytique ? La réponse se trouve sous la plume de Gayle Rubin (2010, p. 54) qui déjà en 1975 revendiquait l’utilité théorique de la discipline pour une critique féministe : « les effets que les systèmes sociaux dominés par les hommes produisent sur des femmes ne sont nulle part mieux attestés que dans la littérature clinique ». Ces « effets » sont particulièrement lisibles dans les cas d’hystérie de Freud qui témoignent, comme nous l’avons vu, de la position subalterne des femmes dans le champ de la parole et du désir. En ce sens, il nous faut porter notre attention au contenu du discours de l’hystérique : contre cette subalternisation dans le champ de la parole et du désir, l’hystérique articule une demande dont nous allons désormais montrer la valeur « politique ».
Être féministe, rester hystérique28
Nous l’avons vu, pour Lacan, l’hystérique pose une question fondamentale : qu’est-ce qu’une femme au regard d’un homme et vice versa ? Quelles sont les implications de cette distinction sur le plan du désir ? Le sens de cette question — aussi singulière soit-elle — suspend ainsi l’évidente naturalité avec laquelle le sexe, le genre et le désir semblent prendre place dans nos existences. Si l’hystérique « a le sens de la référence » (Lacan, 1981a, p. 283), elle ne s’en contente pas, dans la mesure où être un homme ou une femme ne relève pas, pour elle, de l’évidence. En ce sens, son questionnement résonne en nous comme une remise en question de l’ordre du genre et du désir. Le discours de l’hystérique anticiperait-il la visée et le sens des discours féministes ? C’est ce que montre Hélène Cixous (1986) réécrivant le cas Dora sous forme de drame. Ce geste littéraire et politique nous permet de saisir la manière dont le discours de l’hystérique (ici incarné par Dora) est également une contestation, la « transgression d’un certain ordre » (Lacan, 1953). Cixous fait de l’hystérique, non seulement un personnage dramatique mais également un personnage politique. En ce sens, le choix du genre dramatique pour la réécriture du cas n’est pas anodin : il redouble, en effet, la comédie sur laquelle repose l’ordre du genre et du désir à travers une Dora qui (s’)interroge (sur) la dimension théâtrale (tragi-comique) de sa propre situation. Contrairement à la version originale du cas de Freud, Cixous met en scène une Dora qui connait bien la « place » qu’elle est censée occuper dans l’économie des échanges. Elle n’a pas peur de déclarer au spectateur :
Papa profite des occasions que lui laisse Monsieur K. Monsieur K profite des occasions que lui laisse papa. Tout le monde sait s’arranger. […] Il ne voulait pas se rendre compte du comportement de Monsieur K, cela l’aurait gêné dans ses relations avec elle » (Cixous, 1986, p. 67).
Cixous produit ainsi une lecture féministe de Dora, dans la mesure où elle refuse de lire le cas comme un simple drame petit-bourgeois. Elle choisit, au contraire, d’inscrire la figure de Dora dans un scénario politique, en donnant à voir et à entendre la place des femmes dans une économie des relations dominée par des figures masculines : Monsieur K., Freud, le père de Dora.
Or, la pièce opère un pas supplémentaire : il ne s’agit pas seulement de dénoncer la structure de cette économie des relations (qui place la femme du côté de l’objet échangé) mais également de montrer sa traduction sur le plan du désir, dont Dora n’est rien d’autre que l’effet révolté. Or, cette économie des désirs, comment est-elle structurée ? Sur quoi repose-t-elle ? Nous pouvons en effet rattacher l’économie désirante décrite par Cixous à ce que Laplanche (2009) appelle « logique phallique », soit un type d’organisation binaire de la réalité, reposant sur la distinction du « un et du zéro, du plus et du moins, du phallique et du castré »29. Ce qui nous intéresse ici, c’est le lien entre cette structure binaire et le regard comme modalité privilégiée du rapport au monde et en particulier au désir. En effet, la logique phallique est entièrement dépendante d’une autre binarité : celle qui distingue — et hiérarchise — présence et absence, en valorisant qu’il y ait « quelque chose » (le pénis) plutôt que « rien ». Comme le souligne Laplanche, la logique phallique s’appuie sur le récit d’une perception de la « différence des sexes »30. Or, cette perception, loin d’être pure ou immédiate, est déjà façonnée par les distinctions qui opèrent dans le social : il n’y a pas de perception qui ne soit pas déjà une interprétation.
La logique phallique, indissociable du primat du regard, structure le désir autour de ce que Lacan a décrit comme étant une « comédie des sexes ». Avec Butler (2012), la comédie des sexes de Lacan est renommée, à juste titre, « comédie hétérosexuelle », et devient la forme sous laquelle apparait et se présente le désir à l’intérieur des coordonnées hétéronormées. Comme nous l’avons montré plus haut, la figure de l’hystérique s’inscrit à l’intérieur de cette organisation du genre et du désir. Seulement, son je/u vient troubler quelque peu le déroulement attendu de la pièce. Ainsi, dans sa réécriture du cas, Cixous fait de Dora un personnage conscient de sa position d’opprimée. On la voit, en ce sens, à plusieurs reprises interpeller directement les spectateur.ices. Brisant le quatrième mur, elle amorce une rupture du cadre en obligeant le public à regarder la pièce pour ce qu’elle est : un théâtre, une fiction. Les féministes ne seraient-elles pas ainsi des hystériques qui ont décidé de faire un pas supplémentaire et de quitter, enfin, la scène — celles qui collectivement annoncent que « désormais, on se lève et on se barre » (Despentes, 2020), refusant ainsi définitivement de jouer le rôle qui leur était assigné ?
Le discours de l’hystérique n’est pas synonyme du discours féministe ; il n’est pas non plus un discours féministe. En revanche, la position discursive de l’hystérique anticipe certaines théorisations féministes. Dans les termes d’Irigaray (1977, p. 136), si l’hystérique témoigne de « la subordination du désir féminin au phallocratisme […] il y a [néanmoins] dans l’hystérie, la possibilité d’un autre mode de « production » ». Ainsi, dans l’héritage des hystériques, des féministes ont imaginé, écrit et réinventé d’autres modes de production désirante, parmi lesquels nous pouvons citer la mécanique des fluides (Irigaray, 1977), l’Amour Autre (Cixous, 1975/2010) ou encore l’érotique du corps lesbien (Wittig, 1973/2004). Ces inventions — chacune dans sa spécificité — ont contribué à déloger la pulsion scopique, basée sur le regard — sur laquelle reposent notamment le genre et le désir dans leur dimension spe(cta)culaire (Berger, 2013) —, au profit de modalités érotiques orales, vocales ou haptiques. Et en restructurant l’économie désirante, c’est l’ensemble de l’économie des relations qui est bouleversée. Alors, quand bien même l’hystérique n’échapperait pas totalement à la logique phallique qui la produit, son discours résonne néanmoins avec ceux des féministes. Sa révolte laisse entendre qu’il est possible (et urgent) d’interroger l’économie du désir pour la réinventer, rejoignant ainsi une question fondamentale : celle du rapport entre le genre et le désir, en tant qu’ils sont fondamentalement indissociables tout en étant marqués par le malentendu (Bourlez, 2018, p. 143) et l’inadéquation comme horizons indépassables.
Conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêt déclaré.