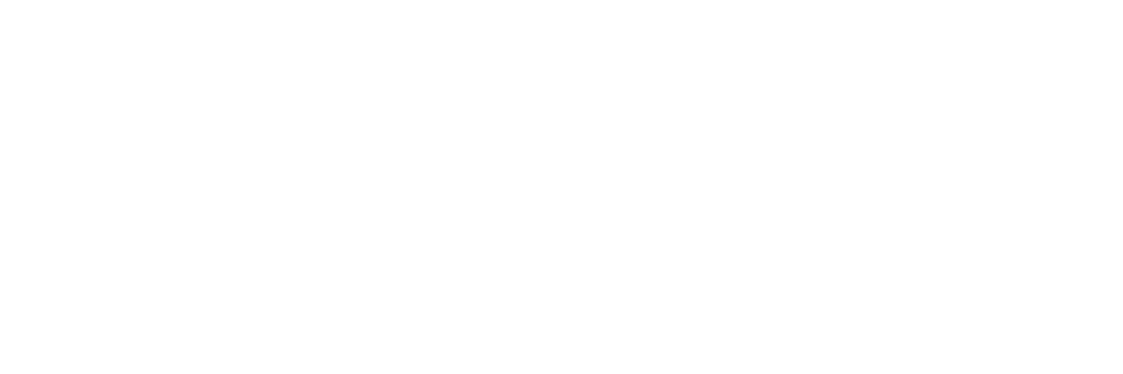Introduction
Bénéficiant d’une notoriété exponentielle, le concept de résilience et les productions testimoniales qui en relatent l’expérience occupent aujourd’hui une place centrale dans les sphères du discours et de la représentation. Alimentés en continu par un marché prolifique et soutenus par une idéologie politique de la gestion de soi dans un monde incertain, ces récits de soi résilients sont devenus les modèles idéaux-typiques de l’expression d’une souffrance hors-norme. Si plusieurs sociologues ont déjà analysé en profondeur ce que la catégorie de résilience et son essor nous disent du monde social (Marquis, 2014 ; Illouz, 2019) ; mon intérêt porte davantage sur la façon dont vont se structurer les différents espaces politiques et rapports de pouvoir contemporains, à partir des cadres normatifs au sein desquels nos émotions doivent et peuvent — ou non — s’exprimer. Aussi, cet article vise à analyser la façon dont la multiplication des récits de résilience contribue à invisibiliser tout un pan de la souffrance hors-norme — principalement subalterne —, en empêchant l’émergence d’émancipations radicales.
Pensé comme une enquête exploratoire, le présent texte propose comme point de départ l’analyse des conditions de l’audibilité subalterne et les apories de la narration à la première personne. En miroir de ces éléments, je reviendrai ensuite longuement sur le cadre normatif d’énonciation du témoignage résilient, dans ce qu’il a d’inclusif et de discriminant par rapport à l’expression de la résistance. J’examinerai par la suite, à partir d’apports théoriques pluriels, la façon dont sont produits différents cadrages des expériences émotionnelles dans une perspective politique, tout en tentant de rendre compte de certaines similitudes dans leur application. Enfin, je proposerai de mettre en discussion ces éléments afin d’interroger les enjeux d’une société dans laquelle la transformation de nos existences en un processus sans fin d’auto-gestion émotionnelle, devient essentielle pour faire reconnaître une souffrance, et tenter de survivre aux désastres qui nous guettent.
The subaltern cannot speak1
« Et c’est pourquoi je réponds par la négative à la question que je pose dans le titre : non, les Subalternes, dans la mesure même où iels sont en position de subalternité, ne peuvent pas parler. Et ceux qui prétendent les entendre ne font en fait que parler à leur place. »
Gayatri Spivak (citée dans Chauveau, 2022)
En décembre 2020, je publiais dans la revue indépendante En Marges ! un texte personnel rédigé à la première personne (Dormeau, 2020a). J’y reprenais la trame d’une communication antérieure interrogeant le récit de soi comme pratique d’émancipation politique des sujets de la psychiatrie contemporaine. L’enjeu initial de cette communication était de croiser des apports issus des études post-coloniales et de la philosophie politique, pour tenter d’en dégager un cadre théorique applicable au champ de la psychiatrie. Je développais l’idée que la mise en récit de soi des sujets subalternes (ici psychiatrisé·es), loin d’être une pratique d’émancipation politique, devenait au contraire une entreprise de dépolitisation de soi. Car si la narration de soi — lorsqu’elle est rendue possible — permet une reconnaissance individuelle des subalternes, toute tentative de dépassement de celle-ci dans une perspective collective est en revanche disqualifiée. J’en concluais alors que les sujets parlant de la psychiatrie contemporaine n’étaient toujours pas émancipé·es, bien qu’ils et elles soient désormais audibles, la non-reconnaissance historique de leur condition subalterne ne permettant pas une redistribution des rapports de force en présence.
Initialement empruntée au philosophe Antonio Gramsci, je définis et retravaille la notion de subalternité comme expression simultanée de la subordination et de la résistance chez un individu ou un groupe d’individus, dans son rapport au groupe dominant. Dans un article retraçant l’émergence du concept de subalterne dans les écrits de Gramsci, Guido Liguori (2016) rappelle que dans sa première acception, le terme renvoyait à un ensemble hétérogène de classes sociales subissant les initiatives de la classe dominante dans son projet d’hégémonie2. Mais à mesure de l’évolution de la pensée gramscienne et au sein même de ses écrits, le sujet auquel se rapporte la caractéristique de « subalterne » n’est plus seulement une classe ou un groupe social mais s’applique également à un individu singulier (Liguori, 2016), désignant plus vastement une façon dialectique d’être simultanément objet de la domination et sujet de la résistance dans un rapport de pouvoir. Reprendre ce vocable à mon compte pour caractériser les personnes psychiatrisées (i.e. étant ou ayant été l’objet du pouvoir psychiatrique) et m’auto-désigner, c’est vouloir mettre la lumière sur cette conflictualité intrinsèque, tout en l’inscrivant au sein du rapport de force historique dont elle est issue. C’est, selon moi et jusqu’alors, le terme le plus précis me permettant d’appréhender des formes de subjectivités qui seraient constituées par et dans une relation de pouvoir simultanément rejetée et perpétuée. La théoricienne de la littérature et philosophe féministe indienne Gayatri Chakravorty Spivak, sur laquelle je m’étais largement appuyée pour produire cette communication, a consacré son essai Can the subaltern speak3 ? à interroger les conditions de possibilité de la prise de parole des femmes du tiers-monde (notamment indiennes), vivant à l’intersection de plusieurs sources d’oppression. Rejetées hors du système dominant, subalternisées par des siècles d’Histoire coloniale, impérialiste et patriarcale, les subalternes de Spivak (2006) ne correspondent à aucune catégorie politique identifiée ou identifiable, et sont par conséquent vouées à demeurer des sans-voix sans identité, réduites historiquement au silence.
Si la tentation est grande de chercher à répondre à la question posée en titre (Can the subaltern speak ?), il convient davantage d’examiner les fondements même d’une telle proposition. Car l’interrogation de l’autrice porte en réalité sur le possible même d’une prise de parole par les subalternes, et non leur capacité effective à s’exprimer. Il n’est pas étonnant que cette suggestion émerge dans les années 1980, moment charnière où le champ des études subalternes est considérablement alimenté par des auteur·ices issu·es de la littérature comparée tel·les que Edward Saïd ou Homi Bhabha (et Spivak bien sûr)4, et faisant la part belle aux enjeux discursifs. En interrogeant les conditions de possibilité d’une parole subalterne, Spivak — ici dans une lignée directement gramscienne — nous indique que le processus de subalternisation ne repose pas uniquement sur un rapport de force matériel, mais également sur la confiscation d’un discours qui permettrait l’auto-représentation. C’est donc bien l’articulation complexe et éminemment politique entre vouloir dire et pouvoir dire que pointe l’autrice dans cet essai, dont une première version parue quelques années plus tôt portait d’ailleurs le titre évocateur « Pouvoir et désir ». Et cette tension entre la capacité à dire et la possibilité d’être entendu·e, si elle se loge au creux du rapport de domination, traverse également toute mon existence et teinte inévitablement mes travaux. J’y reconnais le lien ambivalent et si fort entre le pouvoir psychiatrique et les psychiatrisé·es, les relations soignant·es-soigné·es hors enfermement n’y faisant, à mon sens, pas exception. Ces apports théoriques m’ont aidé à préciser la subjectivation subalterne à partir des catégories dans lesquelles je m’inscris et que j’éprouve, m’invitant à m’interroger à la première personne depuis cette phrase sentencieuse : The subaltern cannot speak. Car si on m’écoute alors que je ne suis pas audible, qui suis-je réellement lorsque je parle ?
Moins académique que la communication initiale présentée en congrès, le texte paru dans En Marges ! avait consisté à expérimenter une narration différente, me permettant d’articuler ces interrogations conceptuelles avec mon expérience personnelle en tant que femme toxicomane et psychiatrisée5. Plus que l’expression d’un besoin égotique, partir de mon expérience procédait (et procède toujours) d’une démarche heuristique, où les problèmes qui se posent à moi en tant que sujet viennent nourrir plus largement une approche critique du pouvoir et des dominations. Pourtant, dans les retours qui m’ont été adressés, il apparaît que c’est le moment testimonial qui a suscité le plus vif intérêt ; bien plus que la critique acerbe de sa possibilité même, formulée à moi-même et adressée au lectorat comme une contradiction douloureuse et inhérente à l’ambivalence de ma position d’énonciation. Ce qui a principalement été salué, c’est la résilience dont j’ai semblé faire preuve dans mon parcours, conférant ainsi à mon récit une tonalité inspirante — ou plus sûrement inspirationnelle6 —, éludant totalement la renormalisation dont j’ai fait l’objet et les souhaits d’émancipation politique que je pose pourtant de façon claire. Si le paradoxe n’est qu’apparent, force est de constater que c’est en faisant la démonstration exemplaire d’une rationalité libérée du poids d’affects pesants, qu’il m’a été simultanément possible de dévoiler une réflexivité ambigüe et inconfortable. Ce que je soulignais déjà dans la communication initiale, c’est le dévoiement progressif du concept d’empowerment (Dormeau et Tehel, 2021) dans le champ de la psychiatrie — et plus largement de la santé mentale — permettant de valoriser une agentivité sensément retrouvée tout en invisibilisant les critères évaluatifs sur lesquels ce postulat se fonde. La capacité d’élaboration biographique, spécifiquement lorsque celle-ci peut s’exprimer sans débordements émotionnels, est un indicateur central du processus de recouvrement d’un pouvoir d’agir. L’ambition de renverser l’ordre établi et les rapports de domination en présence n’en constituent en revanche toujours pas un. Aussi, lorsque j’énonce que « je suis un sujet du soin psychiatrique mais aussi et surtout, [parce] que je suis l’individu-sujet parlant archétypal de la psychiatrie néolibérale » (Dormeau, 2020a) ; je ne suis pas en train de me raconter, mais bien de me situer.
Parler à la première personne : se raconter ou se situer ?
Fort d’une réception toujours croissante, l’article de la philosophe et biologiste Donna Haraway (1988), Savoirs situés : la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle, opère un déplacement épistémologique fondateur. Il est désormais entendu pour une certaine frange de chercheur·euses et militant·es, que toute production de savoir est dite située7, en ce qu’elle émane nécessairement d’une situation subjective reliée à un environnement, disqualifiant ainsi le présupposé largement partagé dans la communauté scientifique de connaissances produites de façon « objectivement neutres ». Nos schémas de pensées étant pour partie le fruit de nos contextes, nous ne saurions prétendre à l’implacable neutralité ou l’universalité de nos propositions ; qu’elles soient intellectuelles, politiques, artistiques ou matérielles. L’« épistémologie du positionnement » (standpoint) aussi appelée « épistémologie du point de vue » est un champ d’études issu du féminisme, qui articule interrogations épistémologiques et enjeux politiques à partir des conditions matérielles d’existence des personnes subissant l’exploitation, et considérant notamment l’intersectionnalité des rapports de genre, de race et de classe (Bracke et Puig de la Bellacasa, 2013). Si cette interrogation épistémique8 me semble féconde et pertinente à convoquer, c’est bien parce qu’elle vient préciser la distinction se raconter / se situer dont je tente de rendre compte ici. Car ce que rappellent avec rigueur les épistémologies féministes dites du standpoint, c’est que l’action de se raconter, si elle dénote une situation (d’où je parle) n’est pas une valeur performative en soi. Il ne s’agit pas seulement de revendiquer une perspective spécifique issue de l’appartenance à un groupe minorisé — que j’appelle subalterne —, mais bien de produire un point de vue/positionnement épistémique à partir d’une perspective particulière, qui se doit d’être agrégé à des luttes collectives pour l’émancipation politique. Par conséquent, si le fait de ne pas appartenir à la classe dominante donne bien souvent l’accès à au moins deux perspectives (celle du dominant et celle du/de la dominé·e9), cela ne signifie pas pour autant que des choix de lutte ou une production alternative de savoirs dits situés en émergent.
Ce dernier élément, souvent laissé pour compte voire totalement ignoré, produit pourtant une situation politique d’énonciation bien distincte de celle qui procède d’un témoignage singulier ayant pour objectif de visibiliser une situation subjective particulière. Pour le dire autrement, Se raconter produit un témoignage dont la forme est recevable, audible, ses contours étant appréhendables dans un référentiel normatif partagé (puisque issu de l’épistémologie dominante). Se situer produit en revanche un nouvel agencement et permet de prendre appui différemment dans le monde pour inscrire des savoirs hétérogènes à partir de et dans une autre matrice de sens, non partagée par toustes (puisque issue d’une épistémologie subalterne). Si je m’inscris obstinément dans cette vision, c’est parce que le sillon tracé par les théories du standpoint a permis de faire germer en moi un possible. Celui d’envisager que bâtir un cadre théorique objectivé à partir de mon expérience, produire du concept, c’est m’inscrire dans les interstices du savoir dominant — entre ses lignes donc — sans cesser de militer pour m’en émanciper. Ainsi, être désormais une locutrice partiellement audible, c’est nécessairement me parer de et agiter tous les codes me permettant de l’être, sans jamais pouvoir me départir de la violence de leur internalisation. Car si une partie de la classe dominante m’écoute — sans toutefois jamais m’entendre — c’est bien qu’il existe au moins un lieu commun au sein duquel nos similitudes s’expriment. Par ailleurs, mon travail se situe précisément sur cette crête, au point de bascule où être un sujet-parlant ne me sort de la subalternité que pour mieux me dissoudre dans le discours dominant, me fondre dans la rationalité néolibérale.
Produire du sens pour soi / Produire un savoir pour la communauté
Bien que la distinction entre récit et positionnement me paraît importante à approfondir, il convient néanmoins de ne jamais perdre de vue l’interrelation complexe qui unit ces deux modes d’énonciation. Dans l’exemple personnel à partir duquel je tisse, locution et réception sont empreintes d’enjeux qui se rejoignent et s’excluent pourtant mutuellement, chacun d’entre eux se jouant à plusieurs niveaux. Tout d’abord, les je qui ont rédigé ce texte figurent des parties de moi distinctes aux désirs et prétentions plurielles. Si certaines d’entre elles dialoguent, d’autres sont continuellement en tension. Ainsi, prétendre que je ne fais que me situer sans jamais chercher à me raconter est quelque peu injuste, et manque d’honnêteté intellectuelle. Si je m’applique à mobiliser un langage standardisé, c’est précisément car j’ai conscience qu’il est socialement partagé. Mais ce n’est pas ma langue ; c’est un apprentissage, une domestication. Ce que cette attitude de bonne élève produit, quoi qu’il m’en coûte, c’est bien une forme de reconnaissance. En suivant l’anthropologue Veena Das (1998), je considère que l’expression d’une souffrance (fut-elle passée voire dépassée, et quelle que soit sa forme) s’inscrit simultanément dans une demande de reconnaissance de celle-ci par autrui, et il serait vain de croire que mes élans narratifs ne sont pas en partie motivés par ce souhait. Plus encore, je ne saurais nier le caractère pressant — parfois vital — de la production de sens pour soi qui, si elle ne peut être métabolisée qu’en étant ratifiée par une instance extérieure, permet au moins temporairement d’endiguer une précarité psychique toujours latente. En outre, je crois fermement que le besoin d’être reconnu·e comme sujet subalterne subjectif (ce que le rapport de domination a produit comme effets sur mon développement en tant qu’individu) ne doit jamais être une fin en soi, et en aucun cas ne devrait éclipser la nécessité socio-politique de la reconnaissance de sujets subalternes historiques (comment se sont toujours structurés les rapports de pouvoir, au détriment de qui, et avec quelle actualité) ; ou bien chacune de nos histoires n’est vouée qu’à la perpétuation.
Ensuite, les récits réflexifs faisant état d’un dépassement (une souffrance a été dépassée, vaincue ou transformée) alimentent inlassablement le discours méritocratique, qui repose en grande partie sur la valorisation et la sensationnalisation des trajectoires considérées comme inspirantes et extraordinairement résilientes. Les reconnaître, c’est attester du chemin parcouru, c’est saluer la transformation de soi et le produit fini présenté aux regards d’autrui, tout en nourrissant une rhétorique de la performance permettant de justifier en partie les inégalités sociales (Dormeau et Tehel, 2021 ; Jaquet, 2014). Les réincorporer dans la trame normative en édulcorant toute trace de résistance est non seulement l’acte par lequel un pouvoir dominant continue de s’imposer comme tel ; mais c’est également un geste qui anéantit en surface la tentative de production d’un savoir pour la communauté (i.e. subalterne). En se réappropriant les récits — fussent-ils gentiment critiques — comme faisant partie intégrante d’une narration collective (à comprendre majoritaire et dominante), le message semble très clair : il ne saurait y avoir qu’un texte public, constitué, pour le dire avec James Scott (2019), par le reflet des « images flatteuses que les élites produisent d’elles-mêmes10 » (p. 32). Telle est la condition de l’audibilité. Son arc est lui tout aussi limpide : des témoignages inspirants « dans lesquels des âmes perdues deviennent des personnes responsables [...] par la rencontre avec elles-mêmes » (Marquis, 2017).
En définitive, il apparaît que l’expression de la résistance (et des résistances) qui permettrait une production de savoir pour la communauté, s’affaiblit voire se dissout dès lors qu’elle rencontre les désirs des classes dominantes, dont l’intérêt porte davantage sur les récits victorieux d’un empuissancement11 perçu comme émancipateur. Dans cette perspective, il s’agit notamment de saluer et valider les productions de sens pour soi permettant ainsi de performer l’altérité sans avoir à abandonner sa position de surplomb. Car ces productions, dans leur élaboration et leur forme même, reposent principalement sur deux éléments qui vont de pair : la capacité réflexive et l’autogestion émotionnelle. Historiquement dominé, dépossédé de sa puissance d’agir, le sujet subalterne recouvre peu à peu son humanité via la capacité à la mettre en mots de façon rationnelle. D’une certaine manière, nous pourrions presque dire qu’il retrouve sa forme initiale (assignée), que son développement vers la normativité, détourné de sa trajectoire linéaire par la violence de la souffrance, reprend partiellement son cours.
« Vulnérables mais invincibles » : les existences invaincues
Initialement utilisée en physique pour décrire la capacité de résistance d’un matériau à un choc, la notion de résilience s’est aujourd’hui répandue auprès d’un large public et bénéficie d’une grande visibilité. Popularisée en partie grâce aux nombreux ouvrages que le psychiatre médiatique Boris Cyrulnik lui a consacré (Marquis, 2014, 2018), la résilience fut en premier lieu mobilisée pour caractériser la façon dont certains enfants, ayant grandi dans un contexte défavorable à leur développement, paraissaient moins affectés que d’autres dans leur parcours de vie (Masten et al., 1990 ; Rutter, 1985 ; Werner et Smith, 1982). Sous la plume du psychiatre à succès, la définition désormais consacrée dans le champ de la santé mentale désigne la « capacité à réussir, à vivre et à se développer positivement, de manière socialement acceptable en dépit du stress ou d’une adversité qui comporte normalement le risque grave d’une issue négative » (Cyrulnik, 1999, p. 8). Très rapidement, le concept s’étend à une approche prédictive de certaines pathologies psychiatriques et troubles de la personnalité (Masten et Cicchetti, 2012), pour enfin venir se fixer dans les discours et programmes politiques comme une nécessité citoyenne et solidaire en réponse à l’existence d’une menace réelle ou supposée (Klein et al., 2008 ; Massumi, 2021 ; Ribault, 2021).
La psychologue américaine Emmie Werner (voir Werner et Smith, 1982) — à qui il est attribué la maternité du concept de résilience — a effectué plusieurs études longitudinales démontrant la variabilité du parcours de vie de jeunes enfants ayant évolué dans des contextes environnementaux jugés défavorables à leur développement. Elle dira de ces enfants, suivis durant près de 30 ans et devenu·es adultes, qu’ils et elles ont su rebondir à partir d’une enfance difficile, devenant ainsi des sujets certes vulnérables, mais invincibles, invaincus, qui ne sauraient manifestement être détruits par les expériences néfastes de la vie (Werner, 1992). Il serait donc bien possible, comme certains matériaux, d’encaisser différents chocs en recouvrant tout ou partie de sa forme initiale ; c’est ce que nous dit la clinique de la fin du siècle dernier. Dans son prolongement actuel, la résilience devient principalement une autodésignation formulée à partir d’une description établie par un tiers (par exemple se définir comme résilient·e suite à la lecture des ouvrages de Boris Cyrulnik ; voir Marquis, 2018). Mais le processus de résilience est présenté de façon ambivalente : la littérature — de développement personnel et de psychologie positive notamment — aime à rappeler que les personnes résilientes sont et ont des parcours hors-normes voire spectaculaires, puisqu’elles ont réussi à reprendre le cours de leur développement après un traumatisme. Parallèlement, elle suggère pourtant que ce chemin est accessible à chacun·e d’entre nous, ne s’agissant en réalité que d’une recherche de ressources internes mobilisables pour traverser les épreuves de la vie. En creux, il faut en déduire que si nous ne sommes pas en mesure de trouver et faire appel à ces ressources en nous, c’est que nous avons mal ou insuffisamment cherché, leur existence n’étant jamais remise en cause. S’il n’est donc pas qu’un simple retour à un équilibre antérieur, le processus de résilience se figure au contraire comme un voyage intérieur, menant celles et ceux qui l’entreprendraient « à un style de vie d’une qualité particulière, grave et extra-ordinaire » (Marquis, 2018), les marquant du double sceau du trauma et du dépassement.
En cela, la catégorie même de résilience produit une lecture du malheur comme voie d’accès sinueuse, et quelque part privilégiée, à un mode de vie plus authentique et un rapport à soi plus « vrai », indisponible à qui n’aurait pas vécu cette profonde transformation et les souffrances qui l’ont engendrée. Un processus de différenciation des existences se rejoue partiellement ici, ne procédant plus d’une subalternisation verticale telle qu’elle s’exerce par le groupe dominant sur les groupes subalternes, mais procède d’une requalification intra et intersubjective déterminant un seuil traumatique. Comme l’a très bien montré le sociologue Nicolas Marquis dans son analyse du courrier des lecteur·ices adressé à Cyrulnik12, mobiliser la catégorie de résilience pour s’auto-désigner est extrêmement important pour les individus. Non seulement car cela produit un sens permettant d’éclairer leur parcours et la douleur qui y est associée, mais également une forme d’efficacité opératoire leur donnant le sentiment de « s’en être sorti·e » (Marquis, 2014). Comme tout concept jouissant d’une grande popularité, la définition de la résilience et de son cadre d’expérience occasionne de multiples conflits entre ses différent·es promoteur·ices. Précisément, c’est la dénomination de traumatisme pour qualifier la souffrance antérieure qui suscite les plus grandes disparités d’analyse, parcourant un spectre large allant de l’expérience concentrationnaire (Cyrulnik, 1999) à la rupture amoureuse (Tomasella, 2010). Plus vaste encore, l’adoption d’une « posture de résilience au quotidien » peut être envisagée selon Caroline Le Flour comme une philosophie de vie générale, « que nous ayons vécu un événement difficile, traumatisant, ou que nous soyons simplement en recherche d’épanouissement individuel13 ».
Empuissancement collectif et communauté de résilient·es
Ce qu’il convient de souligner ici, en lien avec ma préoccupation initiale, c’est que l’espace et l’audibilité accordée aux résilient·es mettant en récit leur cheminement ne leur permet pas une sortie de la condition subalterne, si telle était leur position préalable. N’oublions pas les leçons de Spivak (2006) ainsi que celles de Scott (2019) : les subalternes ne peuvent pas parler, ou en tous cas ne peuvent être audibles par les dominants sauf à prendre part au texte public. Bien au contraire, l’expansion des récits de soi résilients compose une nouvelle norme, et restreint considérablement le périmètre tolérable pour exprimer une souffrance en dehors de cette narration. Plus encore lorsque cette souffrance est le fruit de rapports de domination multiséculaires et porte en elle des prétentions révolutionnaires. La nouvelle voie d’accès vers l’émancipation via la transformation de ses malheurs ne fait que garantir la reproduction d’un enfermement dichotomique aux allures d’alternatives infernales (Pignarre et Stengers, 2007) : se raconter et intégrer la communauté, ou rester dans sa souffrance et périr.
Conçus sur ce modèle, les différents contenus cités préalablement s’inscrivent pleinement dans ce que l’on nomme développement personnel, entendu comme une pluralité de techniques sur soi14. Caractéristique de ce développement de soi, c’est que ne se vivant qu’au singulier, il s’impose pourtant à toustes, ne pouvant s’éprouver que dans le collectif, s’immisçant irrémédiablement entre les individus et surgissant dans chaque segment relationnel. Car si le voyage est solitaire, il est cependant loin d’être silencieux. Il se formule, se raconte, se partage. Il n’est pas une solitude. Il produit du lien entre les individus en les connectant à des faiblesses certes profondément individuelles mais qui, agrégées les unes aux autres dans un narratif de la conquête de soi et de la résistance par l’adaptation, devient une idéologie sécuritaire (et immunitaire) à peine voilée. Structurellement, l’invitation horizontale (de pair·e à pair·e) à se résiliencer peut être analysée comme une économie politique, bâtie sur un pouvoir distribué, interstitiel, supposément égalitaire et généreux. On forme sans même en avoir conscience une communauté de résilient·es, dont les critères d’exclusion sont pourtant bien connus de tous·tes ses membres. On s’empuissance en partageant, en s’inspirant les un·es les autres, en faisant circuler le récit de nos quêtes intérieures à la recherche de ces ressources innées. Cette circularité aurait par ailleurs la vertu d’abolir ne serait-ce que ponctuellement les inégalités sociales et relations de pouvoir en présence, le plus petit dénominateur commun à l’humanité étant la possibilité de convoquer ses ressources intérieures.
Mais l’être humain n’est pas un matériau, nous ne sommes pas résilient·es par nature, et le discours anthropologique15 qui pointe une capacité intrinsèque à se développer même en milieu hostile, ne fait que renforcer une ingénierie de la résilience dont le consentement à la souffrance et aux désastres est le fondement (Ribault, 2021). Plus sûrement, il apparaît que certains individus en enjoignent d’autres à devenir résilient·es, à s’intéresser à ce processus comme un possible de production de sens pour soi mis en commun, ce texte public qui n’a jusqu’alors subit aucune offense qui ne soit pas immédiatement assimilable. Ce que nous disent les promoteur·ices de la résilience, toujours dans cette ambivalence, c’est qu’elle est un inné qui s’acquiert. C’est l’intime en soi le plus universel. Les fragilités d’hier qui, partagées et mises en mots deviennent les forces collectives et solidaires de demain. Surtout, c’est un apprentissage rigoureux qui demande investissement et autodiscipline. Et si on s’y applique alors la promesse est plus grande encore, car peut-être pourrons-nous traverser le pire, s’en relever, ne plus trembler devant la menace et qui sait ? pourquoi pas se reconstruire et se renouveler à l’infini.
Comme nous l’avons vu, puisqu’il est plus confortable pour les dominants de valoriser la résilience individuelle que de se confronter aux résistances collectives, une stratégie politique qui repose sur l’homogénéisation du principe de résilience comme élément d’un monde commun habitable et désirable, permet structurellement une conservation du pouvoir par ses élites. En produisant volontairement des récits à la première personne vantant les mérites de la transformation de soi grâce à une meilleure résistance aux chocs, chaque individu en vient à alimenter ce texte public, pré-écrit pour nous et designé16 sur mesure. Le mécanisme de reproduction des rapports de domination exogènes à l’intérieur de soi que j’ai nommé ontopolitique (Dormeau, 2020b) permet de penser en partie ces enjeux relatifs à l’architecture d’un monde commun aux prémisses tronquées. En discutant les concepts d’happycratie (Cabanas et Illouz, 2018) et de psychopolitique (Han, 2014) dont l’apport permet de saisir les effets contemporains d’une biopolitique extensive, j’avais fait l’hypothèse que le mode actuel de gouvernement des conduites est un auto-gouvernement qui, sous couvert d’une émancipation par un auto-contrôle bienveillant, permet en réalité la préemption de tout ce qui fait une vie humaine. Et la multiplication de cette forme de rapport à soi auto-aliénante doit être pensée comme un point d’aboutissement des démocraties horizontales, « où il n’est nul besoin de gouvernement, d’un pouvoir vertical, pour que s’organise de façon immanente un auto-contrôle généralisé de la population issu à la source de pratiques individuelles largement répandues et mimétiques » (Dormeau, 2020b, p. 141). Car si nous avons l’illusion de coconstruire un nouveau prototype de vie collective, plus centrée sur les interrelations, davantage connectée au vivant et à l’écoute des fragilités individuelles, un très faible pourcentage de la population détient pourtant la maîtrise du prototypage.
Si les éléments du discours autour de la résilience ont à ce point su séduire un si large public, c’est bien parce qu’ils s’accordent harmonieusement aux exigences économiques d’un capitalisme néolibéral abreuvé en continu par la marchandisation de nos existences et l’expression de nos affects intimes. Sociologiquement, c’est une pratique qui s’allie parfaitement au projet social contemporain percevant la vie, non plus comme un cycle froid et convenu où tout est prévu à l’avance, mais comme une exploration sans limites de tous les possibles qui s’offrent à nous, surtout ceux que nous n’aurions pas imaginé. La cristallisation normative opère donc à ce point de contact ; lorsque la somme des pratiques individuelles de résilience et leur expression sont largement soutenues et portées par une idéologie politique, un système économique et un projet de société. Dans ce fonctionnement, la production testimoniale du sujet résilient devient alors un réservoir d’alimentation quasiment inépuisable, et à double titre. D’une part, car si le processus de résilience est pensé comme la recherche de ressources internes qu’il convient de trouver ; alors oui, il est fort probable que cela puisse nous occuper au moins une vie — nous détournant ainsi potentiellement des luttes pour l’émancipation collective. D’autre part, car la capitalisation économique, sociale et culturelle de cette recherche permet au sujet de s’enrichir, aux dominants d’asseoir leur autorité, et aux normes structurant la société de se renforcer, légitimant et pérennisant ainsi leur existence.
Survivre au désastre et anticiper la menace
A partir d’une analyse pointue du traitement politique de la catastrophe nucléaire de Fukushima, le chercheur en sciences sociales Thierry Ribault (2021) interroge la résilience comme posture solutionniste simultanément idéologie de l’adaptation et technologie du consentement à la réalité existante. Dans son dernier ouvrage, il cite le livre blanc sur la science et la technologie paru en 2012 à la demande du gouvernement japonais et intitulé « Vers une société robuste et résiliente », dont je restitue ici un extrait m’ayant vivement interpellé :
Nous devons renforcer le développement d’une société robuste et résiliente capable d’entretenir les rêves et les espoirs du peuple. […] La résilience d’une communauté est son aptitude à continuer à vivre, travailler, croître et se développer après un traumatisme ou un désastre. Une communauté résiliente est un groupe de gens organisé et structuré afin de s’adapter rapidement au changement, de dépasser le traumatisme, tout en maintenant sa cohésion. (METX, 2012)
De façon édifiante et parce que l’enjeu était de taille, le livre blanc du gouvernement japonais trace les lignes de force de ce que doit être une société, prête non pas à éviter le désastre mais bien à recevoir les chocs, et surtout y consentir pleinement dans l’intérêt général. La journaliste Naomi Klein et ses collègues (2008) avait déjà largement travaillé ce motif de la stratégie du choc, désignant en premier lieu le 11 septembre comme « choc utile » permettant l’instauration et le maintien d’un capitalisme du désastre aux États-Unis, et justifiant ainsi les guerres en Afghanistan puis en Irak. Plus proche de moi mais avec le même point de départ (le 11 septembre), le philosophe canadien Brian Massumi (Massumi, 2021) analyse les logiques politiques et médiatiques de la guerre contre le terrorisme17 comme un ontopouvoir préempteur. Avec une précision remarquable, Massumi définit ce qu’il nomme le double conditionnel de la menace et de la peur comme l’une des méthodes préemptives utilisée par l’administration Bush dans la guerre contre le terrorisme. Ce double conditionnel repose sur une proposition duale ; il faudrait craindre une menace qui n’est pas encore advenue mais peut surgir à tout instant. Ainsi, l’existence quotidienne n’est plus tournée vers un danger clair et identifié à un instant T, mais régie par une menace incertaine aux contours indistincts, dont il faudrait pourtant savoir se protéger. C’est en substance les messages diffusés en continu par la Maison-Blanche et relayés par les médias états-uniens entre 2002 et 2011 dans le cadre de la mise en place d’un système d’alerte à la menace codé par couleurs. Projetés dans les espaces publics (aéroports, gares, panneaux extérieurs, etc.) et sur les chaînes du câble, les citoyen·nes ont pu suivre en temps réel le degré de menace potentielle, passant du vert au rouge selon la proximité estimée du danger. En clair, le cadre émotionnel initié par l’ontopolitique18 américaine impose de vivre dans la peur présente d’une menace passée, que l’on envisage prête à se reproduire dans l’imminence. Mais l’imminence ne se produisant pas, la peur de la menace devient alors un état pérenne, alimenté constamment par l’idée que « le danger ne [s’étant] pas présenté prouve que la menace est toujours là » (Massumi, 2021, p. 392). Pour reprendre une terminologie issue de la psychologie, nous pourrions qualifier ce cadre comme prescriptif d’un état permanent d’hypervigilance. Dès qu’un stimuli perçu comme menaçant vient nous affecter, il réactive la possibilité même de cette menace, et la peur qui l’accompagne. La démonstration implacable de l’existence de la menace, ce serait la sensation de danger si sensiblement réactivée à chaque frôlement, permettant ainsi à la peur de s’inscrire durablement en nous, s’auto-générant à l’infini.
Cette internalisation d’une menace extérieure, qui correspond en réalité à un partitionnement des responsabilités de l’État en chacun·e, permet l’objectivation de la catastrophe comme une anankè19 ; cette nécessité tragique à laquelle on ne peut se soustraire voire, comme le précise Ribault (2021), « qui finit par passer pour indispensable, amenant chacun·e à faire l’impasse sur ce à quoi il [ou elle] est contraint·e de se soumettre pour essayer d’y répondre » (p. 79). Le résultat principal de ce processus de soumission intériorisée, c’est une forme d’insensibilisation individuelle et collective aux drames vécus. S’ils sont identifiés comme étant tragiques et pourvoyeurs de souffrance, ils ne sont en revanche plus pensés qu’en termes de dépassement, d’inter-fragilités collectives transmuées en force ou, pour reprendre un nouveau mantra entrepreneurial, abordés avec un mindset antifragile20. De façon assez similaire au schéma suivi par les narrateur·ices de la résilience que j’ai examiné en amont, je constate qu’ici encore, la seule façon acceptable d’atténuer et dépasser le spectre de la peur, c’est la gestion émotionnelle de soi par soi, même lorsque celle-ci prend les traits d’un mot d’ordre collectif.
Échapper au pouvoir, s’échapper de soi
Naviguant dans les interstices d’environnements complexes, le présent article, s’il est enquête exploratoire, constitue également par certains aspects une sorte d’expérience de pensée. A ce titre, je m’autorise chaque piste ou mouvement me permettant d’approfondir mes intuitions. J’ai bien conscience que les exemples que je convoque ne peuvent s’analyser avec la même grille de lecture ni la même considération, l’objectif n’étant nullement une étude comparative. Ce que j’explore, c’est comment ces différents éléments permettent, à des niveaux très distincts, de rendre compte de plusieurs façons de produire un cadrage normatif des expériences émotionnelles, de leurs déviances et du traitement de celles-ci. Précisément car chaque dispositif s’élabore dans un contexte politique et culturel bien particulier, ce qu’il est intéressant de relever ce sont les lieux communs, les moments où la façon d’exercer le pouvoir et de (re)produire de la domination va s’exprimer avec plus ou moins de coercition et/ou de consentement, ou sous des formes nouvelles. Ce que j’ai voulu souligner, c’est la protéiformité des nouveaux modes de gouvernementalité de soi et des autres (Foucault, 2017), l’hybridation symbiotique qui s’est opérée entre les techniques de pouvoir et de domination, et les modes d’action qu’un individu opère sur ellui-même dans une forme d’auto-aliénation consentie. Car c’est en prenant en charge de nous-même et par nous-même, une discipline de soi sensément émancipatrice, que nous permettons aux gouvernements centralisés de s’assurer l’obéissance des citoyen.nes sans faire appel à des mesures frontalement coercitives (Dormeau, 2020b). La dialectique coercition-consentement (que l’on retrouve chez Gramsci sous la notion d’hégémonie, comme modalité propre à l’exercice du pouvoir), est désormais reproduite en soi et intériorisée comme tension individuelle et constitutive. En outre, ce que nous indiquent les opérateur·ices et relais de la rationalité néolibérale, c’est qu’un processus de résilience docilement mené et rigoureusement maîtrisé permet non seulement l’apaisement de ces conflits — prétendument — internes, mais promet surtout une consolidation des fondations narcissiques et affectives nous permettant d’affronter plus sereinement l’avenir.
Les différents exemples mobilisés me semblent intéressants en ce qu’ils permettent une lecture multiscalaire : la définition de la communauté résiliente produite par les ingénieurs japonais se figurant, en écho, comme le passage à l’échelle de la communauté de résilient·es ayant transcendé individuellement leur existence. Et la ligne de convergence de ces différentes échelles — qui est en réalité une ligne de transformation — trace dans son sillon une cartographie éclairante : elle nous indique en quels endroits a lieu le transfert des responsabilités politiques vers un empuissancement individuel. Ce qui se dessine, ce sont les contours du seul espace possiblement gouvernable en temps de crise, au sein duquel une réponse psychologique issue du champ de la perception et de la représentation subjective vient se substituer à une analyse systémique des causalités. Ce qui permet d’identifier ce processus de transformation en un lieu commun est par ailleurs ce qui le rend le plus difficile à saisir. Car il repose sur le même travail de réécriture, le scénario principal ayant comme socle narratif la nécessité de rester tourné·es vers l’avenir en dépit de nos conditions actuelles d’existence, quelles qu’elles soient. Il faut se relever, s’adapter, se développer, dépasser les traumatismes et faire front ensemble. Maintenir la cohésion contre les catastrophes éventuelles, la menace potentielle, contre soi-même et contre les résistant·es de divers ordres. Or, et je l’ai posé en préambule de ma démonstration, l’existence subalterne est en partie une existence résistante, couplée à des liens ténus de subordination au groupe dominant. Exclu·es de la sphère du discours et de la représentation, les subalternes — dont la condition même est empreinte d’une souffrance radicale — n’ont par conséquent pas accès au territoire décrit préalablement, puisque ses fondations reposent sur un cadre émotionnel ne permettant aucune narration alternative. Mais à la violence (redoublée) de l’éjection, s’agrège la faculté stratégique d’être ingouvernable, illisible voire intraduisible. C’est pourquoi, une interrogation filigranaire qui travaille ce texte pourrait être résumée ainsi : quelles sont les conditions de possibilité de l’expression d’une souffrance hors-norme en dehors du trope du traumatisme et de son dépassement ? Par extension, et ce thème m’est central, l’enjeu porte inexorablement sur la constante précarité de nos modes de vie, où la sécurité ne peut s’acquérir ponctuellement que sur la brèche, en équilibre sur la norme et ses contradictions, à la frontière de nous-même.
Conclusion : vivre ensemble ou exister autrement
Étymologiquement, résilience et résistance s’opposent ; le premier rendant compte d’une forme de souplesse, d’élasticité propre à l’adaptation, alors que le second renvoie à l’opposition même, dans une absolue fermeté. J’aurais pu commencer par là mais c’eût été trop simple, et j’aime à croire que ce grand détour en valait la peine. Il me paraissait vraiment important de pouvoir retranscrire puis poursuivre les questionnements qui m’ont traversé à partir de la publication de mon texte sur psychiatrisation et subalternité. Car il me semble que les différents exemples mobilisés permettent de mieux comprendre quelle superstructure entoure tant ma prise de parole que celle des promoteur·ices de la résilience, et quels récits en seront à jamais exclus. Que mon interrogation sur les conditions de l’audibilité subalterne et les enjeux de sa réception, parce qu’elle rejoint inévitablement une politique gestionnaire des affects et une réflexion complexe sur la coercition et le consentement (en nous et hors de nous), se devait d’être formulée simultanément à différentes échelles. Mon point de départ a été de tenter de démêler et rendre visible les apories du récit de soi subalterne, tant dans ses modalités d’énonciation que dans la forme de sa réception. Convoquer les travaux de Cyrulnik n’avait pas pour objectif de renvoyer dos à dos le sujet de la résilience et le sujet de la résistance, mais au contraire de mettre en lumière la façon dont ces deux narrations (se raconter et se situer) peuvent exactement huiler les rouages d’une même mécanique. Ce qui m’importe, c’est d’essayer de comprendre comment le thème de l’altérité est à ce point devenu cardinal, alors même que la réalité de la différence radicale, l’expression d’une existence Autre est toujours perçue comme un affront direct à l’ordre dominant.
À ce titre, l’injonction à la résilience individuelle, politique et sociale confère une nouvelle teinte aux projets civilisationnels contemporains qui, en agitant le spectre de la menace constante, permettent le renouveau d’une narration univoque et homogène d’un monde que l’on dit désirer collectivement. Le souhait de cohésion communautaire du livre blanc japonais, cette société robuste et résiliente capable d’entretenir les rêves et les espoirs du peuple n’est possible que dès lors que chacun·e d’entre nous prend sa part, travaille sur soi, n’exprime qu’une identité lisible et tolérable, sous peine de fragiliser nos possibilités d’adaptation collective en cas de choc. L’expression visible et frontale des différences ne peut alors être qu’une mutinerie ; car qui d’autre qu’un·e ennemi·e pourrait mettre à mal la construction d’un monde meilleur ?
Conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêt déclaré.