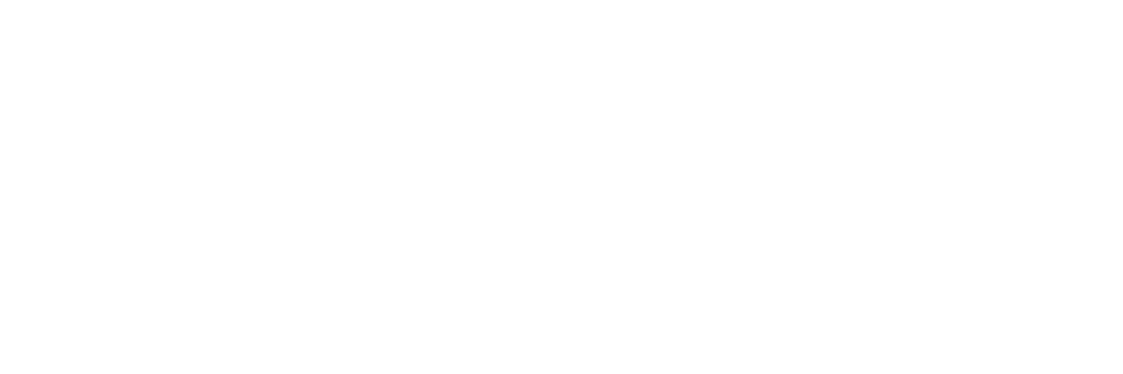Solveig Lelaurain : Pouvez-vous vous présenter l’une et l’autre dans un premier temps ?
Sylvie Dalnoky : Je suis une psychologue clinicienne interculturelle et je réalise des consultations thérapeutiques dans un cabinet partagé avec d’autres membres de l’ASQF. J’accueille principalement des personnes minorisées en raison de leur genre et/ou qui ont subi des discriminations, des violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales. Par ailleurs j’anime des groupes d’analyse de pratiques, surtout dans le milieu associatif, et j’effectue aussi des supervisions auprès de professionnel·les du champ médico-social. Actuellement, c’est une partie de mon activité qui se développe pas mal. Je fais des supervisions individuelles pour défendre, développer et faire connaître ce que nous appelons à l’ASQF les « pratiques situées de psychologues ». En tant que psychologue, je trouve que c’est important de soutenir ces pratiques dans notre profession, mais aussi dans le travail social ou dans celui des soignants et soignantes. C’est aussi dans ce cadre que je forme les professionnel·les aux questions de discrimination à partir d’une approche intersectionnelle. Ces pratiques et ces supervisions sont très liées à nos activités militantes, et notamment à la création de l’ancêtre archaïque de la liste psy* situé·es, en 2013, qui est aujourd’hui hébergée par l’ASQF, association que j’ai cofondée avec Yoram en 2019. C’est une liste que j’ai créée il y a plus d’une dizaine d’années pour répondre à la demande écrasante de thérapeutes féministes qui ont le souci de prendre en compte les discriminations systémiques.
Yoram Krakowski : Pour ma part, je suis psychologue clinicien et docteur en psychologie du développement. Mon activité clinique porte principalement sur la prise en charge des violences sexuelles, sexistes et de genre. Je suis aussi formateur sur ces enjeux-là, notamment au conseil départemental de la Haute-Garonne ainsi que dans des associations féministes. Dans ce cadre, je forme notamment des bénévoles et des militant·es à l’écoute des récits de violence pour leur permettre d’animer des permanences. Il s’agit de quelque chose que j’aime beaucoup faire et qui est important pour moi. Enfin, mon histoire est également marquée par le militantisme trans et antiraciste. J’ai participé à créer plusieurs collectifs sur les questions trans et j’ai milité dans plusieurs groupes de lutte contre l’antisémitisme, une oppression qui me concerne. Et comme l’a précisé Sylvie, j’ai aussi participé à créer l’ASQF.
Solveig Lelaurain : Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la création de l’ASQF ?
Yoram Krakowski : À l’origine, il y avait déjà un réseau informel organisé autour de cette liste des psy* situé·es. Il y avait des réflexions entre nous car on commençait à se rencontrer. D’ailleur, au début, la liste s’appelait psy safe et inclusif·ves. Mais ça nous posait question. La notion d’inclusivité ne nous convenait plus, car cela signifie « inclure dans ». Alors que pour nous, la rencontre entre deux cultures doit être pensée en clinique dès la racine, et non pas pour inclure l’une dans ce qui est initialement prévu pour l’autre. Quant au terme safe, il se répandait dans les milieux féministes mais était flou, jamais défini, et de plus en plus utilisé d’une façon dépolitisée. En rejoignant Sylvie à Toulouse, j’ai proposé de partir du concept de « savoirs situés » développé par Donna Haraway (2007), qui nomme que tout savoir est situé dans le champ social et qu’il n’y a pas de connaissance « neutre ». Il existe par exemple un androcentrisme et un ethnocentrisme occidental dans la recherche qui produisent des concepts et données scientifiques se croyant universels alors qu’ils sont biaisés. L’idée a été d’appliquer ce concept, plus clair et plus précis, à la clinique en psychologie. Certes le nom Psys situé·es prenant en compte les oppressions systémiques est super long, mais au moins il est politique et précis ! Au bout d’un moment, on a ressenti le besoin de visibiliser et d’institutionnaliser davantage ce qu’on était en train de faire. D’où la création de l’association. L’équipe était initialement composée de Sylvie, de moi et de deux soignants médicaux. Nous étions parti·es dans l’optique d’ouvrir des maisons de santé, mais l’arrivée du COVID-19 a bouleversé nos projets. Les soignants médicaux, qui étaient très débordés pendant cette période sanitaire, se sont éloignés parce qu’ils n’avaient plus les mêmes attentes que nous. C’est à ce moment-là qu’on s’est dit qu’il serait peut-être mieux de travailler avec des soignant·es provenant des sciences humaines et sociales, ce qui nous a par la suite amené à collaborer majoritairement avec des psychologues pour nous centrer plus spécifiquement sur les questions de santé mentale.
Sylvie Dalnoky : J’étais justement en train de réfléchir au fait d’avoir recentré l’association sur la question du champ social des sciences humaines en général. C’est quelque chose qui est très en lien avec notre pratique professionnelle car on se rend compte qu’au final notre pratique de psychologue est fortement inscrite dans le champ social et du travail social — même si on sait qu’on parle en tant que psychologue. On reçoit des personnes qui sont tellement exclues du soin, exclues du droit, qu’on a nécessairement, en tant que psychologue, une connexion forte avec la question du champ social et de ce qu’il produit sur nos patients et patientes. Finalement, nos relations avec les médecins sont assez différentes des relations qu’on peut avoir avec les travailleurs et travailleuses sociales et donc de la question sociale en générale. Il y a en effet une spécificité dans les relations avec les médecins, qui est à mon avis due au « flou » dans lequel se situe la pratique de la psychologie. La psychologie est une discipline que j’aime à penser comme avant tout anthropologique, mais également comme une pratique proposant du soin et une amélioration de la santé. Elle est donc une science humaine, enseignée dans les facultés de science humaine à l’université, mais en même temps les psychologues sont inscrit·es à l’ARS. Ce ne sont pas des médicaux ou des auxiliaires médicaux, mais ils et elles font partie des offres de soins en santé. En outre, les médecins ont une culture très hiérarchisée, entre elleux selon les disciplines, mais également avec les autres professionnels. Ils et elles ont tendance à penser que les psychologues sont « pris » dans ces hiérarchies médicales, ce qui n’est pourtant pas le cas. Et dans ce fantasme de notre inclusion dans la hiérarchie médicale, les médecins peuvent se penser comme prescripteurs et décisionnaires sur nos pratiques. Il est donc bien souvent très difficile de mettre en place une véritable collaboration horizontale dans laquelle chacun·e pourrait avoir son rôle, ses compétences et ses missions propres.
Solveig Lelaurain : Vous nous avez parlé du contexte de création de l’ASQF. Pouvez-vous nous parler du fonctionnement de cette association aujourd’hui ? Et quels types d’activité pratiquez-vous ?
Sylvie Dalnoky : Yoram l’a évoqué tout à l’heure, mais l’ASQF a été créée administrativement dans un contexte où l’on faisait déjà ce que l’on fait aujourd’hui dans l’association. C’est un peu particulier : on n’est pas dans le cas de figure où des personnes créent une association pour commencer une activité et monter quelque chose de toute pièce. Dans notre cas, la liste psy* situé·es existait avant l’association, même si ce n’était pas un dispositif aussi travaillé que maintenant. C’était même presque un peu naïf, mais cela avait au moins le mérite d’exister. Par ailleurs, nos activités libérales de psychothérapeutes et de formateur·ices existaient déjà. On s’est retrouvé·es dans une situation où, très vite, l’association devait voir le jour pour avoir un soutien administratif et pour pouvoir s’engager dans des demandes de subvention pour certains projets. Cela n’a pas été très simple parce qu’au départ, on avait énormément de travail. Il fallait faire de la gestion administrative et de la comptabilité alors qu’on avait déjà une pleine activité de psychologue à côté. Il y a aussi des personnes qui s’étaient engagées et puis qui, finalement, n’ont pas intégré l’association (Yoram évoquait par exemple les personnes médicales qui n’ont pas suivi l’aventure). Au début, on a un peu balbutié sur le temps collectif nécessaire au fonctionnement de l’association. Même si l’idéal serait que l’on puisse travailler toute la semaine pour l’association, on est dans un rythme satisfaisant : une journée de réunion pour l’association, le mardi tous les quinze jours. Pour le moment, c’est ce qu’on a trouvé de mieux comme équilibre entre continuer nos activités qui nous assurent un revenu et consacrer le temps nécessaire à l’association.
Yoram Krakowski : Je rajouterais qu’on a fait évoluer la gouvernance de l’association pour qu’elle corresponde davantage à notre féminisme intersectionnel. On a dès le début en 2019 choisi une structuration avec un conseil d’animation (CA) autogéré et horizontal. Tous les membres du conseil d’animation ont ainsi le même pouvoir politique ; nous n’avons pas de président, de secrétaires ou de trésorier. Nous pouvons être soutenu·es par des membres actif·ves qui ne sont pas au CA pour certains projets, c’est le cas pour la gestion de la liste psy* situé·es. Mais au début de l’association, nous avions différentes commissions, comme par exemple la « commission trans ». Mais après pas mal de réflexions, on s’est dit que cela ne faisait pas forcément sens de faire des commissions non-mixtes autour de questions identitaires en tant que féministes intersectionnel·les. En fait, le militantisme féministe et le militantisme LGBTQI ne se croisent pas toujours. C’est pour cela qu’on a envie de porter une perspective féminisme intersectionnelle parce que nous pensons que tout le monde doit s’emparer des questions trans. Aujourd’hui donc, on porte ces questions-là collectivement, même si on continue d’avoir des espaces en non-mixités, comme par exemple pour la préparation et l’animation de la formation à l’accueil des personnes trans qui sont généralement assurées par les personnes trans de l’ASQF. En revanche, tout le monde peut venir aux réunions qui concernent les droits des personnes trans. Même si on fait attention à ce que les personnes cis ne posent pas un agenda sur les questions trans sans les personnes concernées, c’est très important pour nous qu’elles s’en emparent aussi. De la même façon, on a organisé un événement important sur le racisme en octobre 2023 où l’on a mis en avant les personnes concernées par cette oppression pour animer des ateliers et être sur la table-ronde. Mais il y avait également des personnes blanches qui ont participé à l’organisation et à l’animation des événements de cette journée.
Sylvie Dalnoky : Oui, on trouve que c’est important parce que ça met en lumière notre vision très transversale des choses. Si on fait un évènement, par exemple, sur les personnes LGBT ou sur les questions queer, on va aussi prendre en compte la question des personnes queer racisées parce qu’on n’est pas tous et toutes concerné·es par les mêmes discriminations. Cela permet une attention plus accrue aux autres discriminations. Admettons que nous ayons une collègue racisée, qui n’est pas une personne queer, mais qui est présente dans un espace de réflexion sur les questions queer, elle va aider le groupe à rester vigilant aux enjeux de racisme. C’est donc en raison de notre vision transversale des rapports de domination que les commissions spécifiques sur certains types de discriminations ne faisaient plus trop sens pour nous.
Yoram Krakowski : En effet, voilà pourquoi on a un CA qui fait aujourd’hui à peu près tout. Les membres sont bénévoles sur toute la coordination, l’administratif, etc. D’où le fait que nous essayons de trouver des financements sur nos missions de psychologues. On effectue un travail bénévole conséquent, mais quand on anime une formation ou un groupe de parole, il faut qu’on soit rémunéré·e. L’idéal serait d’avoir des financements pour payer la coordination, ce qui n’est pas le cas actuellement. J’ajouterais que c’est important de dire, d’un point de vue syndicaliste, qu’on en a marre que l’on demande aux psychologues de donner du temps bénévole (ce qui nous a été demandé durant la période du COVID-19) alors qu’il s’agit de l’une des professions les plus féminines et les plus précarisées des professions dans le champ de la santé. On lutte pour revendiquer nos compétences de psychologues et le fait qu’elles méritent d’être rémunérées. Surtout qu’à l’ASQF, on a acquis une certaine expertise depuis nos savoirs situés, militants et cliniques.
Sylvie Dalnoky : Je me permets de rebondir sur la question de la défense de la profession qui, au-delà de l’enjeu syndicaliste soulevé par Yoram, est en ce moment particulièrement attaquée. On tient toujours à rappeler que « psychologue », c’est un métier. On est des travailleurs et des travailleuses, il n’y a pas de raisons que nos activités professionnelles passent principalement par du bénévolat.
Solveig Lelaurain : Puisque vous venez d’en parler, pouvez-vous en dire un peu plus sur vos sources de financement ?
Yoram Krakowski : On rémunère des intervenants et des intervenantes pour différentes activités telles que les groupes d’analyses de pratique, les supervisions et les formations. Mais les bénéfices de ces activités reviennent à l’association. C’est ce fonctionnement qui nous a permis jusqu’à présent de mettre en place des groupes de parole à destination des personnes précaires qui n’avaient pas les moyens de nous rémunérer. Aujourd’hui, on commence à demander des subventions publiques pour ces groupes de paroles, bien qu’elles soient assez modestes. Par exemple, on a un financement de la Mairie de Toulouse et un autre de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT. On projette d’avoir cette année un financement du département de la Haute-Garonne et de l’ARS. Dans l’idéal, on aimerait pour l’année 2024 être financé pour moitié par les bénéfices de nos formations, et pour moitié par l’argent public que nous recevons.
Sylvie Dalnoky : C’est politiquement important pour nous d’avoir ces financements, parce que cela vient rappeler que nos activités professionnelles relèvent du service public. Je trouve que c’est d’autant plus central que la question des financements publics est souvent appréhendée avec méfiance par les milieux militants dans le sens où il y a toujours un risque de devoir rendre des comptes aux institutions qui nous financent. Mais à l’ASQF, on défend l’idée qu’il est tout à fait normal d’utiliser l’argent public pour des activités de service public.
Sophie N’Diaye : Si nous comprenons bien, il n’y a pas de salarié·es à l’ASQF ?
Yoram Krakowski : Non, on en est loin. Je pense que pendant les deux prochaines années on va surtout essayer de faire financer nos groupes de paroles, mais les financeur·euses ne donnent quasiment plus de subventions pour frais de fonctionnement — c’est-à-dire tout ce qui est fonction-support, par exemple le travail administratif. Comme on l’a dit tout à l’heure, nous avons une réunion deux mardis par mois où les sept membres du CA se réunissent pour effectuer le travail administratif, même si ce temps collectif ne nous permet de réaliser que la moitié de ce travail. Il faut compter entre 7 et 14 heures par semaine de travail administratif par personne dans l’association. On a donc quasiment l’équivalent de deux temps pleins en administratif et en recherche de subventions, ce qui représente une charge de travail très conséquente. En outre, la façon dont on pense nos budgets est quelque chose d’important pour nous. Agnès Dantagnan, qui a une expertise en comptabilité associative, nous a beaucoup aidé·es à ce niveau-là. À chaque fois qu’on établit un budget, on chiffre les contributions volontaires, c’est-à-dire nos contributions réalisées à titre bénévole. Par exemple, si pour un projet nous avons 150 heures de bénévolat à 30 euros de l’heure, nous le chiffrons pour montrer aux financeur·euses publics qu’ils nous donnent très peu par rapport à la somme d’argent que représente le travail que nous réalisons gratuitement.
Sylvie Dalnoky : Et c’est aussi une chose qui permet de montrer aux institutions que leurs financements ne couvrent finalement que 5 % du temps de travail gratuit que nous réalisons. Cela permet de remettre les choses à l’endroit et de ne pas se laisser leurrer par la question des financements publics et des aides de la municipalité ou d’autres institutions qui pourraient surestimer l’importance de l’aide qu’elles nous apportent.
Solveig Lelaurain : Tout à l’heure vous avez parlé de savoirs situés, militants et cliniques. Nous aimerions vous entendre sur l’articulation entre ces différents éléments et sur la façon dont elle se manifeste au sein de votre pratique clinique.
Yoram Krakowski : C’est vrai que souvent on parle de savoirs expérientiels, cliniques et théoriques. On parle aussi de savoirs issus de la sociologie, du militantisme et de la psychologie. Pour nous c’est important de mettre en avant ces différentes formes de savoir. Si on parle de savoirs expérientiels, c’est parce qu’on est nous-mêmes des personnes minorisées au sein de l’ASQF, c’est-à-dire concerné·es par différents types d’oppression. Autrement dit, on a tous·tes des savoirs expérientiels en fonction de notre position dans le champ social. Souvent, il y a des professionnel·les qui sont surtout porté·es par des savoirs théoriques — par exemple sur les questions queer — et qui ont prétention à mieux connaître notre situation que nous-mêmes. Pour notre part, nous revendiquons que les personnes concernées produisent une véritable expertise sur leur situation et que nous devons nous appuyer sur ces savoirs. Par ailleurs, on accorde une place importante aux savoirs militants. Me concernant, si je connais autant de choses sur les questions de violences et de harcèlements sexistes et sexuels, ce n’est certainement pas grâce à la fac de psychologie ! C’est par mon militantisme que je suis allé chercher les informations sur le sujet et que je me suis battu pour savoir comment soutenir les personnes qui vivaient ces violences. Comme je l’ai dit, on puise aussi dans des savoirs issus de la sociologie. C’est vrai qu’on a souvent tendance à opposer psychologie et sociologie. Nous on prend parti de dire que ce sont des disciplines absolument complémentaires. On en a un peu marre des psychologues qui ne voient pas le champ social et des sociologues qui nient les enjeux psychologiques. Ce qui nous semble important, c’est de lier ces deux disciplines. Mais la prise en compte de tous ces savoirs (expérientiels, militants, disciplinaires) ne nous empêche pas de revendiquer le fait que nous sommes des professionnel·les et que nous portons des savoirs cliniques et théoriques issus de l’université et de nos pratiques d’accompagnement.
Sylvie Dalnoky : Au-delà de la question des savoirs situés, j’ai envie d’aborder la notion d’expertise qui a été pas mal remise en question dans le milieu militant pour son côté un peu surplombant. Comme le disait Yoram, on a plein d’études sur les populations LGBT réalisées par des personnes cis-hétéra et qui vont les observer dans une espèce de microscope, comme s’il s’agissait de bêtes curieuses. Ce genre de posture est aujourd’hui contesté et c’est tant mieux. On a maintenant accès à énormément d’informations. Quand on a une pathologie, un diagnostic médical, on va chercher des informations et on développe une connaissance sur ces sujets. Donc on voit bien que la notion d’expertise a beaucoup bougé ces derniers temps. En parallèle de cela, on retrouve une hyper- expertise dans le domaine de la recherche. Si je fais une recherche en psychologie, elle va porter sur une question très pointue qui va lui faire perdre la vision d’ensemble sur le phénomène étudié. Nous à l’ASQF, on considère qu’on n’a pas le temps de développer à la fois une connaissance très pointue dans un domaine précis et une connaissance plus globale qui toucherait à plusieurs champs de savoir. Notre choix s’est porté sur une posture défendant un retour à l’anthropologie, au sens étymologique du terme, nourrie par différents champs, différents savoirs et différentes connaissances pour développer une compréhension holistique des phénomènes humains. Mais c’est une posture qui demande du temps pour se construire. Elle n’est pas non plus sans générer certains troubles pour celles et ceux qui sont extérieurs à notre association. Notre approche pluridimensionnelle de l’être humain ne va pas toujours trouver du sens dans un contexte de spécialisation qui valorise la compartimentation et sépare chaque problématique et ses solutions interventionnelles : pour ceci du travail social, pour cela de la médecine ou de la psychologie, etc. Et pour revenir à ce que disait Yoram sur les savoirs situés, je trouve que c’est important de se situer en tant que thérapeute pour éclaircir le type de dispositif que l’on propose. Les personnes qui viennent nous voir savent où nous sommes sur l’échiquier des discriminations systémiques ; elles peuvent avoir envie de nous voir, ou de ne pas nous voir, en raison d’une identité ou d’une appartenance sociale que nous aurions en commun. Il s’agit finalement de leur donner une certaine autonomie et une responsabilité en étant nous-mêmes clair·es sur notre positionnement dans le champ social.
Yoram Krakowski : Je me permets de compléter parce que je pensais à autre chose qui nous travaille en ce moment sur les savoirs situés. C’est la confusion entretenue sur ce que représente la santé communautaire. Certaines personnes disent que la santé communautaire c’est par et pour. À l’ASQF, on est pour les personnes minorisées dans le champ social par un collectif de personnes qui se posent ces questions et au sein duquel sont représentées différentes formes de discriminations. En revanche, on ne pense pas qu’une personne doive nécessairement être concernée par une discrimination pour accueillir une personne qui la vit. Par contre, cela ne doit pas nous dispenser de nous situer, c’est-à-dire de connaître la distance sociale entre soi et la personne accueillie. C’est un problème de rencontre de la culture de l’autre : par exemple, on pourrait se dire que, comme je suis trans, je reçois bien toutes les personnes trans. Mais ce n’est pas vrai ! Aujourd’hui, je rencontre des personnes trans qui ont 18 ans alors que moi j’ai 35 ans. Je n’ai donc pas la même culture qu’elles et eux, et on n’a pas vécu les mêmes choses. Même en termes musicaux, en termes de vocabulaire, on n’a pas la même culture ! Être concerné·e par une oppression n’est donc pas suffisant. C’est d’autant plus vrai si l’on pense au fait qu’il existe des personnes racisées qui ne reconnaissent pas l’existence d’une oppression raciale, simplement parce qu’elles n’ont jamais été amenées à réfléchir à des questions d’antiracisme d’un point de vue systémique et politique. Dans ce cas, une telle personne, bien qu’elle soit concernée, risque de mal accueillir la parole de personnes qui ont besoin d’adresser des questions sur le racisme. Et on peut dire la même chose pour les questions trans ou queer par exemple.
Par contre si je me situe — pour ma part je suis trans, j’ai 35 ans, je suis juif, valide et de classe moyenne — cela me permet d’être attentif à l’effet de la distance sociale qui me sépare de l’autre sur la façon dont j’accueille sa parole. Sinon, il nous semble important d’avoir un regard critique sur certaines pratiques de soins qui se sont beaucoup développées dans les milieux queer ces dernières années et que je qualifierais de sectaires. Ce sont des pratiques qui se présentent comme une alternative à la médecine, à la psychologie ou à la psychiatrie en raison des maltraitances perpétrées à l’encontre des minorités. On a donc de plus en plus de patient·es minorisé·es qui vont vers d’autres formes de soins, en allant vers les soins énergétiques ou en se faisant tirer les cartes par exemple. Cela pourrait ne pas être grave si les personnes se tournaient vers ces pratiques en plus de soins plus conventionnels, pour une raison de bien-être ou de spiritualité. Mais ces pratiques sont souvent présentées comme quelque chose qui va révéler l’individu à lui-même et lui donner des clés de réponse pour soigner toutes ses souffrances.
Sylvie Dalnoky : Voire même de soigner ses traumatismes !
Yoram Krakowski : Exactement ! Là on commence à être dans une pratique d’empriseur communautaire1. Il y a beaucoup de personnes queer qui se tournent vers ce type de soins, ce qui est très interpellant pour nous. C’est bien pour cela que nous revendiquons une démarche intersectionnelle et située qui intègre le fait que nous sommes aussi des professionnel·les de santé. C’est essentiel pour nous de revendiquer cette identité professionnelle parce qu’on constate que de plus en plus de patient·es se détournent des soins dont iels auraient besoin.
Sylvie Dalnoky : Il faut souligner que toutes ces pratiques ont explosé pendant la COVID-19 et qu’elles sont depuis restées très présentes dans l’offre de soins. Et puis, comme l’a dit Yoram, la maltraitance du monde médical explique le succès de ces pratiques alternatives auprès des personnes qui subissent des discriminations. Or, nous défendons à l’ASQF que ces personnes méritent les soins de soignant·es et de thérapeutes qui ont reçu une formation académique et sanctionnée par un diplôme reconnu. Les lieux de soins conventionnels (dans lesquels on peut rencontrer des psychologues, des travailleuses sociales ou des médecins) doivent pouvoir être accessibles à tout le monde, ce qui n’empêche aucunement de défendre à côté des pratiques culturelles plus communautaires pour répondre à des besoins spécifiques.
Sophie N’Diaye : Nous vous proposons de revenir sur cette question du point de vue anthropologique que vous avez évoqué. C’est quelque chose que vous avez manifestement envie de défendre. Très concrètement, comment faites-vous pour essayer de vous maintenir hors d’une trop grande spécialisation qui ferait obstacle à une vue d’ensemble ?
Yoram Krakowski : J’ai l’impression que c’est justement l’avantage du monde associatif sur le monde universitaire. Pour ma part, je viens de l’université qui valorise l’hyper spécialisation que ce soit pour la formation académique ou la recherche scientifique. À l’université, on a un public culturellement bien plus homogène et resserré sur lui-même. Mais une association comme l’ASQF, on brasse pleins de savoirs en lien avec des publics issus de milieux culturels très diversifiés que l’on accompagne dans la prise en charge ou dans la formation professionnelle. Au sein de notre équipe, même si on se retrouve sur l’enjeu du féminisme, on a des membres qui ont des formations très différentes et qui sont issu·es de milieux très différents. C’est ce qui fait que cela nous ouvre davantage d’opportunités et de possibilités pour agir. L’ASQF est également très ancrée dans les réseaux militants qui, à l’inverse des réseaux universitaires et de leurs problématisations très spécifiques, permettent de mettre en sens les enjeux rencontrés par les personnes minorisées en les politisant dans une perspective plus globale. Par exemple, les mouvements sociaux de ces dernières années et auxquels nous prenons part à Toulouse nous conduisent à réfléchir à ce que sont le capitalisme, le racisme d’État ou les violences policières. Cela incite forcément à brasser des tas de disciplines différentes. Un de nos projets à l’ASQF serait de bâtir des formes de recherches indépendantes de l’université mais qu’on réussirait à légitimer dans les espaces universitaires.
Sylvie Dalnoky : Je voudrais rebondir sur nos pratiques professionnelles. Yoram et moi, nous avons fait des groupes d’analyse de pratiques ; et je fais personnellement beaucoup de supervisions. Ce sont des pratiques qui nous mettent en contact avec d’autres disciplines et d’autres pratiques professionnelles (par exemple dans champ de l’orthophonie, du travail social ou des sciences infirmières). Ces rencontres nous mettent en lien avec une diversité de terrains et de savoirs théoriques. Si je travaille avec un·e professionnel·le spécifique, mon travail n’est pas juste de les écouter en faisant « hmm hmm… », mais de comprendre son terrain d’exercice, la façon dont il évolue, les enjeux institutionnels qui le traversent et les spécificités de son public. Ce sont toutes ces choses qui renvoient à ce qu’on a appelé le « point de vue anthropologique ».
Yoram Krakowski : Cette diversité de savoirs et de terrains qu’on revendique, je pense qu’elle est aussi alimentée par notre pratique clinique. Dans la clinique, on fait face à des patients et patientes qui ont des difficultés diverses et variées et pour lesquelles la psychologie n’a pas toujours de réponses à apporter. Par exemple, concernant la mort ou les grandes questions existentielles, on est obligé de recourir à différentes sciences humaines et sociales pour appréhender l’être humain dans toute la complexité de ses ressentis.
Sylvie Dalnoky : Mais complètement ! Par exemple, ça nous est déjà tous et toutes arrivé·es en tant que psychothérapeutes d’accueillir une personne racisée ou une femme qui nous a été envoyée par un professionnel de santé parce que les troubles du sommeil ou les douleurs dont elle se plaint auraient une étiologie psychologique et non somatique. Or, on sait bien que le racisme et le sexisme dans le monde médical peuvent conduire à ne pas prendre au sérieux ce genre de plainte lorsqu’il émane de personnes concernées par ces discriminations. Cela nous permet notamment de conseiller à ces personnes d’aller voir un·e autre professionnel·le de santé. J’ai un autre exemple en tête : beaucoup d’entre nous reçoivent en consultation des personnes qui se plaignent de douleurs de règles insupportables depuis des années et qui réussissent à obtenir un diagnostic d’endométriose parce qu’on a insisté auprès des médecins pour qu’iels les écoutent et prennent en considération leurs symptômes. Plus globalement, il est important à nos yeux d’avoir un regard sur de tels enjeux somatiques et corporels parce qu’ils sont recouverts par des enjeux sociaux plus larges liés aux rapports de domination. C’est ce qui nous incite, dans notre activité clinique, à sortir du psychologisme pour développer un regard à l’articulation entre le psychique et le social.
Yoram Krakowski : C’est la même chose avec l’accompagnement des publics précaires, qui nécessite un minimum de connaissances administratives et sociales.
Sylvie Dalnoky : Absolument !
Yoram Krakowski : Pour ma part, je suis assez choqué d’avoir régulièrement des psychiatres au téléphone qui ne savent pas faire une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ou d’autres démarches de ce type pour que leurs patient·es bénéficient de certains droits sociaux. Encore une fois, il ne s’agit pas de se substituer à d’autres professions, mais de pouvoir détecter certaines difficultés pour encourager les patient·es à revendiquer ces aides. Parfois, on va même un peu plus loin en contactant nous-même des assistantes sociales pour avoir la certitude qu’elles acceptent d’accompagner des personnes queers. J’estime à un tiers le nombre de mes patient·es qui bénéficient de l’AAH alors qu’aucun·e ne l’avait avant de venir me voir. Ce sont généralement des personnes qui étaient au RSA et qui ne pouvaient pas bosser depuis des années pour des questions de santé mentale. J’ai des collègues qui ne prennent pas du tout en compte les questions sociales de leurs patient·es précaires, mais si on ne les accompagne pas dans ces démarches, qui va le faire ? On défend de ce fait une posture clinique impliquée et proactive par opposition à une conception de la clinique classiquement basée sur la neutralité et la distance — conception qui nous semble impossible et non souhaitable avec des personnes minorisées. Bien sûr, il faut trouver la juste implication pour que cela ne nous déborde pas émotionnellement. Nous devons faire attention aux risques d’épuisement professionnel et compassionnel que cela peut engendrer pour nous.
Sylvie Dalnoky : Ce sont toutes ces choses qui constituent la vision anthropologique de nos accompagnements à l’ASQF.
Sophie N’Diaye : Lorsque vous vous situez, j’imagine que cela passe par une présentation de la place depuis laquelle vous parlez. Comment cela se passe-t-il concrètement, par exemple quand vous faites des formations dans des cultures qui ne sont pas habituées à ce type de présentation ? Comment l’audience réagit-elle en général ?
Yoram Krakowski : Même si on pense qu’il est important de se situer, je me permets de ne pas toujours le faire car il y a des questions de protection. Mais ce n’est pas sans difficulté. Je pense par exemple au fait que j’ai un passing social depuis bientôt deux ans. Avant je disais plus facilement que je suis une personne trans et je devais le revendiquer pour être genré correctement et me faire mieux comprendre dans les milieux mainstream. Aujourd’hui, je ne fais pas toujours ces précisions pour des raisons de confort. Or le fait qu’on prenne pour un mec cis produit parfois des effets assez étranges et malaisants lorsque j’interviens sur des formations portant sur des questions de violences sexistes et sexuelles. Je pense par exemple à une anecdote : à un moment donné au cours de l’une de ces formations, je parlais de violences gynécologiques et j’avais oublié que je ne m’étais pas présenté comme trans ; il y a un couple de personnes qui est alors venu me voir à la fin en me disant « vous savez, pour nous les femmes, c’est vraiment très difficile de parler de ça, vous ne savez pas ce qu’on vit » alors que moi-même je fais partie des personnes concernées par la violence gynécologique. Je me suis rendu compte que ma position n’était pas évidente. Cependant, même si je me permets de ne pas toujours me situer sur tous les sujets, j’essaye toujours d’amener la question du positionnement situé — au moins en précisant que je suis militant LGBT — parce qu’elle n’est pas suffisamment représentée et que j’ai des privilèges liés à mon statut en tant que psychologue. Lorsque je peux le faire et que cela ne m’épuise pas, j’essaye de dire que je suis une personne trans parce qu’il y a une représentation très stigmatisante de ces personnes et que peu de gens se représentent un psychologue trans. Je trouve que c’est important de leur montrer que c’est quelque chose qui existe.
Sinon, toujours par rapport au fait de se situer, je fais souvent un exercice qui s’appelle « la ligne des privilèges2 » dans les formations où je me retrouve face à un public éloigné des pratiques et des cultures militantes. Cet exercice, qui permet de situer ses propres privilèges par rapport aux autres membres du groupe, peut tout aussi bien générer des réactions positives que négatives. Toujours est-il que les dernières fois où je l’ai pratiqué, les personnes ont été très réceptives — c’est même un des aspects qui les ont le plus marqué dans leur formation. Plus globalement, je pense que promouvoir les savoirs situés avec de l’éducation populaire permet aux personnes de comprendre par elles-mêmes l’importance de se situer et la signification que cela peut avoir. Et effectivement, lorsqu’on amène un groupe de personnes blanches et hétérosexuelles qui sont dans le travail social, elles se rendent compte que des collègues avec qui elles pensaient partager les mêmes conditions d’existence se retrouvent loin derrière elles sur la ligne des privilèges car elles sont concernées par plusieurs oppressions. En faire l’expérience leur fait prendre conscience de leur position privilégiée. Cette question de l’expérientiel, qui est beaucoup travaillée dans l’éducation populaire, me paraît importante dans la formation. Je dis souvent aux personnes « imaginez une situation où vous avez vécu telle ou telle chose » et nous travaillons à partir de là. Elles ne sont pas obligées de nommer ce vécu, il s’agit avant tout de les faire partir de leurs propres représentations et expériences pour les amener à se situer. Ainsi, même si l’on ne fait pas de tour de table où chaque personne est invitée à se situer, on fait en sorte que cette « situabilité » émerge et que chacune d’elle en prenne conscience au cours de la formation. Sylvie et moi-même fonctionnons à peu près de la même façon dans ce contexte : on part tout le temps du champ social vers l’intrapsychique, de la société et de ce qu’elle fait, des représentations qu’elle produit, jusqu’à conduire sur des questions plus psychologiques. Bien sûr, on attend de nous, psychologues, que l’on soit uniquement sur le versant du psychologique. À titre d’illustration, c’est ce à quoi on pourrait s’attendre lorsque je fais des formations sur le psycho-trauma. Or je fais porter plus de la moitié du contenu sur la culture du viol, parce que je pense que cela n’a pas de sens de former sur le psycho-trauma si on ne parle pas de la société et de ce qu’elle produit comme « traumatisations ».
Sylvie Dalnoky : J’allais donner le même exemple que toi, Yoram, parce que j’utilise presque tout le temps la ligne des privilèges pour inciter les personnes à se situer. Mais je dirais qu’il y a aussi une autre chose importante dans le fait de se situer, en particulier face à un public non militant et non informé sur les questions d’oppression : à l’ASQF, nous luttons beaucoup contre la croyance d’une frontière entre les personnes concernées et les professionnel·les. Il m’est déjà arrivé des discussions lunaires avec, par exemple, des gens qui me contactent en me demandant des formations sur les enjeux de transidentité et d’accueil de personnes trans. Lorsque je leur dit « écoutez, d’autres personnes de l’association peuvent le faire parce que moi je ne suis pas une personne concernée, ce n’est pas moi qui vais animer la formation », on se retrouve avec ce genre de dialogue :
— Ah, des collègues à vous avec des personnes trans ?
— Ben non, ce sont des collègues qui sont des personnes trans.
— Ah oui mais on voulait des psychologues !
— Oui, ce sont des collègues qui sont psychologues et qui sont…
J’ai vécu les mêmes échanges concernant les questions raciales :
— Ah vous allez amener des personnes racisées à vos formations ?
— Ben non, on va demander à des collègues psychologues racisé·es de faire les formations.
Cet impensé dans les représentations, qui consiste à ne pas même concevoir qu’une personne professionnelle puisse aussi appartenir à un groupe minorisé, est complètement intriqué avec le fait de ne pas se penser comme situé. En apprenant à se situer, on apprend à faire exister l’idée qu’en tant que professionnel·le — psychologue ou non — on n’est pas toujours du côté des privilèges. Cela permet de contrecarrer certaines représentations qui feraient un clivage entre le fait d’être une personne discriminée et le fait d’être une personne professionnelle.
Yoram Krakowski : Selon moi, une des raisons qui font que nos formations sont aussi appréciées, c’est qu’elles sont très politisées. Par exemple, sur la question du travail social, je fais réfléchir les travailleurs et travailleuses sociales sur leur métier, ce qu’il est en train de devenir, en quoi c’est un problème, pourquoi cela produit de la souffrance de leur côté et de la colère du côté des personnes accompagnées. Ce sont des réflexions qui leur parlent et qui leur donnent du pouvoir. Et quand on leur dit qu’il n’y a pas vraiment d’accueil neutre, cela les soulage. Qu’est-ce que ça veut dire la neutralité ? Qui est neutre ? Pourquoi ? Ce sont des sujets qui leur parlent énormément. Souvent, ces personnes vont nous dire : « mais moi mon chef, il me dit que je devrais être moins impliquée, il me dit que je devrais moins prendre les choses à coeur, etc. ». On leur demande d’être des espèces de robots sans émotion et moi je leur explique qu’ils et elles vont faire tout le contraire dans la formation. Il s’agit de travailler avec ses émotions, de voir ce dont elles sont révélatrices, à quel endroit elles s’expriment et pourquoi elles existent. Bref, essayer de comprendre ce qu’elles signifient, c’est un exercice qui est généralement vécu comme un immense soulagement.
Sylvie Dalnoky : Je plussoie tout à fait. Et par expérience, effectivement, quand on dit que la neutralité dans le champ médico-psychosocial n’existe tout simplement pas et qu’il s’agit d’une chimère, on voit un véritable soulagement du côté des professionnel·les. Ils et elles ont besoin qu’on leur dise : « vos émotions, votre non neutralité elles sont là. Donc réfléchissons ensemble à ce qu’elles nous font produire de bien. Mais parfois aussi d’un peu de merdique en raison de nos représentations stigmatisantes. Prenons ces choses-là en main, travaillons-les ensemble ! ». Je trouve que lorsqu’on propose ces réflexions en formation, les travailleurs et les travailleuses sociales sont plutôt enthousiastes.
Yoram Krakowski : Les travailleurs et travailleuses sociales ont l’habitude de se questionner sur leur posture et adorent cet exercice réflexif. Alors que dans les formations que je fais avec des psychologues ou avec des médecins, c’est plus compliqué parce qu’ils ont beaucoup plus de mal à sortir d’une posture sachante pour se questionner.
Sylvie Dalnoky : Les médecins sont du côté du savoir, ils savent ; les psychologues sont du côté de la neutralité, ils sont neutres. Ce sont là deux fantasmes.
Solveig Lelaurain : Pour finir, nous aimerions vous interroger sur les difficultés que vous pouvez rencontrer dans le cadre de vos pratiques à l’ASQF. Que pouvez-vous nous en dire ?
Yoram Krakowski : C’est une bonne chose de finir cet entretien sur les difficultés que nous rencontrons, parce qu’il y en a ! Je pense spontanément à quelque chose qui m’énerve quand on cherche des financements sur des questions queer ou LGBT, qui peuvent être très diverses, c’est que les financeurs vont toujours avoir tendance à réduire la santé communautaire aux au public HSH (hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes) avec les problématiques du VIH/SIDA ou du chemsex. Or, en tant que féministes intersectionnel·les, nous n’attirons pas ce public-là — en plus du fait, me semble-t-il, que les gays s’organisent relativement peu sur des questions de solidarité avec les femmes et les queer. Et malheureusement, la question féministe intersectionnelle est toujours considérée comme un second sujet. Il suffit de voir du côté des violences sexuelles, des violences intrafamiliales et de l’inceste, sur lesquels nous travaillons depuis des années. Nous avons peu de moyens alloués sur la Haute-Garonne alors même que l’État les présente comme des enjeux importants dans ses discours politiques. Il n’y a rien qui est proposé aux victimes en termes de structure, pas d’endroits où il est possible d’être accompagné·e si on a vécu des violences sexuelles, ni de groupe de parole si on a besoin d’en parler. Rien de tout cela n’existe. La littérature scientifique montre que les problèmes en santé mentale et en santé globale sont en grande partie liés aux violences dans l’enfance ainsi qu’aux aux violences sexuelles. Les pouvoirs publics préfèrent financer un centre spécialisé sur le chemsex alors qu’on sait très bien que les pratiques addictives et la recherche de fortes sensations dans les rapports sexuels peuvent être liés à des traumatismes. Je ne veux pas non plus généraliser, c’est plus complexe que cela, mais les problématiques d’addiction, on ne peut pas faire l’économie d’un travail sur la question des traumas faisant suite à des violences dans l’enfance qui sont souvent des violences sexuelles. On fait partie de communautés qui sont fortement touchées par ces enjeux de santé.
Plus largement, les financeurs ne comprennent pas vraiment ce que l’on fait lorsque l’on se présente comme féministes et queer. Ils prononcent « cuir » (rires) et nous disent « mais on ne comprend pas, vous êtes sur les enjeux d’égalité, sur les violences sexuelles, sur les lgbt, ou sur le racisme ? ». En fait, nous sommes sur toutes ces choses-là en même temps ! À la ville de Toulouse, il y a un·e chargé·e de mission pour les questions de racisme, un·e autre pour celles relatives à l’égalité femme-homme, etc. Et à chaque fois, ils ou elles ne savent pas dans quelle case nous mettre ni à quel interlocuteur ou interlocutrice nous adresser. L’intersectionnalité est totalement impensée. C’est là une vraie difficulté qu’on a au sein de l’ASQF pour faire comprendre nos pratiques et se faire financer.
Sylvie Dalnoky : J’ai envie de rebondir sur cet impensé-là. Quand on s’adresse à l’Agence Régionale de Santé et qu’on leur fait part de nos projets, ils nous répondent : « ah mais c’est pas tellement santé, c’est plutôt social » ; quand on demande des financements dans le champ social, on nous répond l’inverse : « ah ben quand même c’est très santé… ». Mais quand on est dans le psychologique, on est au croisement et à l’intersection de tellement de choses que c’est impossible de les cloisonner3. En outre, toujours concernant nos difficultés à l’ASQF, il y a le fait que l’université ne veuille pas de nous alors que nous revendiquons une démarche scientifique. On nous perçoit comme des personnes trop militantes et trop investies dans le terrain pour être considérés comme des partenaires de recherche. C’est un peu la même chose qu’avec le clivage entre la santé et le social : soit on est dans la recherche, soit on est sur le terrain, mais on ne peut pas faire les deux. On rencontre une difficulté à travailler avec l’université alors qu’on aurait tellement de choses à offrir et qu’on pourrait être un lieu de recherche très riche. Sur un versant plus intellectuel, je trouve que c’est vraiment dommage, parce qu’on défend une pensée et une démarche scientifiques.
Yoram Krakowski : Oui. Et il faut dire aussi que nous représentons quelque chose qui est de l’ordre d’un savoir-faire de terrain et qui fait que les gens nous apprécient tant qu’on leur sert un peu de caution. Je l’ai beaucoup ressenti dans ma carrière de psychologue trans. Pour avoir pas mal travaillé sur des questions de genre à la fac ou dans des associations féministes, je me suis rendu compte qu’il pouvait être difficile de porter certaines critiques dans ces milieux. Forcément, quand on est trans dans une formation universitaire ou dans une association où il n’y a que des personnes cis, on vient forcément à questionner des angles morts. On revient à la question du privilège, et des bénéfices tirés de l’ignorance de sa position privilégiée. Cela peut être vécu comme insupportable d’y être confronté, même chez les féministes. Tant qu’on sert de token, il n’y a pas de problème ; mais dès qu’on commence à exercer un esprit critique pour remettre en question les choses, ça ne passe plus. Du côté de l’université, cela a été très compliqué pour nous sur ces questions-là. Cela marche un peu mieux du côté associatif, mais il y des associations qui se mettent en concurrence et qui reproduisent des enjeux de pouvoir et de compétitions assez masculins alors qu’elles sont féministes. On retrouve des rapports de rivalités et un désir d’écraser les autres alors que ces rapports n’ont pas lieu d’être. En fin de compte, je pense qu’une de nos plus grandes difficultés c’est qu’on évolue dans un monde capitaliste et patriarcal. On a beau essayer de changer nos pratiques en proposant autre chose, on court toujours le risque de reproduire les rapports de domination entre nous.
Sylvie Dalnoky : Cela me semble une bonne conclusion que de rappeler que notre difficulté principale, c’est le système capitaliste patriarcal et suprémaciste !