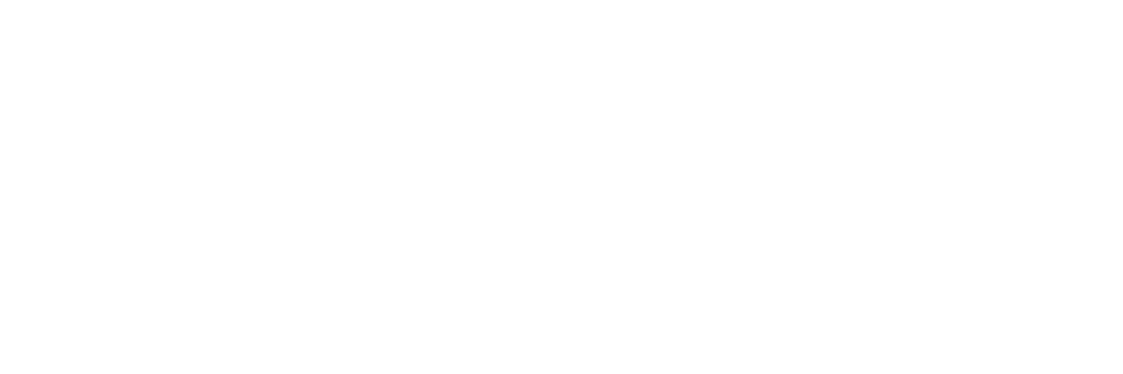Enfant, je passais des heures à sauter dans la cour après l’école ; je collectionnais les cailloux dont j’aimais la texture et la couleur ; je mâchais mes manches de pull jusqu’à les trouer ; je chantais tout le temps et répétais des mots jusqu’à leur en faire perdre leur sens, juste parce que j’aimais leur sensation dans ma bouche. Ado, j’étais passionné·e de danse et n’importe où, n’importe quand, je me balançais d’une pointe de pied à l’autre, faisais voler mes bras et vibrer mes doigts, sautais et tournais ; je passais des nuits à coudre à la main, apaisée par le mouvement répétitif ; j’ornais mes ongles de vernis colorés pour pouvoir agiter des arcs-en-ciel devant mes yeux. Mais ado, j’ai aussi glissé dans l’anorexie et la boulimie, le sport intensif et l’automutilation, et les crises où je hurlais et cassais des choses se multipliaient. Adulte, j’ai commencé à avoir l’air normale. Adulte, j’ai remplacé les gestes et comportements vus comme bizarres, puériles, provocateurs ou inquiétants par des petites choses discrètes ou des comportements normalisés. Et puis, adulte, j’ai arrêté de crier quand j’étais en crise : je me suis juste davantage fait vomir.
Alors quand j’ai découvert, passés 26 ans, que j’étais autiste1, j’ai tout exploré à nouveau : le toucher constant, les textures alimentaires, les sauts et pirouettes, les vibrations de la gorge, les pressions et les poids, les couleurs et paillettes, les activités manuelles répétitives. Ma psychologue m’a prescrit des « pauses stimming » dans mes journées. J’ai passé des heures chaque jour à échanger avec des personnes autistes sur Internet pour décortiquer notre fonctionnement et partager des conseils autour d’aménagements possibles. Et j’ai noué de nouvelles amitiés qui se basaient sur notre marginalité et nos particularités, au lieu d’essayer de les cacher.
Mon cas est loin d’être rare. Non seulement de se découvrir autiste à l’âge adulte, mais aussi de devoir réapprendre à se comporter en autiste, en quelque sorte. En raison de la manière dont est ou a été médicalement défini l’autisme, du manque de spécialistes, ainsi que de nombreux biais sociétaux (racisme, sexisme, classisme), beaucoup de personnes autistes n’accèdent que tardivement, voire pas du tout, au diagnostic adapté. Même lorsqu’on reçoit ce diagnostic, peu de possibilités d’accompagnement et d’aides adaptées existent, surtout en France et en Belgique francophone. Ainsi, que ce soit après un diagnostic, en attente d’une évaluation, ou en marge d’une reconnaissance officielle, les adultes qui se découvrent autistes n’ont pas d’autres choix que de se tourner vers la communauté autiste, à qui Internet offre davantage de moyens de s’exprimer, de diffuser du savoir et de se rencontrer.
Je souhaite ici partager avec les personnes externes à notre communauté ce qui s’y passe, ce qu’on produit comme savoirs sur nous-mêmes, et ce qu’on se transmet comme aide pratique. J’explorerai en particulier l’exemple de la réappropriation des comportements d’auto-stimulation, dans l’idée de montrer comment la discussion sur nos corps, des corps dominés, pathologisés et souvent maltraités, peut être le point de départ d’un processus d’autodétermination et de redéfinition de notre condition — voire même une révolution sociale.
J’écris en tant que personne concernée, passionnée par l’introspection et l’observation de mes communautés. J’assume un point de vue situé, subjectif, et non scientifique, même si je suis aussi influencé par mon parcours universitaire (études en sciences humaines diverses), mes lectures théoriques, ainsi que mon envie de pouvoir formaliser le savoir expérientiel.
Pour commencer : l’autisme, c’est quoi ?
Selon les outils de référence actuels, le DSM-5 et la CIM-11, les troubles du spectre de l’autisme sont caractérisés par une dyade de symptômes :
-
Déficits persistants de la communication et des interactions sociales.
-
Caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités.
Les descriptions et la compréhension de l’autisme ont bien évolué depuis les débuts. On a notamment finalement compris qu’il s’agissait d’une condition neuro-développementale d’origine génétique complexe, un « câblage » différent du cerveau présent de la naissance à la mort et indissociable de la personne, et non un trouble psychique provoqué par les parents et les mères en particulier. On a aussi compris que l’autisme pouvait s’exprimer différemment selon les individus, d’où le recours à la notion de « spectre »2, et que la condition était assez fréquente — on estime aujourd’hui que ça concerne 1 à 2 personnes sur 100, alors que Kanner, un des premiers théoriciens de l’autisme, était persuadé qu’il s’agissait d’une condition rare3. Cependant, les définitions de l’autisme varient encore selon le regard porté sur la condition. Tandis que la médecine définit l’autisme en termes de déficits, d’incapacités, et d’écarts à une norme sociale jamais explicitée (usant de termes comme « inhabituel », « anormal »), les mouvements de défense des droits des personnes autistes s’appliquent à redéfinir la condition en termes affirmatifs et à expliquer les comportements autistiques en lien avec leur contexte d’émergence.
Ainsi, vouloir définir l’autisme, c’est plonger directement au cœur de la problématique : l’autisme a été défini comme un trouble à partir d’un point de vue situé sur ce que seraient des capacités, une trajectoire développementale, et un comportement « sains » et « normaux » - mais sans que ce point de vue ne soit désigné comme situé, ni même admis comme étant un point de vue. Cet ancrage dans certaines normes sociales explique que l’autisme soit considéré avant tout comme un trouble socio-communicatif, alors que les personnes autistes même non-verbales ont des tas de manières de communiquer, et que les personnes autistes en général se plaignent souvent d’autres aspects de leur fonctionnement bien plus difficiles à gérer au quotidien que le décalage avec la communication et la socialisation neurotypiques4. D’ailleurs, de nombreuses personnes peuvent se retrouver dans le fonctionnement et la communauté autistes sans pour autant correspondre aux critères de diagnostic, parce qu’elles ont pu aménager leur vie d’une manière qui leur convient, ou la traverser sans trop d’encombres, et donc ne pas ressentir de retentissement trop négatif au quotidien.
Il y a des points communs de fonctionnement parmi les personnes autistes, oui : des particularités sensorielles et perceptives ; une recherche de cohérence et de permanence, une difficulté d’adaptation aux changements ; une tendance à l’hyperfixation sur des sujets d’intérêt ; des différences de communication et de socialisation par rapport à la norme… Mais aussi beaucoup de différences : et le type de capacités qu’on a, les conditions co-occurrentes, les trajectoires de vie, l’environnement, la situation socio-économique, les autres discriminations vécues, influent sur les possibilités d’épanouissement et la qualité de vie des individus autistes. Globalement, la société n’étant pas adaptée aux particularités et trajectoires de développement des personnes autistes, celles-ci sont en situation de handicap5. En conséquent, la reconnaissance médicale peut être cruciale pour obtenir des aménagements et des aides, ainsi que pour la construction identitaire, surtout quand on est diagnostiqué·e tardivement.
Ceci étant dit, être confronté·e à la définition médicale de l’autisme, ainsi qu’à l’histoire de la considération de l’autisme dans la société et les médias peut aussi être très violent. Le point de vue extérieur qui nous a défini·es, prétendu neutre et légitime, est encore aujourd’hui objectifiant. D’ailleurs, si les définitions ont bien évolué depuis les premières descriptions retenues à la fin des années 1940, la curiosité s’est toujours cristallisée autour de deux aspects : d’une part, les différences de communication, et d’autre part, les mouvements du corps répétitifs ou l’intérêt persistant pour un objet. Pendant longtemps, on ne s’est pas intéressé·e à la perception interne d’une personne autiste : seuls les comportements visibles étaient notés et interprétés selon une grille de lecture adulte et neurotypique. Parce qu’iels n’utilisaient pas le langage oral, ne tournaient pas leur regard vers quelqu’un qui leur parlait, ou ne réagissaient pas aux requêtes de la manière attendue, on considérait les autistes inconscient·es de leur environnement et incapables de communiquer. Leurs gestes étaient vus comme dépourvus de sens, simple signe d’un psychisme ou système nerveux dérangé. Les comportements joyeux et exploratoires — sauter, tourner, battre des mains, fredonner, toucher ou goûter son environnement — n’étaient pas différenciés des comportements destructifs ou automutilatoires — se mordre jusqu’au sang, se frapper la tête, lancer des objets, déchirer du papier. Ce sont aussi les contextes d’observation qui ont amené à définir l’autisme de diverses manières et à imaginer qu’il pourrait s’agir de conditions différentes : Asperger n’a pas eu de patient·e·s radicalement différent·e·s de celles et ceux de Kanner. Il a simplement porté un regard différent sur ses patient·e·s, en se focalisant sur la découverte de leurs points forts et leurs aptitudes, et en comprenant les différentes formes que pouvait prendre cette même condition selon les individus et selon leur environnement. Sa collaboration avec le projet eugéniste nazi a mené au tri de ses patient·e·s (Sheffer, 2018) : d’où la description insistant sur les capacités spéciales, potentiellement utiles à la nation, d’enfants qui ne seraient donc pas assassiné·e·s.
Les contextes sociaux, historiques et politiques expliquent aussi les biais de genre, de race et de classe inscrits dans la description même de l’autisme, et qui peinent aujourd’hui à être dépassés. On a pensé que l’autisme était une condition masculine, sans se demander si le déséquilibre numérique entre garçons et filles pouvait être dû à une influence de l’éducation sur l’expression de l’autisme. Les mères qui avaient des traits autistiques ont été considérées comme des mères pathogènes, rendant leur enfant autiste par leur froideur émotionnelle et leur investissement dans une carrière professionnelle brillante. Les enfants autistes ont été décrit·e·s par plusieurs cliniciens comme ayant la peau très pâle et Kanner avait noté que l’autisme était présent majoritairement chez des enfants de parents diplômés et de classe sociale aisée. On aurait pu plutôt constater qu’il s’agissait de familles ayant accès à des soins, s’inquiétant davantage du développement atypique de leur enfant, ou encore se questionner sur des biais des médecins : aujourd’hui encore, on interprète différemment les comportements chez les enfants selon leur classe sociale, leur genre, leur couleur de peau. Mais ça a plutôt été décrit comme un élément intrinsèque à l’autisme. On sait aujourd’hui qu’il y a un sous-diagnostic des filles, des personnes non-blanches et des personnes issues de milieux défavorisés ; mais les difficultés d’accès aux services de soin, ainsi que le manque de représentation, continuent de constituer des freins majeurs au diagnostic.
Le point de vue oublié des personnes autistes
Dans les recherches et débats autour de l’autisme, on n’a longtemps pas pris en compte la voix des personnes autistes. Pourtant, celles qui pouvaient s’exprimer dans le langage communément admis ont vite présenté une autre version de leur réalité. Mais dès lors qu’il ne s’agissait que de personnes isolées, leur voix seule ne pouvait pas gagner contre toutes les théories préexistantes appuyées par l’autorité scientifique. Surtout qu’on considérait comme impossible que les personnes autistes puissent avoir conscience d’elles-mêmes, puissent porter un regard critique sur le monde et s’exprimer clairement6. La condition était aussi initialement pensée comme infantile : l’évolution de l’expression de l’autisme chez la personne qui grandit n’était pas prise en compte. On ne parlait pas d’adultes autistes. Les enfants « souffrant d’autisme » étaient condamné·e·s à passer leur vie en institution sans pouvoir évoluer, alors qu’on sait maintenant que c’est plutôt l’enfermement en institution qui est nuisible au développement. Bref, historiquement, un·e adulte autiste qui s’exprime, voire qui est épanoui·e, était considéré·e comme ayant « guéri » de l’autisme. C’est d’ailleurs ainsi qu’ont dû d’abord se présenter les deux premières personnes autistes à avoir écrit leur autobiographie à l’âge adulte, Temple Grandin (Grandin & Scariano, 1986) et Donna Williams (1992), forcées de formuler leur expérience dans un cadre socialement admis, se disant « rétablies » et/ou étant autiste en conséquence d’un traumatisme.
Cette absence de prise en compte du point de vue des personnes neurodivergentes dans tous les champs de recherche, que connaissent aussi d’autres groupes sociaux minorisés, représente une véritable injustice épistémique (Legault & Poirier, 2019). Cela a de lourdes conséquences sur nos vies, depuis une longue histoire de maltraitance jusqu’à un manque d’accompagnement adapté, en passant par l’accès inégal au diagnostic et des discriminations dans toutes les sphères de la société.
En effet, ce qui motive des comportements jugés comme des symptômes en soi n’a été que tardivement et marginalement pris en compte dans la compréhension de l’autisme. Être autiste, c’était aller mal, point. Être en crise, par exemple, était juste signe qu’on souffrait d’autisme, pas signe qu’on souffrait de douleurs ou d’inconfort qui auraient pu être soulagés. Cette vision a influencé non seulement la manière dont on définit et diagnostique l’autisme, mais aussi celle dont on le « traite ». Les enfants autistes étaient considérés comme vides, sans âme, à modeler et conditionner, au moyen de violences physiques et tortures psychologiques. Lovaas — fondateur de la méthode ABA et, en parallèle, des thérapies de conversion pour les personnes homosexuelles et transgenres — parlait des mouvements répétitifs des autistes comme de garbage behavior [comportements poubelles]. Pour lui, les comportements autistiques empêchaient l’enfant de se développer, d’apprendre et de se lier aux autres. Les méthodes appliquées pour décourager tout comportement autistique allaient de frapper et secouer les enfants, leur crier dessus, les priver de nourriture, jusqu’à leur administrer des chocs électriques et des antipsychotiques. Aujourd’hui, les thérapies comportementales qui visent à normaliser le comportement de l’enfant sont encore courantes. L’ABA, même « modernisée » et moins punitive, est tout de même nocive pour la personne autiste, en augmentant le risque de syndrome de stress post-traumatique (Kupferstein, 2018), ainsi que la vulnérabilité aux abus ; globalement, toute injonction à masquer ses traits autistiques est liée à un risque dépressif et suicidaire accru (Cassidy et al., 2020).
Être diagnostiqué·e tardivement augmente aussi les risques d’être victime de violences et de développer des troubles de santé mentale — d’autant plus que le sous-diagnostic concerne davantage des personnes appartenant à des groupes sociaux déjà marginalisés et opprimés (femmes, personnes queer, personnes racisées…). Et si autant de personnes passent sous le radar diagnostique, c’est aussi en raison de la manière dont est défini, décrit et conceptualisé l’autisme. Sans une longue expérience et une ouverture d’esprit, les psychologues et psychiatres théoriquement formé·es au diagnostic d’autisme ne repèrent que les comportements, les manières de communiquer, et les « intérêts restreints » qui correspondent à des clichés. Cela empêche de voir au-delà des stratégies de compensation et de camouflage adoptées par beaucoup d’autistes, en particulier les personnes sexisées et/ou racisées, ou de comprendre comment s’exprime l’autisme chez une personne qui n’est pas un petit garçon blanc de famille aisée. Or l’éducation et les dominations systémiques jouent dans la manière dont se développe une personne autiste, et donc dans la manière dont s’exprime visiblement son fonctionnement autistique (sur ce sujet, voir notamment Price, 2022).
La résistance de la communauté autiste
Les points de vue internes des personnes autistes, qui permettent de contester ou compléter les points de vue externes prétendument neutres, gagnent en force et en légitimité par leur nombre et leur cohérence. Des communautés regroupant des personnes autistes et fonctionnant selon des règles sociales marginales ont toujours existé, sans forcément se définir comme autistes (Silberman, 2015) ; et l’émergence de nouveaux diagnostics (notamment le syndrome d’Asperger), qui a coïncidé avec la généralisation d’Internet dans les années 1990, a soudain précipité la possibilité d’identification et de rencontre. Ainsi, les mouvements de self-advocacy7 de personnes autistes ont pu se développer grâce à l’échange via des mailing-lists, des forums, puis grâce à la rencontre, notamment lors des conférences Autscape8. Ces moments organisés par et pour des personnes autistes ont pu concrétiser l’expérience d’un environnement, une organisation sociale et des modes de communication différents, auto-déterminés, flexibles, essayant de prendre en compte les particularités de toustes. Dans ces environnements-là, les personnes autistes ne se sentaient plus ni irréductiblement différentes, ni handicapées. Le fait de pouvoir, ensemble, reformuler son vécu et partager d’autres manières de communiquer, de créer du lien, ressentir de la joie, a été au cœur de ces mouvements de défense des droits. Reformuler les « déficiences » plutôt en termes de discrimination et d’inaccessibilité a abouti à la formation d’une culture autistique qui allait de pair avec des revendications politiques. Mais ces revendications n’ont été que peu et/ou lentement absorbées par le monde scientifique et médical.
Aujourd’hui, les communautés autistes sur Internet sont nombreuses, variées, riches et vivaces. C’est souvent notre seule possibilité d’obtenir des informations, d’exister sans masque, de nous sentir à l’aise, compris·e et accepté·e. Moi-même, je dois tout à la communauté autiste. Je dis tout, parce que même l’hypothèse que je puisse être autiste, ce sont des personnes autistes qui l’ont formulée. En 2017, j’ai ouvert un blog pour raconter sans étiquette mon fonctionnement et mon rapport aux normes sociales, après des années de recherches personnelles sur ce qui clochait chez moi, de diagnostics erronés, de déni. Et ce sont des femmes autistes qui se sont reconnues dans mes écrits et m’ont automatiquement considérée comme l’une des leurs, me mettant cette fois-ci sur la bonne piste. La première fois que j’ai atterri dans un groupe de soutien d’adultes autistes sur Internet, j’ai eu un choc. C’était comme atterrir enfin sur ma planète, après tant de temps à me sentir irréductiblement différente et incomprise. Se prendre en pleine face, subitement, des centaines de témoignages de petites et grandes choses qui ressemblaient à ma vie intérieure, pouvoir échanger sans avoir à tout expliquer et me sentir bizarre, c’était étourdissant. Ce choc positif de la rencontre avec des semblables est une expérience commune à beaucoup d’entre nous.
Sur les groupes de soutien, les forums, et les publications personnelles (blog, Instagram, Twitter, Youtube, podcasts…), on parle de tout, on se livre sur le moindre aspect de notre quotidien qu’on décortique selon la nouvelle grille de lecture qu’on vient d’acquérir (notre fonctionnement autistique, notre situation de handicap), en l’articulant éventuellement aux autres grilles de lecture qu’on avait au préalable (autres handicaps, habitudes familiales, genre, sexualité, culture, personnalité…). Une grande part des discussions tourne autour de la redécouverte de nos traits autistiques et de nos besoins, ainsi qu’autour de la confrontation de ces caractéristiques avec la définition médicale qui en est faite. Ensemble, on réinvente aussi des manières de dialoguer, de faire connaissance, de se soutenir, de s’enrichir. À la suite des premier·es militant·es des années 1990, on crée une certaine culture autistique9, faite de modes de communication, de références culturelles, d’un humour particulier, de similarités de traits et expériences de vie, mais aussi de notre position par rapport au groupe dominant. Ce qui nous lie, plus encore que nos points communs en termes de neurologie, ce sont la pathologisation de notre fonctionnement et l’expérience de la différence. Une partie de la construction de ce sentiment de communauté, de la définition d’une identité et de l’émergence d’une fierté d’être, est la réponse à la négativité associée aux aspects de notre existence qui ne correspondent pas aux attentes sociales. C’est le détournement, la réappropriation et la redéfinition de ce qu’on est et qui avait été d’abord défini de l’extérieur et pathologisé : il s’agit d’un processus commun à tous les groupes sociaux minorisés et discriminés. D’ailleurs, dès le début, les discussions sur la culture autistique et la défense des droits des personnes autistes se sont appuyées, entre autres, sur l’histoire de la culture Sourde et sont aujourd’hui pensées en lien avec les mouvements queer et crip10. Or une part centrale de nos échanges et de l’identité autiste concerne nos particularités sensorielles et ces gestes et comportements « stéréotypés, restreints et répétitifs », que nous redéfinissons en stimming.
Qu’est-ce que le stimming ?
Personnellement, je définis le stimming comme l’utilisation (consciente ou automatisée) d’une stimulation sensorielle d’une manière spécifique, que ce soit pour la régulation, l’expression émotionnelle, ou la communication. Le mot stimming vient de l’anglais et est une contraction d’une expression issue du vocabulaire médical, self-stimulatory behavior, en français comportement d’auto-stimulation. En anglais, on trouve le verbe to stim et le substantif stim pour désigner un geste de stimulation particulier et ce vocabulaire est utilisé de manière relativement courante et neutre. En français en revanche, ces mots ont été récemment repris et adaptés par la communauté autiste et militante d’abord et sont encore peu utilisés par les psychologues, éducateurices et psychiatres : leur utilisation indique un parti pris, un certain regard sur le stimming. Le vocabulaire médical francophone parle d’ailleurs aussi de stéréotypies, ce qui, en psychiatrie, désigne une « répétition fréquente, incontrôlée et parasitaire d’attitudes, de gestes, de paroles, observée dans certaines maladies du système nerveux » (CNRTL). Pour l’œil médical qui diagnostique, il faut que les gestes soient répétitifs, persistants et « inhabituels » pour être relevés ; et l’avis de la psychiatrie, c’est que l’usage qu’on fait de notre corps, des objets, de notre environnement en général, n’a pas de sens, est anormal et parasite. Les personnes autistes, elles, se sont basées sur le vocabulaire médical pour désigner des comportements qu’on n’aurait peut-être pas eu besoin de définir, de désigner, ou de catégoriser de cette manière, s’il n’y avait pas eu le préalable psychiatrique. Mais nous11 n’avons pas que modifié le nom : nous lui avons donné de nouvelles significations et valeurs.
Entre nous, nous nous appliquons justement à définir au mieux, distinguer et catégoriser le stimming. Nous nous interrogeons sur ce qui est du stimming, en distinguant mieux que ne le font les descriptions médicales stimming et TOC (trouble obsessionnel-compulsif), stimming et tics, et en nous éloignant des critères de répétitivité, persistance et « caractère inhabituel » de nos gestes. Nous cherchons à comprendre ce qui relève du stimming, non en fonction de quoi ça a l’air de l’extérieur, mais d’à quel besoin ça répond, de quelle fonction ça remplit, des sensations que ça nous procure et des sens auxquels cela est lié. Caresser son chat peut remplir une fonction de stimming tactile, prendre une douche est un stim tactile et proprioceptif, ranger des objets par couleur est un stim visuel. Nous discutons aussi de stimming vocal ou même mental, qui peut passer inaperçu, ou encore d’un certain stimming passe-partout, intégré par exemple dans la manière de s’habiller : porter des boucles d’oreilles et des bracelets, des habits serrés et des chaussures lourdes, des motifs ou paillettes qui stimulent visuellement…
Via nos redéfinitions et nos exemples, nous échangeons aussi sur les fonctions multiples du stimming, très tard prises en compte par la recherche scientifique12, voire presque pas mentionnées. Nous expérimentons avant tout les fonctions de régulation sensorielle et émotionnelle du stimming, en parlant de comment mieux supporter une sensation désagréable en stimmant positivement par ailleurs : évacuer l’anxiété en battant des bras ou en agitant une simple bouteille à paillettes, réguler l’excitation et les flots d’idées en sautant et tournant, pouvoir tenir une conversation difficile en triturant des objets… Nous témoignons d’en quoi stimmer peut être une réelle aide à la concentration, que ce soit pour travailler ou pour écouter quelqu’un ; alors que toute notre vie, à l’école, au travail, nous avons été accusé·es de nous dissiper et de ne pas écouter dès que nous mettions notre corps en mouvement ou regardions ailleurs.
Nous mettons aussi en avant et travaillons à déstigmatiser la fonction exploratoire et ludique du stimming, qui ne semble être acceptée que chez les enfants et dans une certaine mesure. Dans des groupes de soutien sur les réseaux sociaux, des joies sensorielles sont fréquemment partagées : montrer des photos de nos peluches, d’un tissu qu’on aime caresser, d’une architecture symétrique ou de couleurs assorties ; assumer qu’on écoute le même morceau de musique en boucle depuis des mois, s’exclamer qu’on vient de redécouvrir telle sensation/tel mouvement qui est merveilleux, voire partager et même faire soi-même des vidéos aux sonorités agréables (ASMR) ou aux images et mouvements stimulants ou hypnotisants.
Enfin, de nombreuses personnes autistes s’activent à montrer que le stimming peut être un réel moyen d’expression et de communication, communication aussi avec l’environnement matériel13. C’est ce qu’a fait Mel Baggs dès 2007, dans sa vidéo « In my language » où iel se filme en train de stimmer et reprend dans une deuxième partie de vidéo les mêmes images en les « traduisant » en langage verbal pour expliquer ce que signifient ses mouvements et comment iel interagit avec son environnement14. C’est ce que fait aussi la youtubeuse Agony Autie (Sara Jane Harvey), dans ses multiples vidéos consacrées au stimming, où elle confronte le point de vue externe sur ce qu’elle est en train de faire, à son point de vue interne de personne en train de vivre un moment d’émerveillement sensoriel et de communion intense avec son environnement, et où elle donne à voir un moment de communication non-verbale avec son fils, sous forme de « stim-dance »15. Entre adultes autistes verbaux/oralisants, nous réinstaurons cette manière de faire du lien et de communiquer que notre éducation nous a fait désapprendre : on peut passer du temps ensemble juste à échanger par bruits d’animaux, se balancer et se perdre dans la lumière. Certain·es s’envoient des notes vocales de miaulements et fredonnements, ou des clips vidéo où iels stimment.
Nos échanges sont aussi de l’entraide et de la transmission d’expérience : nous nous donnons par exemple des conseils pratiques pour minimiser ou remplacer les habitudes de stimming nocives, y compris celles qui ne sont pas considérées comme telles par nos thérapeutes. Nos échanges nous permettent de poser un autre regard sur une addiction à la cigarette ou sur la boulimie, qui ont à voir avec le besoin de stimulation orale ; sur une pratique de sport trop intensive, ou des gestes d’automutilation y compris la dermatillomanie, qui répondent à un besoin d’auto-contact et de stimulation proprioceptive. Nous nous donnons aussi des idées concrètes pour minimiser l’impact négatif de ces pratiques, en considérant non seulement les émotions qui se cachent derrière ces gestes compulsifs nocifs, mais aussi les types de stimulation sensorielle qu’ils procurent.
Nous nous suggérons plus largement des manières de stimmer, en décrivant nos gestes, revenant à nos souvenirs d’enfant, analysant les activités ou les sensations que l’on aime bien et pourquoi, nous encourageant à explorer les jouets et activités « pour enfants » (pâte à modeler, peinture à doigts, jouets à mâcher pour bébés, peluches, Lego, etc.), faisant des démonstrations et évaluations de stimtoys, montrant les objets du quotidien qui nous servent à stimmer (élastiques à cheveux, bracelets de perles, brosse, bonbons acides, fermeture éclair, etc.) ou montrant comment fabriquer facilement des stimtoys soi-même. Ces pratiques ont lieu au sein de nos réseaux sociaux fermés aux personnes non-autistes, mais aussi publiées et diffusées par les personnes qui produisent du contenu public sur Internet.
Oui, nous nous encourageons à apprendre à stimmer. Ces comportements en fait naturels ont été très tôt découragés : nous sommes nombreuxses à nous être appliqué·e·s, consciemment ou non, à supprimer, détourner ou cacher nos pratiques de stimming, pour pouvoir s’intégrer ou pour éviter d’être puni·es, maltraité·es, harcelé·es, exclu·es. Parfois, on a pu détourner nos besoins sensoriels et de stimulation en activités socialement acceptables (courir, danser, chanter, tricoter), même nocives (fumer). Souvent, on s’est privé·e de ces moyens naturels d’exploration, de régulation, de communication et de résilience, et on vit par conséquent avec une anxiété et un risque de burnout plus élevé·es. Donc entre nous, nous nous encourageons à réapprendre à stimmer aussi largement, fréquemment et « bizarrement » que nous en avons besoin, et à nous détacher de la honte intériorisée qui y est attachée. Ça ne va pas sans difficultés : il faut avoir conscience des dangers réels auxquels on s’expose (décrédibilisation, rejet, exclusion, violence physique ; voire violences policières et mort, lorsqu’on est un homme non-blanc16) et parfois lutter contre nos réflexes post-traumatiques. De ça aussi, on discute : comment réapprendre et explorer, où, avec qui, avec quels risques.
Or, comme les normes scolaires et sociales en général nous forcent à rester immobiles et à « maîtriser » nos corps, même une large part des accompagnements proposés aux personnes autistes, enfants comme adultes, et censés nous aider, se basent encore sur l’idée qu’il faut avoir moins « l’air autiste » pour s’intégrer…
Et puis, double peine pour les personnes autistes non-reconnues dans l’enfance, nous apprenons pour survivre à masquer et à contrôler nos corps, et ça se retourne contre nous lors de la recherche de diagnostic et d’une reconnaissance de handicap, puisque nous ne nous comportons plus en autiste de manière suffisamment visible. En raison du manque de représentation de la diversité des formes d’expression de l’autisme et des définitions médicales basées uniquement sur l’observation clinique, nous nous retrouvons aux prises avec la remise en question et les doutes des autres, mais aussi de nous-mêmes. La question de la légitimité est omniprésente dans nos discussions : est-ce que je fais semblant ? Est-ce que j’essaye juste d’avoir l’air autiste ? Si le stimming est naturel, je ne devrais pas avoir à l’apprendre, non ? Nous sommes coincé·es par cette idée reçue du temps de Kanner, qui pensait que les autistes étaient imperméables à leur environnement et incapables d’apprendre. Nous, adultes qui avons souffert d’intégrer au plus profond de nous les normes sociales, jusqu’à nous empêcher de bouger et de ressentir même une fois seul·es, pouvons témoigner qu’il en va tout autrement.
Mais cette question de la légitimité se double aussi de la remise en question de la différenciation et pathologisation de nos comportements. De l’inquiétude d’être reconnu·e autiste lors des étapes du diagnostic, nous glissons vite vers le questionnement des normes sociales : les personnes non-autistes elles aussi triturent leurs cheveux, mâchent du chewing-gum, se balancent sur une chaise, font tourner un stylo entre leurs doigts… alors, quelle différence avec nous ? Une différence de nature, d’intensité, de fonction ? Une différence intrinsèque, ou née des normes sociales ? Pourquoi sommes-nous vu·es comme déficient·es pour ne pas réussir à lire la communication non-verbale des personnes non-autistes, alors qu’elles sont tout aussi incapables de comprendre nos gestes ?
Nous discutons également de notre enthousiasme et agacement simultanés face à tout ce qui est en vogue aujourd’hui, se commercialise comme nouveau et révolutionnaire, est prescrit en thérapie ou dans les milieux éducatifs et se vend cher : les outils de régulation sensorielle et émotionnelle et les outils psycho-corporels de gestion du stress, qui sont les mêmes gestes et outils qu’on stigmatise et cherche à supprimer chez les personnes autistes (la méditation en pleine conscience, l’attention aux objets du quotidien et à leurs textures et couleurs, l’instauration de routines, les positions de yoga qui régulent le système nerveux, le recours à des odeurs réconfortantes ou la malaxation de balles anti-stress…). Un stimtoy comme le fameux handspinner devenu populaire en 2017 peut soudain, parce que mis en avant par des personnes normées, devenir non seulement acceptable et généralisé mais même loué dans pléthore d’articles de presse qui semblent découvrir l’eau chaude, tandis que l’effet de mode peut nuire aux personnes neurodivergentes pour qui il s’agit d’un outil essentiel de concentration et dont le besoin n’est pas compris. Et que dire des outils de méditation et de prière, comme les chapelets, qui se retrouvent dans diverses cultures et religions ?
Souvent, cela nous amuse plutôt de noter à quel point les personnes perçues comme « normales » ont elles aussi, tout le temps, des comportements d’auto-stimulation, des gestes répétitifs, des routines et rituels et même ce qui pourrait être qualifié d’écholalie ou usage stéréotypé du langage. Nous avons conscience de quels comportements socialement acceptés peuvent, pour nous, être du stimming. La youtubeuse Agony Autie déclare ainsi, montrant avec humour sa production prolifique d’items crochetés : « Crochet is the definition of a stim : it is the repetitive fixated focused and quite frankly obsessive movement or behaviour repeated again, and again, and again » [« Le crochet est la définition d’un stim : c’est un mouvement ou un comportement répétitif, concentré et disons-le, obsessionnel, répété encore et encore et encore. »]17. Dans une autre vidéo18, elle révèle le secret de son style vestimentaire coloré et brillant, qui est aussi celui de nombre de mes ami·es autistes : » I dress myself in visual stims » [« Je m’habille en stim visuels »].
Pour normaliser aussi les gestes d’autostimulation pathologisés, de nombreuses personnes autistes sur Internet s’appliquent à représenter en dessin leurs personnages qui flappent19 ou se balancent et diffusent des vidéos d’elles-mêmes ou de leurs enfants en train de stimmer joyeusement. C’est une réponse, aussi, aux vidéos diffusées par de nombreux parents d’enfants autistes, les montrant en pleine crise ou en plein stimming de détresse. Notre message, vers l’extérieur mais d’abord envers notre communauté, c’est que se balancer, battre des mains, fredonner, sautiller, tapoter ses doigts, peuvent être des gestes qui expriment et/ou procurent de la joie.
Je parle ici de ce qui se construit à partir des échanges sur Internet, mais la discussion sur le stimming et la défense de ses fonctions a commencé bien avant. Les deux premières autobiographies de personnes autistes, mentionnées plus haut, s’attardent en plusieurs endroits sur leurs pratiques d’autostimulation et leurs réactions à l’environnement sensoriel. La « machine à câlin » (hug box ou squeeze machine) construite par Grandin (Grandin & Scariano, 1986) enfant est devenue connue et a depuis été reproduite industriellement. Temple avait été inspirée par le travail à ferrer dans lequel sont pressés les bovins : contenus, ils semblaient se calmer. Pouvoir s’administrer à elle-même cette pression profonde, en en maîtrisant les conditions, sans se sentir sur-stimulée et menacée par le contact direct avec d’autres êtres humains, lui a permis en même temps de s’apaiser et se recharger au retour de difficiles journées d’école, mais aussi de s’ouvrir davantage aux autres : pas parce qu’elle devenait « moins autiste », mais parce qu’elle a trouvé un moyen justement très autistique d’apaiser son système nerveux. Williams (1992), quant à elle, raconte comment elle a pu instinctivement entrer en contact avec de jeunes autistes qu’on pensait incapables de communiquer, en passant par un partage de jeux sensoriels avec des objets. Elle raconte aussi ce qu’elle a pu enseigner à une petite fille placée en institution, perpétuellement en crise : après avoir établi un contact via des objets qui procurent des stimulations tactiles et visuelles agréables, elle lui transmet un réflexe de stimming régulier (fredonner un air en tapant en rythme, doucement, sur une partie de son corps) pour calmer l’anxiété, ce qui lui permet très rapidement de s’autoréguler et réduire les crises.
Inversement, les échanges et pratiques qui ont commencé pour nous sur Internet impactent finalement nos vies concrètes : prendre l’habitude de proposer des stimtoys, des casques de chantier et un coin calme lors d’événements entre autistes ; ne plus cacher nos gestes, nos besoins, nos enthousiasmes ; assumer de préférer s’asseoir par terre ou en tailleur sur une chaise et poser quelque chose de lourd sur nos genoux ; s’offrir des stimtoys et partager des joies sensorielles entre ami·es. Donna Williams glissait des petits morceaux de papier brillant dans les lettres aux personnes de son réseau d’adultes autistes (Silberman, 2015), et de même j’ai toujours mis des paillettes ou des brins de lavande dans mes enveloppes. Plus largement, c’est recalibrer sa vie autour du stimming, que ce soit en réaménageant son appartement, en changeant de loisir ou de pratique sportive, en adaptant sa garde-robe, voire en lançant un commerce de stimtoys et aides sensorielles20.
C’est aussi appuyer nos revendications politiques sur la question du stimming, son acceptation, sa libération. À force d’en parler et de le montrer, nous opérons un retournement de valeur et remettons au centre de nos vies ce qui nous a souvent coûté beaucoup de peine, de punitions et de honte. Le stimming est ainsi devenu un pilier de la culture autistique et une part importante de notre manière de faire du lien, de nous représenter et d’opérer une résistance sociale. Le mouvement en est à ses balbutiements en francophonie européenne, mais dans les pays anglo-saxons, il existe des mouvements autour de la défense du stimming21, de nombreux slogans et hashtags militants (« loud hands are happy hands » [les mains bruyantes / visibles sont des mains joyeuses]), une journée internationale du stim (le 17 septembre), et des ateliers de pratique du stimming et de stim-dance comme outil militant (par exemple Stim your Heart out [Stim de tout ton cœur]22). Via Internet, la culture autistique se diffuse au-delà de la sphère anglophone : qualifier des objets ou personnes de « stimmy »23, inventer des onomatopées (« flap flap »), détourner des gifs et emoji existants pour leur faire signifier du flapping ; utiliser des images de fidget-cube, tangle, handspinner ou casque antibruit pour faire référence à l’autisme et le TDAH dans des visuels ; ou comprendre certaines couleurs, textures, objets comme part de la culture autistique, en raison de leurs caractéristiques sensorielles (couleurs pastels, tissus doux, peluches, paillettes, sweat-shirts à capuche, lampes à lave…).
Redéfinition de l’autisme et des normes sociales
Vous l’aurez compris, je n’avais pas juste envie ici de témoigner de la manière dont on s’amuse entre nous à flapper, toucher des trucs et s’émerveiller devant des couleurs. Ce qu’on fait et ce qu’on dit du stimming a de nombreux enjeux scientifiques et politiques.
Tout d’abord, nous apportons des éléments pour affiner, voire bouleverser : 1) l’évaluation diagnostique ; 2) l’accompagnement thérapeutique des personnes autistes ; 3) la définition même de l’autisme. En effet et pendant longtemps, l’autisme a été repéré et qualifié de plus ou moins sévère en fonction de l’impact sur l’entourage de l’individu autiste et non de la perception et des besoins de ce dernier. Nous, nous proposons de se baser davantage sur les mécanismes internes à l’origine de nos comportements - notamment du stimming.
1) Nous avons pu échanger avec plus de personnes autistes et souvent plus librement que ne peuvent le faire les psychologues et psychiatres qui font passer les bilans dans un cadre artificiel et sur un temps restreint. Nous savons repérer le stimming chez nos proches, les personnes qu’on croise dans les transports et les magasins, les personnages de fiction que des scénaristes ont rendus autistes sans s’en rendre compte. Pas seulement parce que nous connaissons l’autisme de l’intérieur, mais aussi parce que la reconnaissance de patterns et l’attention aux détails sont des capacités typiques de l’intelligence autistique. Nous savons expliquer tel ou tel comportement qui n’a pas l’air d’avoir de sens pour un autre observateur, distinguer le stimming qui est signe d’inconfort du stimming d’exploration joyeuse. Nous pouvons également donner des pistes pour détecter le stimming qui se cache dans des gestes et pratiques considérés comme normaux pour notre genre ou notre appartenance ethnique/culturelle24, stimming qui n’est donc pas repéré chez, entre autres, les femmes et les femmes noires en particulier.
2) Notre point de vue est précieux pour proposer une autre manière d’accompagner les personnes autistes. Grâce à cette compréhension interne de nos gestes, réactions, comportements, le stimming peut désormais devenir un véritable outil thérapeutique et d’apprentissage. S’il y a eu çà et là en psychiatrie une conscience que ce n’était pas tel comportement qui était nocif en soi, mais que c’était les préjugés qui faisaient de ces comportements un obstacle à l’intégration sociale, on considérait tout de même qu’il était plus facile, et plus juste, de changer l’individu plutôt que les mentalités. Or, on sait maintenant que changer l’individu en ces termes ne marche pas et est nocif, et que les comportements autistiques sont fonctionnels. Comprendre ça et s’inspirer de ce qui se fait déjà dans nos vies d’autistes permettrait d’offrir aux enfants, adolescents et adultes autistes un bien meilleur accueil scolaire et accompagnement thérapeutique. Il ne s’agit pas de nier qu’il existe un contexte social, des règles, des risques, mais de pouvoir considérer de manière neutre les besoins sensoriels des personnes autistes et encourager tant que possible à l’aménagement de l’environnement, tout en pouvant apprendre à moduler le stimming selon le contexte et le désir de la personne autiste. Cela permettrait enfin de rediriger les stims réellement dérangeants et nocifs, ou de remédier au problème sous-jacent que ces stims cherchent parfois à exprimer. Considérer les besoins sensoriels et le stimming chez les personnes autistes donne plus largement des clés pour comprendre et soigner tout un tas de comorbidités (dans mon cas, les troubles alimentaires), pallier les difficultés quotidiennes et aider à guérir de traumatismes et de burnout.
3) Mettre la perception sensorielle et le stimming au centre de la compréhension de notre fonctionnement pourrait amener à une nouvelle manière de définir l’autisme. Jusque-là, les particularités sensorielles n’ont pas été un critère définitoire en soi ; mais beaucoup de personnes autistes ainsi que des recherches en neurosciences avancent des hypothèses qui placent les particularités de la perception et du traitement de l’information à la base du fonctionnement autistique. De même, on pourrait penser les différences entre personnes autistes non selon des capacités, mais selon des profils sensoriels et cognitifs. Concrètement, il s’agirait d’abord de mieux définir les « comportements et intérêts restreints et répétitifs », puisque les différentes composantes de cette catégorie correspondent à des fonctions et mécanismes différents. Cet apport permettrait de distinguer le stimming autiste par exemple des TOC et tics, ou des comportements liés à un choc traumatique, avec l’avantage de pouvoir mieux repérer les comorbidités, éviter les diagnostics erronés et venir en aide plus vite à des enfants maltraités. On pourrait également comprendre différemment le lien établi entre la présence de gestes répétitifs plus visibles et la déficience intellectuelle et/ou l’autisme non-verbal. Les études notent qu’il y a davantage de formes manifestes de gestes d’autostimulation, qui vont jusqu’à des gestes automutilatoires, chez les personnes autistes à bas QI et/ou non-verbales. Cette corrélation, vue jusque-là comme signe de la « sévérité » de l’autisme, pourrait plutôt être interprétée en lien avec l’anxiété ressentie, le besoin de communiquer, une moindre perméabilité aux attentes sociales… parallèlement à l’hypothèse d’un système nerveux plus excitable et d’une moindre capacité d’inhibition.
Au-delà de l’apport au champ de la psychologie, se redéfinir par rapport au stimming présenté de manière positive porte aussi un potentiel révolutionnaire pour la société toute entière. Tout d’abord parce que ça permet de reprendre le contrôle de notre narration jusque-là confisquée par la psychiatrie, et se définir non en creux mais dans l’affirmation. Et puis, au-delà de la communauté autiste, parler de perception sensorielle crée des ponts avec d’autres personnes neurodivergentes qui ont les mêmes sensibilités et besoins et qui peuvent utiliser le stimming comme outil de gestion des émotions. Parler de mouvement et de sensorialité amène à se définir en lien avec d’autres personnes handicapées physiquement, à se percevoir comme un corps qui fonctionne différemment. Les objets dont nous avons besoin sensoriellement deviennent nos aides à la mobilité et à l’autonomie, des prolongements de nous-mêmes. Le respect de nos besoins de mouvement et de stimulation devient une question d’accessibilité. C’est une manière de politiser la discussion et de la lier à toutes les luttes handies.
Toustes, nous avons vécu la mainmise de la médecine sur nos existences. Cette privation par la psychiatrie de nos vies, nos désirs, notre histoire, notre communauté, est une expérience commune à toutes les communautés marginalisées et opprimées, qui ont pu varier au cours des époques et des lieux. Comme les personnes queer par exemple25, nous avons dû la plupart du temps nous construire et nous définir par rapport à l’insulte et au rejet. Nous avons été aliéné·es de nos semblables non seulement par la pathologisation, le tabou, l’interdiction, mais aussi par une privation de moyens de communication. C’est ce qu’a traversé la communauté Sourde, avec la langue des signes longtemps non-enseignée et dévalorisée, voire bannie. Sans possibilité naturelle de s’exprimer, de conceptualiser et de communiquer, avec l’obligation de se plier à une autre manière de faire qui n’est pas naturelle, les personnes sourdes ont été mises en situation de handicap et ont été longtemps empêchées de créer leur propre communauté et culture. Tout ça, c’est aussi l’histoire des autistes, qui doivent désormais se redéfinir hors d’un vocabulaire pathologisant, au-delà du traumatisme communautaire des meurtres et des maltraitances et malgré une société qui reste excluante.
Enfin, la redécouverte, la réappropriation et le renforcement de nos comportements de stimming détient un potentiel révolutionnaire par sa nature même. Il ne s’agit pas juste de se forger une identité positive, de retourner le stigmate et rejeter la honte, ou encore de mettre en avant nos capacités plutôt que nos déficiences. En ce qui concerne le stimming, l’effet est beaucoup plus immédiat, brut, désintellectualisé. Il s’agit de retrouver une puissance et des capacités de réparation, à un niveau très basique, organique. C’est la même puissance et confiance en soi retrouvées dont témoignent des femmes et personnes queer qui se réapproprient leur sexualité, qui explorent et assument leur désir et leur plaisir. D’ailleurs, quand je nous vois ensemble, adultes autistes, à laisser tomber notre costume social et stimmer en toute liberté, j’ai une pensée pour les ateliers de masturbation féminine lancés dans certains milieux féministes américains dans les années 1970. L’apport de ces pratiques n’est pas que symbolique : c’est évacuer l’adrénaline après un gros stress et se doper aux endorphines et en dopamine. Associé à la colère d’avoir été injustement privé·es de ces besoins et réflexes naturels, il y a, en effet, un potentiel révolutionnaire dans le fait juste de se donner du plaisir sensuel et sexuel, ou… de stimmer26.
C’est aussi pour ça que je voulais parler du stimming dans cet article, plutôt que d’autres caractéristiques autistiques. Il y a eu de nombreux·ses auteurices et porte-paroles pour défendre les avantages de l’intelligence autistique, mais peu pour parler de nos corps : pudeur, tradition cartésienne, peur de l’essentialisme, déni de notre animalité… ? En parlant stimming, nous remettons au contraire notre sensorialité, notre corps, ses besoins et son lien à l’environnement, au centre et au départ de toute discussion, ce qui est un changement radical de perspective par rapport à la vision de l’être humain dans notre société occidentale moderne.
Conclusion
Cet article visait à rapporter quelques observations sur les échanges et pratiques autour du stimming au sein de la communauté autiste, et d’étudier en quoi cela redéfinit non seulement le stimming en soi, mais plus largement toute la vision de l’autisme. Ces pratiques font partie d’une culture autistique qui résonne au-delà des individus autistes, offre au sein de notre société des espaces et références de fonctionnement différents et vient bousculer les normes sociales. Ces observations valent aussi pour d’autres aspects du fonctionnement autistique. On redéfinit et explore aussi ce qu’on appelle les intérêts spécifiques, ou les modes de communication et démonstration d’affection typiquement autistes. Or nos redéfinitions comme nos pratiques finissent toujours par questionner ce qui est considéré comme normal ou bizarre, sain ou pathologique. Ces questionnements, ainsi que le fait de voir les personnes neurodivergentes comme un groupe social discriminé plutôt que comme personnes malades ou déficientes, sont selon moi indispensables à intégrer dans la recherche en psychologie et neurosciences, ainsi que dans la pratique des métiers du soin. Nous avons besoin de psychologues, psychiatres, chercheur·euses qui comprennent l’intérêt d’impliquer les personnes autistes dans les recherches les concernant et de se baser sur nos témoignages pour déterminer la meilleure manière de nous accompagner. Et cette co-construction du savoir peut aussi passer par l’expérience directe, incarnée : alors, quand est-ce que vous venez stimmer avec nous ?
Conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêt déclaré.