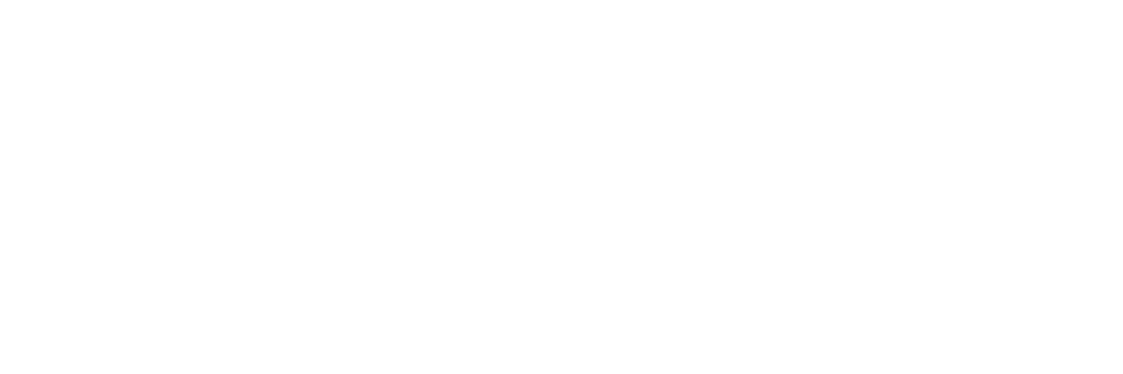Le trauma psychique « n’est pas simplement une blessure qui laisse une cicatrice. L’expérience traumatique transperce la psyché. Telle l’épine d’une rose, quelque chose d’essentiel se détache de l’expérience vécue et se loge, douloureusement, dans la psyché et dans l’âme » de la personne traumatisée ([ma traduction] McDonald, 2023, p. 137).
Cette définition du trauma éclaire certains aspects essentiels de la phénoménologie du trauma de la philosophe et thérapeute Mary-Catherine McDonald, tout en en laissant d’autres dans l’ombre. La phénoménologie permet en effet de révéler précisément comment le trauma « se loge » dans l’expérience vécue d’une manière différente d’une cicatrice sur la peau. Ainsi, elle met en lumière les multiples façons dont le trauma s’incruste dans l’existence, dans la durée, de manière protéiforme (son expérience varie d’une personne à l’autre) et souvent totalisante (plusieurs aspects du vécu se transforment). Cette définition ignore néanmoins deux composantes expérientielles importantes qui se retrouvent au cœur de l’approche de McDonald, soit la corporéité et l’adaptation. McDonald élabore, dans Merleau-Ponty and a Phenomenology of PTSD : Hidden Ghosts of Traumatic Memory (2019), une phénoménologie du trauma héritière de la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty (1945), au cœur de laquelle se trouve la relation constitutive entre le corps perceptif et le monde1. Le trauma en tant qu’expérience subjective déstabilise le schéma corporel et altère la perception qu’un·e se fait d’un monde qui apparait, dans certains cas, sous une couleur nouvelle, celle d’une violence ponctuelle ou structurelle. Face à ce monde dont « l’horizon de sens » est dérouté (McDonald, 2019, p. 33), l’autrice situe le trauma comme processus « adaptatif » (p. 55) : c’est parce qu’il permet à l’être incarné de s’ajuster à son environnement, parfois violent, que le trauma est un phénomène enraciné dans « la force et non la faiblesse » humaine, thèse au centre de son dernier ouvrage, Unbroken : The Trauma Response is Never Wrong (2023).
Cet article défendra la thèse selon laquelle les traumas de la violence sexiste et sexuelle s’insèrent dans un continuum de violences sociales qui impacte préalablement l’expérience vécue des femmes et des minorités sexuelles, continuum qui agit sur certaines réactions traumatiques qui doivent être intégrées à une phénoménologie du trauma. Le retour de la violence, par exemple, n’est pas conçu comme adaptatif dans un spectre de réactions traumatiques, au même titre que la mémoire traumatique, dans la phénoménologie de McDonald. En psychotraumatologie, le retour de la violence est bien souvent analysé sous le couvert d’affects (colère, jalousie) et difficilement intégré au vécu traumatique2. La défense de soi reste cependant prévisible, voire rationnelle – en ce sens qu’elle est une réponse logique à la cause du trauma – dans des contextes où la violence (guerrière, sexiste, raciste, etc.) assure une médiation entre les corps et le monde qui change la perception de ce dernier à travers le filtre du trauma. C’est à partir d’exemples pour la plupart issus de contextes du Nord global et de populations blanches que j’élabore une phénoménologie féministe du trauma qui prend en compte le retour de la violence et certains affects du trauma (la rage) pour saisir toute l’étendue des conséquences de la violence de genre sur nos corporéités et nos devenirs dans le monde. C’est en vertu de l’influence de la culture sur l’expérience traumatique que je considère que les réactions traumatiques peuvent aussi être culturellement déterminées. Le vécu traumatique varie en fonction du contexte social, historique et politique, ainsi qu’en fonction des déterminants sociaux qui nous situent dans le monde, et c’est pour attester des multiples facteurs traumatogènes qui influencent le vécu traumatique qu’est né le concept de traumatisme complexe, un type de trauma survenant suite à « des situations chroniques de violence, d’abus ou de négligence […] qui engendre des difficultés persistantes aux plans identitaires, émotionnel et relationnel » (Milot et al., 2021, p. 69).
Alors que la violence des femmes reste encore une donnée taboue – elle est au mieux abordée sous un « mode présence/absence » au sein des sciences humaines et sociales, au pire totalement « déniée » (Cardi et Pruvost, 2011) – son étude via la phénoménologie du trauma nous apparait essentielle dans une perspective féministe. Je défendrai, d’abord, que les phénoménologies féministes ont démontré qu’une mémoire corporelle et affective du sexisme préexiste toute forme de mémoire traumatique chez les personnes dont les corps en sont la cible, une mémoire qui influence une corporéité différente que dans d’autres types de traumas (Bartky, 1990 ; Beauvoir, 1949 ; Brisson, 2002 ; Dorlin, 2017 ; Kelly, 1988 ; Lieber, 2008 ; Lorde, 1984 ; Vera-Gray, 2017 ; Young, 2005). Ensuite, j’aborderai le fait que les multiples continuums de la violence sexiste (qu’elle soit exercée dans les sphères publique ou intime) ne prennent pas fin avec le trauma. Autrement dit, la violence ressort la plupart du temps, et une phénoménologie du trauma doit pouvoir se saisir de ces rapports cycliques. J’étudierai finalement deux voies d’extériorisation des traumas de la violence sexiste et sexuelle, soit via la rage (affects) et via la violence agie (gestes), ce qui permettra de saisir les propriétés politiques (à portée collective et instrumentale aux luttes) de ces réactions traumatiques.
Les phénoménologies du trauma
La phénoménologie du trauma, malgré des racines dans la psychanalyse (Ferenczi, 1927, 2006 ; Freud, 1920, 1926) et dans la psychologie phénoménologique d’Abram Kardiner (1941), est relativement récente au sein de la discipline phénoménologique. Chez Robert Stolorow, psychanalyste précurseur en phénoménologie du trauma, l’expérience traumatique est définie par deux éléments fondamentaux : les affects envahissants et souvent « insupportables » (unbearable) du trauma ; ainsi que la perte d’ancrages relationnels (relational home) permettant de relier l’expérience traumatique au reste de l’expérience vécue (2007, p. 10)3. Plus récemment, la philosophe Natalie Depraz suggère une autre voie phénoménologique et psychanalytique, soit l’étude du trauma comme « surprise radicale » dans l’expérience. La surprise permettrait en effet d’étudier le trauma dans toutes ses dimensions temporelles, soit ce qui précède le choc (les affects antérieurs), le « pendant » (la « brèche » ouverte dans l’expérience), ainsi que l’après (les effets du trauma sur l’expérience, le « traumatisme » en soi) et d’appréhender ainsi le trauma comme « processus » et non comme « évènement » (Depraz, 2016, p. 132). Si les phénoménologies ont historiquement contourné les racines structurelles de certaines formes de trauma (i.e. les violences raciales, les violences sexistes et sexuelles, la pauvreté, etc.), certaines ont toutefois démontré comment le vécu de l’oppression et de ses formes quotidiennes de violences systémiques peut mener à des traumas distincts dans leurs emprises sur le corps, ainsi que dans leurs effets sur l’agentivité et la subjectivité de celles et ceux qui en font l’expérience. Parmi celles-ci, l’œuvre psychiatrique et philosophique de Frantz Fanon a révélé comment la violence raciste et coloniale « sécrète » ses propres névroses traumatiques (1961, p. 242). Chez Fanon, c’est la violence coloniale à la base des traumas collectifs qui sera instrumentalisée comme arme dans la révolte des colonisés : les marques mnésiques de la violence (le trauma) ouvrent la voie à une libération collective, mais uniquement dans le passage obligé de la violence collective. Plus récemment, c’est la phénoménologie de la proie d’Elsa Dorlin qui inspire une théorie similaire pour penser la résistance à l’oppression des « vies sur la défensive » (2017, p. 212). Sa phénoménologie des violences raciales et sexistes contemporaines illustre comment certains groupes vivent dans un monde de prédation et adoptent des pratiques défensives pour survivre dans des sociétés qui les « chassent [d’un] monde » habitable, « jusqu’à un point où la violence subie ne peut que devenir une violence agie » (p. 198). Considérant que les phénoménologies du trauma ne théorisent pas, ou seulement indirectement, l’agir violent (comportements agressifs, rage, colère, violence physique et psychologique) comme faisant partie des réactions « adaptatives » du trauma, une phénoménologie de la violence sexiste comme celle de Dorlin analyse comment certains corps sont poussés à se défendre pour survivre à l’aide d’une violence retournée. Ces contributions théoriques sont selon moi indispensables pour penser une phénoménologie féministe du trauma.
La mémoire traumatique, la « confiance-au-monde » et le genre
La mémoire traumatique est centrale dans la phénoménologie du trauma selon Mary-Catherine McDonald, parce qu’elle influence notre perception du monde et nos comportements. Les différentes façons dont le monde affecte un individu sont répertoriées par la mémoire sous forme de souvenirs sensoriels (olfactifs, visuels, auditifs, etc.) et cognitifs (représentables dans la conscience) qui orientent continuellement nos comportements, de manière positive ou négative. La mémoire traumatique, parce qu’elle opère sur un mode différent de la mémoire non-traumatique, conditionne les comportements de trois façons différentes, qui sont originellement adaptatives, mais qui peuvent devenir mésadaptatives dans le temps. Je précise toutefois que la mémoire traumatique fait partie d’un spectre de réactions normales de l’humain dans l’expérience du trauma : une conception adaptative du trauma refuse donc la distinction binaire entre la normalité et la pathologie.
Premièrement, la mémoire traumatique transforme le rapport au temps en fracturant la chronicité des évènements traumatiques. C’est pourquoi la mémoire traumatique est souvent définie comme la « reviviscence » du trauma – c’est-à-dire que le choc est revécu, aux niveaux corporel et psychique, souvent sans possibilité de rationalisation ou contextualisation – plutôt que par le « souvenir » (Van Der Kolk, 2014, p. 65). Florence Vinit et Anne-Sophie Therrien-Binette s’attardent à deux conséquences de la mémoire traumatique, soit l’impression de « pétrification » du temps vécu (revivre continuellement le trauma donne l’impression d’un temps stagnant) et son impact sur la confiance dans le monde (2022, p. 246)4. En effet, la reviviscence peut exacerber un sentiment d’insécurité dans les espaces qui composent notre monde, sentiment parfois superposé à une insécurité existentielle pour certains groupes (dont ceux vivant l’oppression quotidienne du sexisme) :
Nous ne faisons pas directement l’expérience de cette confiance, mais elle fait pourtant partie de la toile de fond de notre expérience quotidienne. C’est seulement lorsqu’elle fait défaut comme dans l’expérience traumatique que le monde nous apparait soudain comme intimidant, peu sûr, imprévisible ou menaçant. Lorsque notre capacité d’anticipation adopte ce mode, le sentiment d’être en sécurité dans le monde et d’y être « chez soi » se dissipe ([mes italiques] p. 247)
Deuxièmement, McDonald définit la mémoire traumatique comme avant tout affective et sensorielle parce que les mécanismes neurobiologiques qui en sont responsables altèrent les connexions entre la mémoire implicite (émotive) et la mémoire explicite (cognitive). C’est un des multiples mécanismes adaptatifs du trauma qui permet aux fonctions primaires du corps (les fonctions « de survie ») de prioriser la réaction au danger plutôt que la rationalisation des évènements (McDonald, 2019, p. 24). C’est ce qui explique, entre autres, la difficulté pour certaines victimes d’évènements traumatiques violents (comme des violences sexuelles) à raconter de manière représentable leur trauma5. Finalement, le poids de la mémoire traumatique se manifeste par la diminution du contrôle sur les émotions, d’une part parce que la reviviscence s’accompagne souvent de sensations déplaisantes non désirées ; d’autre part, parce que lors du choc traumatique, le cerveau produit des hormones réactives à la menace qui peuvent influencer durablement les comportements de la victime (McDonald 2019, p. 26). Faire l’expérience d’un quotidien violent peut entrainer des réponses agressives ou violentes à des situations menaçantes et non menaçantes pour la victime parce que le trauma, jumelé au climat de peur, vient brouiller les frontières de la confiance dans le monde. Nicky Carthy et al., ont étudié les émotions liées aux traumas chez des femmes victimes de violence conjugale pour montrer comment l’exposition prolongée à des violences répétées, voire à un climat de violence continuelle et de « terreur » (Herman, 1997) comme dans certains contextes de violence intime modifie la « stratégie protectrice » des survivantes (Carthy et al., 2022). Leur étude explique notamment que si certaines femmes interprètent leurs gestes violents comme une expression de leur colère contre leur agresseur, d’autres conçoivent leurs actions « comme une forme d’autodéfense » (p. 334). Faire l’expérience d’un quotidien violent peut entrainer des réponses agressives ou violentes à des situations menaçantes et non menaçantes pour la victime parce que le trauma, jumelé au climat de peur, vient brouiller les frontières de la confiance dans le monde.
Alors que ces dispositions du trauma sont essentielles dans l’immédiateté du choc, elles peuvent devenir destructrices si elles se prolongent dans le temps. La production inutile et excessive de cortisol (une hormone produite par le cerveau en réaction à une menace), par exemple, peut mener à une régulation déficiente du stress, voire à des problèmes physiologiques sérieux comme des troubles digestifs et cardiaques6. Ces fonctionnalités de la mémoire traumatique peuvent aussi contribuer à faire perdurer l’hypervigilance et la dissociation chez les victimes d’actes violents et traumatiques (Salmona, 2018), ainsi que des réactions émotives incontrôlables et parfois disproportionnelles face à leur environnement (Herman, 1997)7.
C’est le cas pour beaucoup de femmes et de personnes opprimées et traumatisées par la violence de genre, cette dernière transformant radicalement l’expérience corporéisée qu’on fait de notre monde. Les philosophies féministes ont d’ailleurs contribué depuis maintenant plusieurs décennies à construire un cadre théorique permettant de saisir le vécu charnel et perceptif d’un monde genré dans un corps sexué et oppressé (Ahmed, 2006 ; Bartky, 1990 ; Beauvoir, 1949 ; Brisson, 2002 ; Dorlin, 2017 ; Kelly, 1988 ; Lieber, 2008 ; Lorde, 1984 ; Provost, 2023 ; Vera-Gray, 2017 ; Young, 2005). Audrey Lorde (1984) et bell hooks (1995, 2002), entre autres, ont écrit sur l’expérience de d’insécurité permanente et de vulnérabilisation extrême des femmes noires aux États-Unis, mais aussi sur la rage justifiée de ces dernières en face des violences sexistes et raciales endurées collectivement. Liz Kelly, Sandra Bartky, Marylène Lieber et Elsa Dorlin ont théorisé ce que les violences sexistes et sexuelles « font » aux corps des femmes, des corps qui doivent être perpétuellement sur la défensive. Selon Fiona Vera-Gray, c’est entre autres le « continuum de la violence sexuelle » (du harcèlement de rue et les micro-agressions quotidiennes subies par les femmes et les minorités de genre dans les lieux publics, aux viols et aux féminicides) qui détermine des manières d’habiter un corps et un monde typiquement « femme » ; c’est-à-dire conditionné par une impuissance résultant d’une socialisation genrée apprenant aux filles non seulement à cultiver la peur entre elles, mais aussi à ne pas se défendre (2017, p. 131).
S’intéresser à la corporéité des femmes, de celles qui ont été assignées dans ce genre à la naissance ou de celles qui se revendiquent comme telles, montre toute autre chose [qu’un corps s’effaçant derrière la subjectivité]. L’hypervigilance tend le corps de celle qui a été violée et ne parvient plus à marcher sereinement dans un lieu public ; la restriction alimentaire s’impose chez la jeune mère qui cherche à retrouver son corps d’avant la grossesse ; le sentiment d’obligation s’immisce chez l’épouse qui accepte un rapport sexuel parce qu’au bout d’un moment « il faut bien le faire » (Vinit et Thiboutot, 2022, pp. 2-3).
Le sexisme façonne donc les vies des femmes, leurs pratiques d’aménagement du quotidien et leur défense de soi. À la fois intériorisées et à fleur de peau, les violences directes et indirectes du sexisme altèrent non seulement nos rapports avec nous-mêmes, mais aussi avec le monde tel qu’il nous apparait. En effet, Sara Ahmed explore dans Queer Phenomenology comment les oppressions racistes et sexistes structurent les espaces communs (publics) de manière que certains corps – blancs, masculins et hétéronormatifs en l’occurrence – s’y sentent par défaut « à la maison », et que d’autres s’y sentent « étrangers », voire en danger (2006, p. 132). Comment, à l’aune de ces considérations, la transformation de la confiance-au-monde par le vécu de la violence de genre ébranle-t-elle une phénoménologie féministe du trauma8 ?
La violence comme réaction traumatique
Dans le chapitre « Malcom’s Fight Club » de Unbroken, Mary-Catherine McDonald décrit le suivi thérapeutique qu’elle a effectué auprès d’un vétéran américain des guerres en Irak et en Afghanistan ; Malcolm (prénom fictif). Celui-ci a « survécu » à plusieurs déploiements et a assisté à la mort de plusieurs membres de son bataillon ; plusieurs amis. Sa carrière au sein de l’armée étant terminée depuis plusieurs années, il témoigne des étapes de guérison par lesquelles il est passé : les cauchemars, l’insomnie, l’alcoolisme, les « flashbacks traumatiques qui le précipitaient dans des accès de rage contre des membres de sa famille » et les pensées suicidaires sont maintenant, en bonne partie, derrière lui (McDonald, 2023, p. 24). Toutefois, une « pratique » singulière demeure ; son club de combat. Plusieurs soirs par semaine, Malcolm rencontre d’autres vétérans dans un endroit secret pour se battre jusqu’à ce qu’un d’entre eux abandonne ou tombe inconscient : « Malcolm était bien de retour à la maison, mais il était toujours en guerre – en guerre contre lui-même, contre sa femme, contre des étrangers. Malcom était traumatisé », conclue McDonald (p. 25). Ce cas fait écho à un autre évoqué par McDonald, un vétéran, X, démontrant des comportements violents au retour de la guerre, cette fois-ci contre sa femme : « une fois, je l’ai jetée du lit si fort qu’elle s’est cassé l’épaule […]. Une autre nuit, j’ai cru qu’elle était [l’ennemie] et j’ai mis mes mains autour de sa gorge avant de me réveiller » (McDonald 2019, p. 34)9. Dans le premier cas, le recours à la violence s’explique par la perte de sens face à sa propre survie dans un contexte (la guerre) où la mort aurait eu plus de sens, ainsi que par la honte – un élément central, mais tout aussi genré du vécu traumatique – et la culpabilisation d’avoir survécu alors que ses proches sont morts. Dans le deuxième cas, c’est la mémoire traumatique qui provoque la perception erronée du danger et qui adapte le quotidien du vétéran au quotidien de la guerre. Le monde dans lequel le vétéran a miraculeusement survécu n’a plus de sens pour lui : seule la violence a du sens, même si elle le détruit de l’intérieur :
L’enjeu n’est pas que celui-ci tente de comprendre un monde qui n’existe pas objectivement et qui est en conséquence faux. Le problème est en fait l’opposé. Le monde dans lequel ce soldat pourrait être attaqué existe ; c’est ce monde, le même dans lequel il vit. Il réagit en fait au monde que l’expérience du trauma a créé pour lui [et] l’horizon de ce monde est devenu dangereux. ([ma traduction] McDonald 2019, p. 34)
Le trauma est réellement une « surprise », une fissure dans le schéma corporel antérieur du vétéran, une cassure de son monde prétraumatique. X, de retour dans un environnement en apparence sécurisant – dans son foyer, auprès de sa femme – fait l’expérience d’un autre front : celui de la mémoire traumatique, qui transforme son expérience vécue. Mais X et Malcolm voient leurs mondes chamboulés d’abord à cause d’un dénominateur commun entre leurs expériences vécues : une confiance dans le monde dont tous et toutes n’ont pas le luxe.
En effet, Malcolm se soumet volontairement à une reproduction de la violence de la guerre parce que le monde dans lequel il se retrouve miraculeusement vivant ne fait plus de sens ; ce n’est qu’en se rapprochant un peu plus de la mort et en se « punissant » que son monde déformé par le trauma lui apparait plus vivable. Mais le monde auquel une victime d’agression sexuelle fait face à travers le trauma n’est pas nécessairement insensé. Le trauma supposé changer l’horizon du monde en révèle en fait la charpente sur laquelle il a toujours été érigé, c’est-à-dire une violence sexiste qui régule les rapports de genre et qui fait du viol une réalité toujours à la fois au-dessus de nos têtes (dans la connaissance que beaucoup d’autres femmes en feront l’expérience) et en attente dans notre corps (dans l’appréhension rationnelle d’en faire l’expérience un jour). Plutôt que de produire des réactions traumatiques qui deviennent mésadaptatives dans le temps, ces dernières se trouvent alors alignées avec la réalité prétraumatique des femmes dans un monde sexiste, de sorte que le trauma dévoile l’horizon réel de ce monde, et ajuste le schéma corporel à ce réel. Cet ajustement ne peut toutefois pas simplement être lié aux fonctions de la mémoire traumatique, dans ce cas conjointe de la mémoire corporéisée de la violence sexiste, mais aussi d’autres réactions traumatiques – non considérées comme telles – comme l’autodéfense ou le retour de la violence. La violence traumatique telle que nous l’avons définie – cette extériorisation d’une violence emmagasinée dans le corps qui s’aligne désormais avec l’horizon traumatique du monde – ne détient alors plus les mêmes fonctions dans l’expérience du trauma genré de la violence sexuelle. Bien que la violence traumatique sur les champs de bataille soit elle aussi bien réelle, et corolaire d’autres formes de violence sociale et d’oppression, les traumas de guerre sont le résultat d’une violence temporalisée qui ne s’intègre pas de la même manière au mode de vie que le fait la violence sexiste chez les femmes. Plutôt qu’une réponse pathologique à un monde quotidiennement sécuritaire dans le cas du vétéran de guerre de retour à la maison, le retour de la violence par les victimes de violence sexuelle apparait en creux comme une réaction physiologique et rationnelle à un monde dont la violence endogène envers les femmes est désormais impossible à ignorer. Le trauma dévoile en fait l’horizon de sens réel d’un monde sexiste, et la violence y est une réponse sensible, adaptative.
Si les traumas de la guerre constituent en majorité le fond expérientiel de la phénoménologie de McDonald, elle aborde tout de même d’autres types de vécus traumatiques, comme ceux issus de la violence de genre. Dans l’article Hysterical Girls : Combat Trauma as a Feminist Issue, elle formule en effet une critique féministe des études sur le trauma via sa théorie de l’adaptation, critique dans laquelle les traumas de guerre (« combat trauma ») se retrouvent une nouvelle fois au centre de son argumentaire. Selon McDonald, c’est « l’idée fondamentalement sexiste selon laquelle la réponse traumatique est un signe de faiblesse – réponse conçue comme un échec typiquement relié à la féminité » qui, via des stéréotypes et des stigmas négatifs sur le trauma, est responsable de l’oppression psychologique des personnes traumatisées ([ma traduction] 2018, p. 16). Si cette oppression est le reflet de l’oppression du sexisme vécue par les femmes, il semble que la phénoménologie féministe fournit un apport théorique considérable pour subvertir la définition du trauma et en faire une forme d’adaptation.
« Le viol est toujours en arrière-plan de la vie d’une femme »
Trente pourcents des femmes dans le monde ont été, sont ou seront victimes de violence physique et/ou sexuelle durant leur vie. La violence sexuelle survient le plus souvent dans le cadre d’une relation intime et plus de 30 % des féminicides sont commis par des partenaires ou ex-partenaires intimes10. La potentialité du viol, de même que d’autres types de violences sexistes « ordinaires » et banalisées (le harcèlement de rue, les attouchements non désirés dans les lieux publics, la violence psychologique dans les sphères intimes, les « infra-violences », etc.) détermine ainsi comment les femmes habitent leur corps et vivent leur rapport au monde à travers celui-ci. C’est dans une entrevue en 2023 que la philosophe Susan J. Brisson explique « l’arrière-plan » de son livre Aftermath : Violence and The Remaking of Self (2002) qui raconte son viol brutal lors d’une banale promenade alors qu’elle était en vacances avec son mari : le viol, nous dit-elle, ou d’autres formes d’agressions sexuelles aux mains d’un étranger ou d’un proche, surplombe en quelque sorte l’être-au-monde féminin, et peut s’introduire par de multiples voies dans l’expérience11. En fait, la violence sexiste, et de surcroît sa forme sexuelle, est à ce point ancrée dans la corporéité féminine qu’elle a été théorisée comme traumatogène en soi par la psychologue Maria P. Root. C’est par le concept de « trauma insidieux » (insidious trauma) que cette dernière a catégorisé la présence incarnée et métaphysique de la violence sexiste (la connaissance que plusieurs personnes dans nos entourages ont subi cette violence) dans nos vies quotidiennes, une catégorie qui prend son origine dans les traumas de la violence genrée, mais qui peut s’appliquer à d’autres formes de violences (Root, 1992).
C’est précisément en raison du caractère ordinaire et largement répandu de la violence sexuelle que son versant traumatique fait autant partie du quotidien des femmes : c’est aussi pour cette raison qu’une phénoménologie du trauma doit considérer la prédation masculine et l’attente du viol dans la compréhension de l’expérience du trauma sexuel et les réactions traumatiques qui lui sont propres. La phénoménologie éclaire a priori comment les individus n’existent jamais coupés du monde, via un rapport corporéisé à celui-ci qui nous permet de naviguer dans notre quotidien en confiance ou non. La confiance dans le monde conditionne quant à elle une manière d’habiter ce dernier qui ne nous fait pas toujours anticiper le pire. La différence, toutefois, dans le cas de la violence faite aux femmes, et particulièrement la violence sexuelle – qui ne discrimine pas à travers les genres, la race, les classes, les âges, les antécédents relationnels, etc. – se situe dans la superposition de cette mémoire traumatique à la mémoire corporéisée de la violence sexiste. En prenant en compte le caractère insidieux de la violence sexiste et sexuelle dans la vie des femmes, il apparait qu’une phénoménologie « adaptative » du trauma comme celle de McDonald doit elle-même être adaptée à cette réalité expérientielle. Le vécu quotidien d’une prédation continuelle prépare le terrain pour le trauma, les violences ordinaires s’intégrant d’ores et déjà à la corporéité féminine en déstabilisant la confiance dans le monde : « ce sont des expériences auxquelles les femmes s’adaptent ; des potentiels pour lesquels les femmes font de la place dans leur vie et leur psychisme », écrivait la collègue de Root, Laura S. Brown dans Not Outside The Range ([mes italiques], [ma traduction] 1991, p. 121). En tant que femme, je sais que la violence sexuelle m’attend : je le sais parce que trop de femmes dans mon entourage en ont fait l’expérience, parce qu’elle est omniprésente et banalisée dans la culture, dans les discours politiques, dans les espaces publics, et parce qu’elle reste impunie la plupart du temps.
Phénoménologie du trauma : phénoménologie du corps armé
Elsa Dorlin élabore sa « phénoménologie de la proie » à partir du récit Dirty Weekend, fiction gore féministe publiée en 1991 par Helen Zahavi qui raconte le weekend meurtrier d’une jeune femme (Bella) en Angleterre, à la suite de son agression par un voisin. La mise en récit de la vie banale d’une jeune femme sert d’assise à cette phénoménologie du quotidien sous le patriarcat, un quotidien fait d’agressions continuelles des plus « ordinaires », de la part des hommes les plus « ordinaires » (Dorlin, 2017, p. 193) jusqu’à l’évènement qui déclenchera la « rage meurtrière » en apparence « gratuite, irrationnelle et sans limite » de Bella, le jour où elle décidera de tuer son voisin et tous ceux croisant son chemin (p. 191).
L’agression, loin de marquer un point de rupture dans l’itinéraire d’une vie sans histoires, n’est en fait que le révélateur de ce que les expériences continuées de la violence ont déjà abîmé, marqué dans le corps de Bella. Elles ont constitué son corps propre, son rapport au monde, ont charpenté la façon même dont ce monde lui apparait, la touche ; elles ont modelé la façon dont son corps habite, affecte ce monde et s’y déploie. Il n’y a donc pas de retour possible à une vie ante-agression. (pp. 193-194)
La dynamique entre l’intériorisation et l’extériorisation de la violence vécue est au cœur du vécu traumatique. En ce sens, le trauma est donc aussi la présence résiduelle de la violence corporéisée, et son extériorisation, soit à travers des affects traumatiques (colère, rage), soit via des comportements autodestructeurs (mutilation, soumission à la violence d’autrui) ou dans sa forme « originelle » (l’agir violent), ne peut être écartée d’un spectre de réactions traumatiques. Si la phénoménologie de la proie n’est pas à proprement parler une phénoménologie du trauma, elle décrit en tous points la mémoire corporéisée de l’oppression sexiste dont nous avons dessiné les contours plus haut, et davantage. Elle rend compte du « scepticisme existentiel » d’une vie de victime (p. 193) et de « ce que ça fait d’être une femme » dans un monde de prédation masculine (p. 195). Bella n’a pas de diagnostic de trauma, mais elle vit « tapie » dans son appartement, « rétrécissant » de jour en jour son espace vital pour éviter les agressions jusqu’à l’explosion ; elle s’épuise à anticiper les moindres mouvements de son voisin violent (hypervigilance) ; et elle passera à l’acte de manière détachée, froide, voire dissociée. Bella subit quotidiennement le « travail sourd de la violence » dans ses muscles et dans sa psyché, procession lente de l’oppression adaptant son schéma corporel à son réel invivable (Dorlin, 2017).
La phénoménologie de la proie de Dorlin met en scène ce qui peut advenir lorsque la « patience charnelle » d’une femme vient à terme ; lorsque l’horizon violent du monde s’impose au « déni existentiel » qui est propre au fait d’être une proie ; ou lorsque la reviviscence du trauma est trop puissante. « Tout se passe comme si un mouvement ou, plutôt, une tension à l’échelle même d’un muscle dont [on ignorait] encore l’existence s’était petit à petit manifestée, avait fécondé un petit noyau de rage compact » (pp. 195-196) : alors, la mémoire corporelle de la violence sexiste opère un renversement de l’impuissance acquise en action, et la rage meurtrière se répercute sur le monde à la source du trauma. C’est dans l’éruption de la colère, d’une rage féminine partagée entre plusieurs corps, que le corps de Bella se trouve alors armé de sa violence traumatique. Dorlin insinue en effet que la subversion de sa propre colère permet à Bella de ne pas « déléguer » son auto-défense à une tierce personne ou objet – comme un homme ou une arme létale : en d’autres termes, la seule personne pouvant « restaurer l’intégrité corporelle […] de la victime » est… elle-même (2017, pp. 180-181). Dirty Weekend présente ainsi une femme qui est certes l’agente de sa propre défense, mais aussi, dans une brillante subversion des représentations de genre, l’objet et le sujet de sa violence. J’ajouterais que c’est précisément l’enjeu au cœur d’une phénoménologie du trauma qui se veut féministe : prendre au sérieux les fonctions de la violence sexiste dans tout son déploiement – dans les sphères publique et intime, dans les corps et les affects, dans les traumas individuels et collectifs qu’elle engendre – implique aussi de comprendre ce que les personnes subissant cette violence font de celle-ci, et comment elles peuvent se subjectiviser à travers le vécu traumatique de la violence sexiste et sexuelle. Une phénoménologie du trauma féministe doit aussi analyser comment l’utilisation de la violence traumatique peut passer du personnel au politique, une avenue laissée en suspens dans la phénoménologie de la proie. Je suggère de distinguer à partir de la phénoménologie de la proie deux réactions traumatiques dont les ancrages corporéisés sont individuels mais qui possèdent une portée politique lorsque collectivisés : la rage et la violence cyclique.
Bien que la rage ne laisse pas nécessairement place à la violence dans le vécu traumatique, ces deux réactions sont souvent conjointes ou confondues, de surcroit dans des contextes de réactions à l’oppression. « J’ai ressenti une ‘rage de tuer’ (killing rage). Je voulais le poignarder doucement, lui tirer dessus avec le pistolet que je pensais avoir dans mon sac à main. Et en observant sa douleur, je lui dirais tendrement ‘le racisme fait mal’ « raconte bell hooks dans Killing Rage : Ending Racism, suite à la discrimination raciale dont est victime son amie dans un avion (1995, p. 11). Cette rage, lorsqu’elle prend une forme politique, « militante », est soit diabolisée et sévèrement réprimée (dans le cas d’émeutes suite aux meurtres de citoyens noirs, par exemple), ou pathologisée et marquée du sceau de l’impuissance (même par des experts racisés), ou encore confondue avec d’autres affects mieux récupérables politiquement (comme l’amour)12.
Dans « Though Breaks : Trans Rage and the Cultivation of Resilience », Hil Malatino suggère, à partir de perspectives trans et féministes, une conception de la « rage trans » comme un affect politique aux propriétés non seulement préservatrices, mais aussi « transformatrices » et « bâtisseuses » de mondes « vivables » (2019, p. 122). C’est précisément en raison des vertus à la fois destructrices et transformatrices de la rage collective que celle-ci est menaçante pour les institutions dominantes, et c’est pourquoi ces dernières bénéficient souvent de la mise sous tutelle de la rage individuelle (ce à quoi contribuent les institutions soignantes en misant sur la compression de la colère et la régulation des émotions traumatiques en vue de la guérison). C’est aussi en raison de son lien avec le trauma, individuel et collectif, que la rage a été historiquement reléguée à un diagnostic « problème », et qu’elle a été la plupart du temps individualisée dans ses différentes manifestations (sautes d’humeur, cris, agressivité physique et verbale) pour être mieux traitée et matée. Malatino soulève qu’au sein de la littérature thérapeutique populaire, la rage est conçue comme « ce qui protège le sujet de l’impact psychique total du traumatisme ; c’est un masque dissimulateur qui détourne l’attention de la blessure profonde, qui soutient l’idée d’un sujet inviolable, impénétrable » ou un affect médiateur du trauma qui doit être contrôlé pour préserver la structure psychique de la personne ([ma traduction] 2019, p. 122)13. En fait, la rage indique la violence subie et l’expérience de l’oppression : c’est sa retenue dans le corps et sa répression par les pouvoirs en place qui mettent en danger la structure psychique des personnes traumatisées, bien davantage que son extériorisation et sa mue en arme collective de résistance14.
Si les « rages » noires et trans ne sont pas les produits des mêmes expériences d’oppression que celles de la violence sexiste – bien que ces oppressions se renforcent lorsqu’elles sont intersectionnelles – elles puisent toutefois dans les affects propres aux injustices sociales auxquelles la résistance doit être collective. La rage « traumatique » doit donc être comprise dans les retournements sémantiques et subjectifs qu’elle est capable d’opérer pour qu’apparaissent ses qualités politiques. Elle peut faire irruption dans certains moments non menaçants ou inopportuns à cause des effets de la mémoire traumatique, ce qui en fait une émotion crainte autant par les victimes de trauma que par leurs entourages parce qu’elle ne s’annonce pas toujours. Mais c’est cette même propriété éruptive, pulsionnelle, « spontanée » (Fanon, 1961) qui en fait aussi un affect collectif formidable, un carburant à des mouvements de résistance qui peuvent confronter les pouvoirs et les institutions et remettre en question l’adéquation entre rage et impuissance individuelle15. C’est précisément en vertu de son ancrage dans les traumas collectifs que la rage est puissante, parce qu’elle émerge de blessures psychiques et charnelles qui troublent une régulation des affects essentielle au maintien du statu quo, et qui nourrissent ainsi les sursauts potentiels de corps rassemblés dans la souffrance.
Les femmes ont historiquement vu leur violence être soit biologisée et pathologisée (associée à l’hystérie ou à d’autres dysfonctions liées à leurs fonctions reproductives), soit mise sous tutelle de la domination masculine (une violence « subordonnée » à celle des hommes qui restent « le véritable bras armé » de la violence sociale (Cardi et Pruvost, 2017, p .44). Mais voilà : le trauma de la violence sexiste et sexuelle, présence résiduelle et insidieuse dans le corps, hante à ce point les vies des femmes, que la potentialité du retour de la violence traumatique, dans une action non « entamée » – c’est-à-dire directe et propre au sujet de cette action (p. 34) – reste elle aussi insidieuse, toujours au-dessus de nos têtes. La corporéité du trauma a cela de singulier : elle exprime dans ses faces affective, corporelle, psychique et politique le lien constitutif entre le corps et les violences qui structurent nos sociétés. Et la violence est essentiellement dynamique, c’est-à-dire que son intériorisation sous forme traumatique implique un retour possible, parfois comme forme d’autodéfense, même lorsque la menace n’est pas immédiate.
Une phénoménologie du trauma qui intègre le retour de la violence dans un spectre de réactions traumatiques laisse entrevoir un corps armé de ses propres capacités plutôt qu’une agentivité défensive déléguée. Est-ce dire que la violence est le seul armement possible, et qu’une résistance qui puise à même ses résidus traumatiques doit s’incarner de façon violente – par la vengeance, l’agression physique, voire le meurtre ? Le vécu traumatique n’implique pas en soi le retournement de la violence, et il est moralement difficile de toujours justifier la violence traumatique par son mouvement cyclique16. La violence dans sa forme originelle, c’est-à-dire celle encaissée par les corps opprimés auxquels on nie la possibilité d’exprimer leur rage, n’est selon moi pas une voie envisageable pour mettre fin à l’oppression sexiste, mais c’est là un débat nourri depuis longtemps en philosophie politique et en pensée féministe. Alors que certain.es ont suggéré que la défense violente ne peut être une réaction, même traumatique, souhaitable à l’oppression si on prend au sérieux l’utopie féministe d’un monde non-violent (Butler, 2020), d’autres reconnaissent que la non-violence « use les corps qui y sont engagés » parce que ceux-ci « [incarnent] un type de résistance dont la condition de possibilité est l’abnégation absolue, la résistance illimitée et l’oubli de soi (ne jamais réagir) » (Dorlin, 2017, p. 149). Il nous faut aussi reconnaître que tout comme la rage, la violence possède des propriétés politiques certaines. En effet, elle peut, tel que le concevait Fanon dans sa phénoménologie de la violence coloniale, défaire les conditions d’émergence de la violence structurelle (celle des régimes oppressifs) lorsqu’elle prend des proportions révolutionnaires ; lorsque les corps traumatisés s’assemblent et refusent une adaptation factice, basée sur la répression d’affects négatifs et d’une violence « à fleur de peau » (Fanon, 1961, p. 57).
Si retour de la violence il y a, c’est dans une forme collective, canalisée dans une « restructuration radicale de l’ordre sociopolitique » de la société, qu’elle est la plus efficace (FitzGerald, 2022, p. 12). Maggie FitzGerald enjoint une phénoménologie de la violence et du trauma d’inspiration fanonienne aux éthiques du care pour suggérer que dans les cas où la violence est une réponse du trauma, elle doit être suivie du soin, individuel ou communautaire (rassemblements, décharges émotives, thérapies, etc.). C’est aussi ce que je suggère Malatino : le travail transformateur de la rage n’a pas la même portée politique s’il n’est pas encadré par des pratiques de care qui permettent aux personnes traumatisées de forger leur résilience et de persister. Une phénoménologie féministe du trauma doit ainsi considérer comment certaines réactions traumatiques – comme la rage et la violence cyclique – peuvent à leur tour être traumatogènes et mettre en péril les processus de guérison, même lorsqu’elles sont adaptatives.
Conclusion
C’est à partir de la phénoménologie adaptative du trauma de Mary-Catherine McDonald que j’ai suggéré une phénoménologie féministe du trauma qui prendrait au sérieux les fonctions de la violence sexiste dans un spectre de réactions traumatiques chez les femmes. La phénoménologie de McDonald n’est pas à délaisser pour autant : son regard positif sur le vécu traumatique invite à voir dans le trauma des formes de résilience bien souvent éclipsées par les conséquences déstabilisatrices de cette expérience, des stratégies de survie puisant dans des propriétés parfois insoupçonnées. Penser et agir la résistance aux oppressions traumatiques nécessite parfois de renouveler les avenues déjà empruntées, écrivait bell hooks dans Apprendre à transgresser : « La plupart des problèmes que nous affrontons, en tant que Noir·es : mauvaise estime de soi, nihilisme et désespoir intensifiés, rage et violence réprimées qui détruisent notre bien-être physique et psychologique, ne peuvent être abordés par des stratégies de survie qui auraient fonctionné dans le passé » (hooks, 2019, p. 66). Quoi de plus transgressif que de forger la résistance à même le feu des traumas collectifs qui autrement ne contribueraient qu’à nous isoler les un·es des autres ?
Conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêt déclaré.