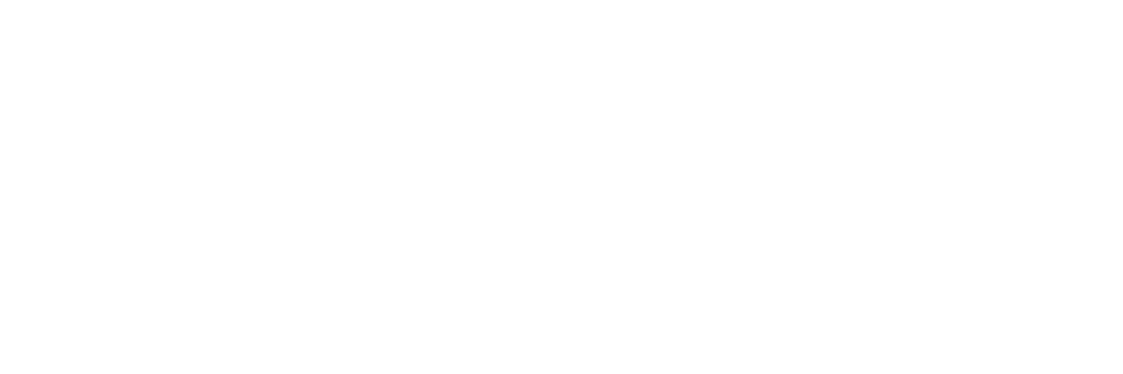Introduction
Le concept de narcissisme se construit au xixe siècle en se fondant sur le mythe de Narcisse, un bel homme tombant amoureux de son reflet, se noyant dans l’eau en cherchant à s’embrasser lui-même, puis transformé en fleur. Le concept de narcissisme a immédiatement été pensé comme l’apanage des femmes et des hommes homosexuels, et mène aujourd’hui à certaines conceptualisations de la transidentité comme « autogynéphilie ». L’étude critique de la psychanalyse n’est pas nouvelle : l’anti-psychanalyse et la psychanalyse queer déconstruisent depuis plus de cinquante ans la cishétéronormativité de la psychanalyse, avec des auteur·ices comme Monique Wittig (1973), Hélène Cixous (1983), Foucault (1985), Eve Kosofky Sedgwick (1990/2008) et plus récemment Paul B. Preciado (2013), Fabrice Bourlez (2018), Laurie Laufer (2022), et Avgi Saketopoulou et Ann Pelligrini (2023). Les études trans ont également développé une large critique des concepts psychanalytiques avec notamment les recherches de Leslie Feinberg (1996, 1998), Julia Serano (2007), Sam Bourcier (2003), Maud-Yeuse Thomas et Karine Espineira (2013), le collectif Cases Rebelles (Danjé et al., 2021). Comment expliquer, à l’aune des Trans Studies, le passage du mythe du narcissisme à la constitution de catégories diagnostiques pathologisant l’homosexualité et la transidentité et introduisant des catégories non scientifiques et stigmatisantes comme l’autogynéphilie ? Nous proposerons ainsi une généalogie du narcissisme en passant par Freud puis Ray Blanchard pour montrer la constitution cishétérosexiste des discours sur l’homosexualité et la transidentité au sein des discours dans le champ de la psychologie et de la psychiatrie.
Freud et le narcissisme
Généalogie du concept de narcissisme
Freud reprend le terme de narcissisme à Paul Näcke qui l’a utilisé en 1899 pour désigner une perversion consistant à traiter son propre corps comme objet sexuel auto-référentiel, par la façon de le contempler, le caresser, le cajoler en vue d’éprouver un bien-être sexuel (Freud, 1914/2012, p. 24). Si le narcissisme n’est plus une perversion pour Freud dans la mesure où il y a un narcissisme normal chez l’individu (dans le sommeil, au cours des maladies organiques, dans l’amour hétérosexuel (Freud, 1914/2012)), ainsi qu’au niveau des trois vexations narcissiques de l’humanité, produites par Copernic, Darwin et Freud lui-même (Freud, 1917/1985), le narcissisme pathologique est, pour lui, le signe d’un développement moindre de la psyché et d’un maintien dans l’enfance. Freud s’intéresse, en effet, au narcissisme, depuis son intérêt pour la schizophrénie et pour les accès mégalomaniaques, mais aussi depuis son étude des enfants et de ce qu’il nomme les « peuples primitifs », qui auraient une vie psychique mégalomaniaque centrée sur une pensée magique, contrairement aux sociétés européennes. Les sociétés « primitives » et les enfants seraient selon lui dirigés par des pensées présumées d’une toute-puissance (Freud, 1914/2012). Sa troisième source d’observation pour avancer le concept de narcissisme est la vie amoureuse et l’homosexualité, dans la mesure où les homosexuel·les construiraient leur désir par des investissements narcissiques.
La pathologisation du narcissisme et la théorie du traumatisme dans l’hystérie chez Freud
Freud s’oppose aux théories émises par les homosexuel·les elleux-mêmes, comme Karl-Maria Ulrichs (Dauvé, 2018), qui postulent une homosexualité de naissance comme « troisième sexe », de sorte à décriminaliser leur condition. Il faut, selon Freud, une explication psychanalytique de la naissance de l’homosexualité (Freud, 1910/2001). Pour lui, il existe deux sexes, qui sont biologisés. Dans la mesure où l’auto-érotisme infantile se construit autour de satisfactions vitales, l’enfant fixe d’abord sa libido sur sa mère ou sur son substitut. Dans la sexualité dite « normale » par Freud, après être passé par une bisexualité originelle où le narcissisme de l’enfant est normal, l’enfant passe par le complexe d’Œdipe ou négatif.
Le complexe d’Œdipe émerge des recherches de Freud sur les hystériques à l’Hôpital de la Salpêtrière. D’abord convaincu que les hystériques disent la vérité, il suppose l’origine de l’hystérie dans des traumas sexuels. Cependant, il revient sur cette théorie dans sa Lettre à Wilhelm Fliess du 21 Septembre 1897 (Freud, 1985/2007) : l’idée du trauma sexuel est gênante car elle incrimine les pères des patientes, et même son propre père. De nombreux hommes notables sont accusés d’inceste, de pédophilie, et Freud dit qu’il est impossible qu’il y en ait autant. Il lui semble alors plus probable que, plutôt qu’un abus réel, la patiente ait un fantasme sexuel inavouable et qu’elle mente. C’est par ce passage de la théorie du trauma à la théorie du traumatisme que naît la conceptualisation du complexe d’Œdipe. Ainsi Freud dit que c’est le fantasme œdipien et non le trauma comme réalité historique qui rend malade : la jeune femme malade fantasmerait sur son père ou une figure paternelle, ce qui la rendrait malade. L’hystérie est de ce fait renvoyée à une maladie de frustration et de perversion sexuelles1. Si Freud croyait la parole des hystériques, l’aspect socialement compromettant voir révolutionnaire de leur prise au sérieux le fait de nouveau finalement basculer dans l’idée que les femmes mentent et seraient, au fond, dirigées par leur inconscient pervers. Ainsi lorsqu’en 1938 la loi française dote chaque département d’un asile s’occupant des maladies mentales, les aliénistes remplissent un rôle de moralistes et de médecins.
Le complexe d’Œdipe et l’étiologie de l’homosexualité
Freud postule avec le complexe d’Œdipe que pendant cette période infantile, la libido normale se fixe sur un objet du sexe opposé : c’est un choix fondé sur l’étayage. Au contraire, dans l’homosexualité, la libido reste fixée de façon infantile sur le moi. Selon Freud (1914/2012, p. 60) :
Nous avons établi de manière particulièrement distincte, chez des personnes dont l’évolution de la libido a connu une perturbation, comme chez les pervers et les homosexuels, qu’ils ne choisissent pas leur objet ultérieur en s’inspirant du modèle de la mère, mais de celui que leur fournit leur propre personne. Ils se cherchent manifestement eux-mêmes comme objet amoureux et présentent un type de choix d’objet qu’il faut qualifier de narcissique.
Pendant le complexe d’Œdipe ou son inverse, l’enfant développerait systématiquement le complexe de castration ou l’envie du pénis. L’enfant se pose la question de savoir comment on fait des enfants, et le garçon suppose alors que tout le monde possède un pénis, y compris sa mère. La réalisation que le membre viril manque aux filles génère en lui une telle peur qu’il pense que les filles finiront par en développer un aussi ou alors qu’il a été coupé. Naîtrait ainsi le complexe de castration et la peur de perdre sa propre virilité chez le petit garçon, tandis que la fille développerait l’envie du pénis. Selon Freud (1910/2001), le dégoût suscité par cette supposée compréhension peut mener à l’homosexualité. De ce fait, l’Œdipe théorise une sexualité nécessairement hétérosexuelle et fixe les flux libidineux de façon unidirectionnelle. Nous pouvons voire que Freud se focalise notamment sur l’homosexualité masculine. En effet, Freud a toujours laissé les femmes de côté dans ses analyses, que ce soit par son analyse hétérocentrée, plus brève et plus tardive du complexe d’Électre2 que par l’invisibilisation du lesbianisme de Dora et ses contre-transferts phallogocentriques dans sa clinique, tant avec Dora que Sidonie (Evzonas, 2023). L’homophobie freudienne se manifeste ainsi notamment par sa lesbophobie.
La place de la mère dans le désir homosexuel et pseudo-homosexualité chez Freud
Au xixe siècle se développe un discours médical cishétérosexiste, misogyne et transphobe dans un contexte où les disciplines psy développent une armature biopolitique de gestion des corps anormaux (Preciado, 2013). Les développements apportés par Freud s’ancrent donc dans un contexte historique où l’inversion était qualifiée de dégénérescence (Chaperon, 2012). Freud s’éloigne de ce genre de thèse mais porte néanmoins un discours cishétérosexiste concernant les inverti·e·s3, qu’il va associer au narcissisme. Si Freud a postulé en 1905 que ce narcissisme adolescent serait le résultat d’une éducation du garçon par des hommes, comme dans le cas de l’antiquité grecque où des esclaves prenaient en charge ce travail, Freud revient sur cette hypothèse. A partir de 1910, il suppose plutôt que le processus psychologique menant à devenir inverti démarre à cause d’une absence du père, menant le garçon à s’identifier à sa mère dans la petite enfance. Durant l’enfance, le garçon vit un lien intense avec sa mère, mais ne voit pas son père comme un rival, ou bien vit une trop forte répression sexuelle de la part de celui-ci et évite ainsi le tabou de l’inceste. Dans le complexe de castration normal, le garçon abandonne la mère comme objet d’amour exclusif devant la menace de castration, tandis qu’en l’absence du père, un tel investissement libidinal peut perdurer. Au lieu de renoncer à la mère, celui-ci s’identifie à elle. Selon Freud (1910/1983, pp. 79-80) :
Le petit garçon refoule son amour pour sa mère, en se mettant lui-même à sa place, en s’identifiant à elle, et il prend alors sa propre personne comme l’idéal à la ressemblance duquel il choisit ses nouveaux objets d’amour. Il est ainsi devenu homosexuel, mieux, il est retourné à l’autoérotisme, les garçons, que le garçon grandissant aime désormais, n’étant que des personnes substituées et des éditions nouvelles de sa propre personne enfantine.
L’enfant devient homosexuel quand il refoule son investissement libidinal pour sa mère afin de s’identifier à elle et se prend lui-même pour objet d’amour : l’homosexualité est ainsi définie comme autoérotisme, c’est-à-dire comme narcissisme. C’est par fidélité à sa mère que l’homme homosexuel ne peut désirer d’autres femmes : « Par cette relation érotique à ma mère, je suis devenu un homosexuel » (Freud, 1910/1983, p. 91). Ce qu’il désire chez les autres hommes, c’est leur féminité, ou bien ce qu’il désire chez les autres femmes qu’il transfère sur les hommes. Néanmoins, la position de Freud reste ambivalente, complexe et surdéterminée par la dimension à plusieurs strates du corpus freudien. En effet le discours pathologisant sur la transidentité ne découle pas de Freud lui-même mais plutôt d’interprétations de post-freudiens faisant une lecture sélective et arbitraire de ses textes. En effet, la note de 1915 des Trois Essais explique bien que l’énigme de la psychanalyse est d’élucider l’hétérosexualité exclusive.
Cependant, avec Freud, une homosexualité sans référentiel hétérosexuel n’existe pas4. Selon Freud, les homosexuels substituent au désir pour le mamelon maternel l’image phallique ; l’homosexuel, amoureux de sa mère, déplacerait ce désir pour le mamelon maternel vers un retour auto-érotique pour le pénis, où il désirerait le sperme par équivalence au lait maternel (Freud, 1910/2001). A l’adolescence, les hommes gays resteraient dans la contemplation narcissique de leurs propres parties génitales avec une redirection de la libido vers l’anus et le déplacement du désir de leur propre pénis vers un autre homme. De ce fait, l’homosexualité est conçue comme un blocage à un stade de développement infantile de la sexualité et à l’expression archaïque de mécanismes psychiques primitifs (Freud, 1905/2014).
Normalisation du désir
Chez Freud, la sexualité dite normale se construit ainsi pour l’homme dans l’adolescence avec l’éjaculation dans un vagin et le dépassement pour la femme du plaisir clitoridien vers une sexualité hétérosexuelle purement pénétrative. Les lesbiennes, déçues par le père et faisant une fixation sur la mère resteraient de ce fait selon lui bloquées au stade infantile de la sexualité conditionnée par une sexualité non pénétrative. « On considère comme le but sexuel normal l’union des organes génitaux dans l’acte défini comme accouplement qui conduit au dénouement de la tension sexuelle et à une extinction temporaire de la pulsion sexuelle (satisfaction analogue au rassasiement pour la faim) » (Freud,1905/2014, p. 30) Pour Freud, les pratiques bucco-génitales, la sodomie, le fétichisme, le sado-masochisme relèvent de perversions sexuelles faisant renoncer au but sexuel normal. À l’adolescence, les femmes adopteraient naturellement des pulsions sexuelles passives, ce qui leur permettrait de refouler la « sexualité mâle » de leur petite enfance qui les mènerait à exprimer l’envie de pénis à travers l’envie d’être un garçon – cette envie de pénis n’est pas conçue comme le résultat d’inégalités sociales. Un trop grand refoulement des pulsions mènerait à l’hystérie. Les hommes exprimeraient quant à eux une poussée de libido qui viserait à les rassurer par rapport au complexe de castration – ce que Lacan nomme posséder le phallus, et qui ne peut être possédé que par l’unique homme dans la relation sexuelle. Afin de construire l’idéal narcissique du moi, le sujet utilise « de grandes quantités de libido essentiellement homosexuelle » (Freud, 1914/2012, p. 72) ; en ce sens l’homosexualité est ainsi le résultat d’un surplus de libido auto-érotique dans l’enfance et mènerait l’homosexuel.le à choisir un objet qui lui ressemble le plus possible (Freud, 1914/2012), mais reconduisant tout de même le schéma hétéronormatif puisque l’objet du désir inverti efféminé serait par essence un être viril (Freud, 1905/2014).
Homosexualité, féminité et hystérie
Dans la construction psychanalytique du narcissisme par Freud, dont il justifie la misogynie par la biologisation, toutes les femmes seraient aussi prédisposées à développer un narcissisme ne les faisant n’aimer qu’elles-mêmes (Freud, 1914/2012). Freud imagine le modèle d’une femme très belle, cherchant absolument à se faire aimer par les hommes mais incapable de rendre l’amour à l’homme et le faisant douter de lui, et qui ne pourrait guérir qu’en enfantant. Ce modèle de la femme narcissique se construit de ce fait en parallèle avec ses considérations sur l’hystérie5. Jean-Martin Charcot puis Valentin Magnant définissent d’ailleurs l’homosexualité masculine comme une forme d’hystérie (Chaperon, 2012). La femme refusant d’être en couple, tout comme la personne trop intéressée par son apparence, aurait une essence narcissique, donc féminine et par extension, hystérique. En effet, Freud, qui a fixé le concept d’homosexualité à la place de celui d’inversion, garde toujours en tête ce modèle. Pour lui, la différence entre ce que nous appelons aujourd’hui homosexualité, transidentité et travestissement est ténue, dans la mesure où les invertis de l’époque prenaient souvent des vêtements assignés au genre opposé. Il reprend la distinction de Ferenczi entre deux types : l’« homoérotique de sujet » et « homoérotique d’objet », où le premier « se sent et se comporte comme une femme » et où le second « n’a fait qu’échanger l’objet sexuel féminin par un objet homosexuel » (Freud, 1905/2014, p. 69, note de bas de page). Cependant les deux catégories restent sur une même ligne de compréhension homosexuelle dans la mesure où ce qu’on appellera plus tard la « transsexualité » n’est pas encore théorisée. Selon Freud l’homosexualité serait reconnaissable à travers des traits physiques qui féminisent les corps. En ce sens, l’homosexuel reste plus proche des femmes, son efféminement et son soin de lui-même sont le signe d’une féminité ou d’une hystérie sous-jacente.
Homosexualité et sublimation
La conceptualisation par Freud de l’homosexualité comme résultant d’une libido se fixant de façon anormale, son admiration pour l’idéal civilisationnel grec et sa fascination pour Platon, Léonard De Vinci, Michel-Ange, lui ont fait comprendre les gays comme artistes par nature6. En effet, les pulsions sexuelles rendues inutilisables pour la fonction de reproduction – donc perverses, sont assignées à la sublimation (Freud, 1905/2014). Or les homosexuels ne se reproduisant pas, sublimeraient particulièrement leurs pulsions sexuelles à travers l’art. Freud pose que le Ça produit des pulsions sexuelles socialement inadaptées, que le Surmoi réprime grâce à la pudeur, au dégoût et aux idéaux auxquels nous sommes socialisé·es dès le plus jeune âge. Celles-ci peuvent être soit refoulées, et ainsi mener au développement de névroses, soit s’exprimer sous forme de perversions, ou bien être sublimées. Selon Freud, la sublimation est le processus de mise à distance de l’objet par lequel ces pulsions sexuelles inutilisables qui exigent un objet pour se satisfaire sont détournées vers de nouveaux buts, permettant ainsi la création d’œuvres culturelles.
Le sublime freudien est éminemment pratique : il est l’expression morale, ou du moins pro-sociale, d’un désir à l’origine pervers. Freud pense que les personnes très douées artistiquement ont une certaine dose de perversion et de névrose qui leur permet d’être artistiquement productives, ce qui n’est pas sans lien avec l’homosexualité. En effet, Freud pense que l’instinct sexuel peut être sublimé par des créations culturelles ou un intérêt scientifique intarissable, comme ce fut, selon lui, le cas chez Léonard de Vinci, qu’il perçoit comme un homosexuel platonique (ce qui est historiquement faux). « La recherche devient, ici encore, dans une certaine mesure, obsession, et “ersatz” de l’activité sexuelle » (Freud, 1910/1983, p. 36). Dans le cas où la pulsion sexuelle ne peut s’exprimer par la sublimation, la personne développerait des névroses ; et une morale sexuelle civilisationnelle trop forte créeraient davantage de névrosé·es. Selon Freud, les femmes étant indisposées naturellement à la sublimation, celles-ci tomberaient plus facilement dans de sévères névroses, dont en premier lieu l’hystérie.
La position complexe de Freud à l’endroit de l’homosexualité
La question du statut pathologique de l’homosexualité est toujours ambivalente chez Freud. Dans une lettre du 9 avril 1935, adressée à une mère d’un fils homosexuel (Freud, 1966) il écrit que l’homosexualité n’est pas une tare qu’il faudrait chercher à guérir et dont il faudrait avoir honte. Contrairement à Krafft-Ebing (1886) il ne la conçoit pas comme une dégénérescence. Néanmoins, Freud la conceptualise comme le résultat d’un développement anormal de la libido et donc l’expression pathogène de l’enfance et de la famille. L’homosexualité, l’amphigénie (bisexualité) sont d’après Freud des déviations des buts normaux de la sexualité. La frontière avec les personnes hétérosexuelles est ténue car selon Freud, tout individu a la capacité de choisir un objet du même sexe et l’hétérosexualité ne va pas de soi : ainsi, la sexualité relève plutôt d’un spectre que de séparations nettes. Cependant, si son objectif n’est pas de pénaliser l’homosexualité, la psychanalyse a néanmoins le but de gérer la pacification des mœurs.
Ray Blanchard, l’autogynéphilie et le DSM-5
Pathologisation narcissique de la transidentité
Selon Eric Fassin nous assistons au tournant des années 1990-2000 à une inversion de la question homosexuelle : dans un contexte post-foucaldien, plutôt que de demander l’étiologie de l’homosexualité, on se questionne sur l’étiologie de l’homophobie. Néanmoins, la question du Pacte civil de solidarité (PACS) et de l’homoparentalité ont été l’occasion d’un enflammement des débats, où de nombreux psychanalystes ont pris position contre le PACS au nom d’une diabolisation de l’homosexualité proche des discours catholiques (Fassin, 2003). Si aujourd’hui il est plus difficile de se dire en toute impunité homophobe, y compris au sein de l’International Psychoanalytical Association (IPA) et de revendiquer un ordre symbolique anhistorique, le cishétérosexisme n’a pas pour autant disparu des débats, qui ont aujourd’hui basculé vers la « question transgenre » (Laufer, 2022), avec notamment un focus sur la possibilité pour les enfants trans de transitionner. Ainsi après l’inversion de la question homosexuelle, Nicolas Evzonas propose une inversion de la question trans (Evzonas, 2023). C’est dans ce contexte de basculement vers la « question transgenre » que les travaux de Freud et d’autres auteurs comme ceux de Havelock Ellis ont eu un écho dans la psychologie contemporaine auprès du psychologue Ray Blanchard, jusqu’à influencer la construction actuelle du DSM, dans la mesure où Ray Blanchard a lui-même participé en 2008 à la constitution de sa cinquième édition concernant les « troubles de l’identité de genre » à l’entrée « fétichisme du travestissement »7.
Si l’homosexualité a été retirée du DSM-III en 1974 suite aux bouleversements apportés par les émeutes de Stonewall (Laufer, 2022), en 1983, Blanchard publie une première enquête par questionnaire voulant prouver la validité de la théorie freudienne concernant l’absence de père comme fondement de l’homosexualité et des identités de genre transféminines. Dans cette enquête, il tente de justifier l’homosexualité et l’identité de genre transféminine par le mauvais lien parental des personnes queer à leur père dans l’enfance (Blanchard et Freund, 1983). Il inverse ainsi cause et effet : plutôt que supposer qu’exprimer une identité de genre moins normative (ce que les hommes interrogés ont reporté) pourrait créer davantage de tensions familiales dans un contexte social hétérosexiste et cissexiste, la corrélation des identités gay et transféminines avec l’éloignement du père est lue de façon inverse : c’est l’éloignement avec le père qui causerait l’identité gay et transféminine. Une telle lecture cherche à justifier avec une aura scientifique l’idée que l’homosexualité et les identités transféminines résulteraient d’une redirection narcissique de la libido face à un complexe d’Œdipe mal digéré.
Questionner les tropes transmisogynes des théories sur le narcissisme
Entre 1985 et 2009, Ray Blanchard continue ses enquêtes sur base de questionnaires autour du spectre transféminin et à base de tests phallométriques, l’amenant à formuler le concept d’« autogynéphilie », soit « s’aimer soi-même comme femme » (Blanchard, 1989, p. 323), dont le « symptôme » majeur serait « l’excitation érotique en association avec le travestissement » (Blanchard, 1989, p. 319). Il cherche à mesurer cette « autogynéphilie » avec « l’échelle d’autogynéphilie » et « l’échelle de dysphorie de genre » qu’il a lui-même créées. Bien qu’il développe parfois quelques paragraphes sur l’autoandrophilie, sa conception se focalise majoritairement sur les femmes trans, dans la mesure où seule l’expression de genre féminine peut être vue comme paraphilique. Selon Robert Stoller, « Les vêtements d’hommes n’ont pas de valeur érotique et donc ces personnes n’ont donc pas de fétichisme vestimentaire » (cité par Serano, 2009, p. 11). Ainsi, la transmisogynie structure profondément le propos de Ray Blanchard, d’où son focus sur les femmes trans, qu’il s’agit d’éliminer de l’espace public selon sa perspective. En effet, selon Julia Serano, la transmisogynie se définit par le fait que l’identité transféminine soit ridiculisée et discréditée pour son appartenance au genre féminin et ses expressions de féminité. La transmisogynie opère ainsi par l’hyperféminisation, la sexualisation et la choséification, de sorte à toujours délégitimer la féminité des femmes trans comme non-naturelle (Serano, 2007/2020). Selon Serano, la féminité est vue comme menace pour la masculinité dans le système d’opposition binaire de deux genres8. Dans un contexte phallocratique et hétérosexiste, les femmes trans sont représentées comme des « usurpatrices », représentant ainsi une menace pour les hommes cishétéros, qui craignent de se faire « duper » par des femmes trans (c’est-à-dire de suggérer qu’ils sont en réalité homosexuels) (Serano, 2007/2020, p. 34).
Le moindre intérêt de Ray Blanchard pour les hommes trans s’inscrit, quant à lui, dans une invisibilisation plus générale qui pourrait également être lue comme cissexiste et transphobe. Les personnes transmasculines représentent en effet une menace pour les hommes cisgenres : selon Julia Serano, les hommes trans sont davantage ignorés médiatiquement et il est plus difficile de les transformer en sujet sensationnaliste car cela remettrait en question la notion même de masculinité (2007/2020)9. Être ouvertement une personne transmasculine révèle que la masculinité relève d’une performance (Butler, 1990) à laquelle sont accordés des privilèges illégitimes qu'il est possible de mimer. Il est ainsi possible de caricaturer la masculinité hégémonique pour la retourner contre elle-même. L’exclusion des hommes trans des cercles y compris cismasculins gays montre une ligne de fracture transmisogyne qui touche également les personnes transmasculines. De plus, selon Yony Leiser (2017), la transmasculinité genderfuck remet en question le capital : on ne peut capitaliser sur une personne perçue comme butch testostéronée, car cette personne n’incarne alors plus l’idéal de la-femme (idéal féminin typique). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les performances drag-king ne connaissent pas le même succès médiatique que les performances drag-queen : la performance masculine drag relève de la moquerie de la masculinité cishétérosexuelle dominante et menace trop l’ordre social pour être capitalisable.
L’autogynéphilie
Blanchard s’inspire pour l’autogynéphilie de l’homophobe Havelock Ellis, ayant avancé au xixe siècle la théorie d’une « inversion sexo-esthétique » désignant les travestis avec des sentiments subjectifs de féminité (Ellis, 1913). Tout comme chez Ellis, « l’autogynéphilie » est qualifiée de trajectoire déviée pathologiquement de l’hétérosexualité, où la satisfaction sexuelle d’un homme serait déplacée depuis le désir normal et naturel de se marier avec une femme vers le désir de se voir soi-même en femme. Ici Blanchard parle « d’erreur développementale de la localisation de l’objet érotique » (Freund et Blanchard, 1993, p. 558). Le désir, plutôt que de se fixer hétérosexuellement sur « de vraies femmes » (« real-life female ») est dévié vers des objets représentant la féminité (Blanchard, 1993a, pp. 70-71). En somme, est autogynéphile tout « homme » qui est sexuellement excité à l’idée d’avoir un corps nu de femme, de porter des vêtements féminins ou d’être traité comme une femme. Pour Blanchard, les travestis sont par définition « autogynéphiles ». Il classifie comme « autogynéphilie partielle » tout désir d’être, ou tout désir envers ce qu’il nomme, de façon extrêmement transphobe, des « she-males »10, soit « des hommes impliqués dans la prostitution ou la pornographie, qui ont eu une augmentation mammaire tout en maintenant leurs parties génitales mâles » (Blanchard, 1993a, p. 69, notre traduction). En somme, toute attraction envers des personnes trans est qualifiée de paraphilique : un amour réel avec une personne trans serait impossible car la personne ne pourrait qu’être un objet fétiche. Ce que sous-tend sa théorie sur les femmes trans sans chirurgie génitale est que tout refus de chirurgie mène directement à la classification de « gynémimétisme », soit le désir, qu’il qualifie de possiblement « étrange et dégouttant » de ne pas vouloir de vaginoplastie, qu’il faudrait selon lui soigner par thérapie de conversion avec la psychothérapie, et dans les « cas récalcitrants », « soigner » avec un accès aux hormones (Blanchard, 1993a, p. 75, notre traduction). Pour Blanchard, les « gynémimétiques » cherchent à imiter et à mentir sur le fait qu’on est une femme, ce qui n’est pas sans rappeler les théories transphobes propagées par les Transgender Exclusionary Radical Feminists (TERF) concernant les femmes trans cherchant à s’introduire dans les espaces féminins. Blanchard ignore complètement l’existence possible non seulement d’une non-binarité non-pathologique mais aussi les difficultés financières et administratives d’accès à des chirurgies génitales.
Autogynéphilie et discours sexualisants du travestissement
Selon Blanchard et le DSM-5, la transidentité est une extension possible de la perversion du « désordre de travestissement » qui serait le reflet d’une « autogynéphilie » latente (Blanchard, 2010, p. 366). Pourquoi alors élaborer un nouveau concept s’il y a déjà le concept de travestissement (qui est lui-même pathologisé) ? Il s’agit en fait d’un nouveau terme redoublant la pathologisation d’un type de désir sexuel existant chez certaines personnes trans et travesties s’expliquant par la dysphorie de genre et l’euphorie de genre, en cherchant à désigner ces identités et expressions de genre comme une orientation sexuelle purement narcissique, où le sujet serait orienté majoritairement envers ellui-même. Le diagnostic sert ainsi à re-sexualiser le diagnostic de transidentité et de travestisme en les connectant à une forme de fétichisme sexuel plutôt qu’à une identité, ce qui exacerbe la discrimination sociale que le groupe subit déjà (Davy, 2015). Il s’agit, de ce fait, d’une manière de disqualifier le désir de transition en en faisant un fantasme pervers. Julia Serano a notamment questionné le fait que seules les personnes transgenres seraient autogynéphiles, dans la mesure où des femmes cisgenres également pouvaient être sexuellement excitées par le fait de se concevoir comme femmes. Ainsi cette conception de la sexualité trans comme foncièrement perverse interroge a contrario ce que Ray Blanchard considère comme une sexualité normale dans la mesure où toute sexualité trans est construite comme intrinsèquement perverse (Wynn, 2018). Julia Serano a souligné comment la sexualisation des personnes trans participe également à l’invalidation, la déshumanisation et à la légitimation des violences, d’où l’opposition généralisée des personnes trans à ces théories. En effet, les activistes transfémininistes, dont Julia Serano et Nathalie Wynn, ont largement montré que la motivation première pour transitionner n’est pas due à une paraphilie, ni motivée par un but purement sexuel, mais qu’il s’agit d’un choix en lien avec une dysphorie de genre – ou une euphorie de genre – qui affecte tous les aspects de notre vie, et qui implique que transitionner vaille la peine de risquer de mettre en jeu notre vie professionnelle et familiale.
Cishétérocentrisme du diagnostic de dysphorie de genre
Magnus Hirschfeld, un homosexuel militant progressiste du xixe siècle ayant inventé le terme « travesti » en 1910 (Hirschfeld, 1910)11 inspire les recherches de Blanchard. Il continue néanmoins de considérer les femmes trans comme des hommes, et les hommes trans comme femmes car il prétend s’opposer à la théorie selon laquelle les femmes trans auraient une âme de femme dans un corps d’homme, comme s’il s’agissait du seul vécu trans opposé à sa théorie (Blanchard, 2008). En ce sens, les termes homosexuel et hétérosexuels réfèrent chez Blanchard au « sexe chromosomique » (Blanchard, 1989, p. 316) (qu’il n’a cependant pas vérifié chez les sujets interrogés pour ses études). Le féminisme de la seconde et de la troisième vague ont largement insisté sur la construction sociale du genre et du sexe. La perspective apportée par Judith Butler sur la conception du genre comme performatif a largement été ignorée alors qu’elle donne des clés de lecture indispensables en matière d’identité sexuelle et de genre. Le diagnostic actuel de « dysphorie de genre » est déconnecté du changement social, dans la mesure où les activités auparavant considérées comme entièrement féminines ou masculines (par exemple une femme faisant de la boxe ou des arts martiaux) ne sont plus marquées de façon aussi binaire que les exigences de présentation de genre faites par la psychiatrie aux personnes trans (Davy, 2015).
Typologies d’autogynéphilie et fantômes de l’hystérie
Selon Blanchard, il y a deux types d’autogynéphiles : les femmes trans lesbiennes qui représentent « l’autogynéphilie pleine » ; et les femmes trans hétéro, bi, ou asexuelles plus ou moins « autogynéphiles ». Ainsi le lesbianisme, qui a été si peu étudié par Freud, apparaît comme le reflet d’un narcissisme complet des femmes trans, où l’entièreté de la vie sexuelle des femmes en question tournerait autour du fétichisme auto-centré du féminin. Les personnes asexuelles sur le spectre trans sont vues comme les plus narcissiques : « “la femme à l’intérieur” supplante complètement ses rivales faites de chair » (Blanchard, 1989, p. 324, notre traduction). Le « travestisme » mènerait souvent au « transsexualisme » dès lors qu’une dysphorie de genre serait également diagnostiquée (Blanchard, 1993b). En effet, Blanchard classifie les femmes trans en deux autres classes : les « transsexuels homosexuels » (lire hétérosexuelles) qui transitionneraient à cause de la pression sur les hommes efféminés et pour mieux coucher avec des hommes hétérosexuels, et les « transsexuels autogynéphiles » qui transitionneraient à cause de leur excitation paraphilique à l’idée d’être ou de devenir une femme (Serano, 2009, p. 12). En plus de cette hypersexualisation, les personnes n’entrant pas dans ses catégories pré-établies sont qualifiées de « menteuses pathologiques » par Blanchard (et il est intéressant de noter qu’à ce titre, il accepte de les reconnaître comme femmes) (Serano, 2009, p. 14). Nous voyons ici que la pathologisation et sexualisation du travestissement et la vision réductrice des identités trans qui continue de construire le DSM hérite du narcissisme féminin et homosexuel freudien et des théories sur l’hystérie. Ray Blanchard considère en effet la transidentité comme une maladie mentale manifestée par une « dysphorie de genre extrême » dans la droite lignée du DSM. Cette conception persiste aujourd’hui avec le diagnostic de dysphorie de genre, bien qu’officiellement dé-pathologisé. En effet, bien qu’elle ne soit plus considérée comme maladie mentale depuis 2011 en France, le maintien de la catégorie de dysphorie reconduit l’idée d’une essence de la transidentité et donc, d’une anormalité du désir d’être perçu·e dans un genre non cis.
Influences sur le mouvement TERF et ignorance épistémique volontaire des recherches situées
J. Michael Bailey (2003) puis Anne A. Lawrence (2008) ont, dans les années 2000, popularisé ces théories freudiennes en sexologie et auprès du grand public ainsi qu’auprès d’un grand nombre d’universitaires et de journalistes. Les TERF ont pu se réapproprier ce vocabulaire suite aux recherches de Ray Blanchard. Cette popularisation de Ray Blanchard a mené à son inclusion dans le groupe de travail sur les paraphilies pour le DSM-5. L’homosexualité est restée diagnostiquée comme une maladie mentale jusqu’au DSM-II puis a été remplacée en 1980 par le diagnostic « d’homosexualité ego-dystonique » pour être aboli en 1987 avec le DSM-III-R. Selon Eve Segdwick (1990), l’inclusion de la « dysphorie de genre infantile » au DSM-IV a servi à remplacer le diagnostic d’homosexualité. La construction de la section « Troubles de l’identité sexuelle et de genre » du DSM-5, qui intègre le concept d’autogynéphilie et d’autoandrophilie au diagnostic du « travestisme fétichiste », a, quant à elle, été menée par un groupe de sexologues se citant entre eux (Blanchard, Bailey, Lawrence sous la direction de Ken Zucker).
Cette construction ignore et écarte tout un panel de recherches ayant été menées par des activistes queer elleux-mêmes, les études trans, les modèles non-oppressifs incluant les personnes transmasculines, transféminines et des identités de genre non-dysphoriques (Susan Stryker, Judith Butler, Julia Serano, Maud Yeuse-Thomas, Karine Espinera, Paul B. Preciado etc.). Les travaux transféministes de l’Association Mondiale Professionnelle pour la Santé Transgenre arguant pour un retrait du DSM de la dysphorie de genre et du fétichisme du travestissement, se situant dans une perspective d’auto-détermination du genre sans expertise médicale, ont également été laissés de côté. D’autre part, les expériences des pays autorisant l’accès aux hormones sans avis psychiatrique comme en Argentine, Malte, au Danemark et en Espagne ont également été ignorées. L’autogynéphilie a ainsi été introduite par ces auteurs dans le DSM-5 comme symptôme du transvestisme dans les paraphilies (Davy, 2015). Une telle construction du DSM maintient un système de « gatekeeping » où, pour avoir accès légalement à une transition, il faut d’abord prouver à un.e psychiatre que l’on est bien un.e « vrai.e » trans. Ce maintien d’un système qui dépossède les personnes trans laisse aux psychiatres la possibilité de juger si la personne serait assez attirante en femme ou en homme, ou assez féminine ou masculine.
« Rage narcissique » et réduction au silence dans le débat public
Les réactions négatives, les dénonciations de méconduites professionnelles par des femmes trans activistes, la comparaison avec la propagande nazie à propos des Juifs pendant la seconde Guerre Mondiale portée par Lynn Conway, ainsi que la dénonciation d’un gaspillage de l’argent public pour « exploiter et infamer les femmes trans au nom de la science » par Stacy Mc Cain (2004), ont été lues par J. Michael Bailey comme le signe d’une « hystérie » autour de la notion de sexe et des tentatives de réduire au silence le débat universitaire (Bailey, 2020). Selon Anne A. Lawrence, il s’agirait même de manifestations de déni s’exprimant par une « rage narcissique » (Lawrence, 2008, p. 457). Ainsi les réactions de défense ont été lues par la droite comme la démonstration d’un égo immature sur-dimensionné, blessé par l’incapacité de reconnaître des points de vue divergents. Les « autogynéphiles » niant cette théorie seraient simplement des menteur·euses (Blanchard, 1985), ce qui nous renvoie une fois de plus à l’imaginaire de l’hystérie. Selon Anne A. Lawrence, du fait de la honte que les femmes trans devraient nécessairement ressentir en regard de leur condition, et du fait du manque de miroitement positif, en plus des dégradations subies par leurs paires durant leur développement, ainsi que par leur incapacité à idéaliser leur père, celles-ci seraient majoritairement atteintes du désordre de la personnalité narcissique – ce que Anne A. Lawrence avance sans preuve statistique. Selon elle, le fait de transitionner renforcerait le trouble narcissique car aucune femme trans ne serait capable de « passer12 » et vivrait donc davantage de violences, ce qui renforcerait encore la blessure narcissique. Les femmes trans lesbiennes seraient particulièrement promptes à la « rage narcissique » – tandis qu’une lecture intersectionnelle de la colère des femmes trans lesbiennes explique parfaitement la légitimité de la colère venant de personnes subissant de multiples oppressions.
Nous voyons donc comment les catégories psychologiques ont été construites et instrumentalisées afin de délégitimer toute opposition politique à la transphobie de ces théories, qui justifient les violences subies par les personnes trans en usant de l’aura d’un discours se prétendant descriptif et scientifique. Toute opposition passe pour un manque d’empathie envers les personnes attaquées et pour un « sens grandiose de soi » ou une « récalcitrance » (entitlement) à accepter les théories pseudo-scientifiques transphobes (Lawrence, 2008, p. 459). Comme l’a souligné Julia Serano, de telles conceptions maintiennent les premières personnes concernées dans une invalidation par infériorisation mentale, et autorisent des personnes n’ayant aucune connaissance sérieuse de l’expérience trans à parler à leur place. « Tant qu’une quelconque forme de variation de genre reste codifiée dans les pages du DSM, elles continueront à être citées par des personnes invalidant l’expérience transgenre comme preuve qu’elles sont mentalement inférieures ou incompétentes » (Serano, 2009, p. 7, notre traduction).
Actuellement, les psychiatres servent encore majoritairement à évaluer les demandes de transition de genre des personnes trans : « Le système de santé leur demande d’identifier les candidats à des protocoles de traitement en fonction de critères tels que leur sexualité, l’histoire de vie qu’ils racontent, des tests mesurant leur degré de masculinité/féminité, leur âge et leur orientation sexuelle » (Medico, 2014). D’emblée, les personnes trans se voient mises dans une position de suspicion, et la défiance mutuelle empêche tout réel accompagnement thérapeutique dans la transition. De plus, si la transidentité doit être dépathologisée, il existe néanmoins des circonstances où les personnes trans peuvent nécessiter des soins psy*. Or comme le souligne Jack Pula, à cause du gatekeeping qu’exercent les psychiatres à l’endroit de la transition de genre, une relation malsaine s’est développée entre la communauté transgenre et le système psy*, menant certaines personnes ayant besoin de soins psy* à s’en priver par crainte (légitime) de maltraitances. Pour pallier à ce système de gatekeeping et aux maltraitances médicales, il faudrait envisager une meilleure formation des personnels de santé (Medico, 2014) ainsi que former davantage de personnes trans aux professions psy* afin d’accompagner les personnes trans dans leur transition, dans les autres soins de santé qu’iels nécessitent, et d’éviter l’anxiété dans le contre-transfert (Hansbury, 2017).
Conclusion
L’autogynéphilie ne décrit pas les expériences transgenres et relève d’une production violente de savoir pseudo-scientifique. Nous sommes donc légitimement en colère : le vocabulaire employé nie l’identité de genre et l’orientation sexuelle des personnes trans. Cette colère nous a permis de formuler collectivement nos revendications, nos expériences et désirs. Il est dès lors primordial que les théories psychologiques mainstream s’extraient des conceptions pseudo-scientifiques afin d’adopter des conceptions qui ne marginalisent pas les personnes trans et qui tiennent compte de nos revendications. Pour conclure, en 2019, l’American Psychoanalytic Association a présenté des excuses pour avoir pathologisé pendant longtemps l’homosexualité et la transidentité, « causant ainsi des traumatismes dans l’espace de la cure » (Evzonas, 2020, p. 134) et contribuant aux discriminations vécues par les minorités sexuelles et de genre. L’enjeu désormais est l’ouverture de la psychanalyse aux personnes lesbiennes et gaies et surtout trans, dans la mesure où une grande censure existe encore concernant les analystes transgenres (Laufer, 2022 ; Saketopoulou et Pelligrini, 2023).
Conflits d’intérêt
Aucun conflit d’intérêt déclaré